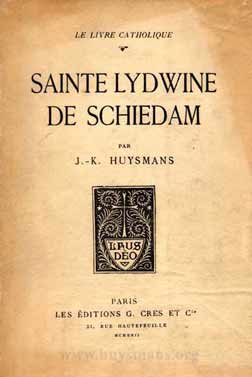GÉNÉRALEMENT, Dieu dispense à chacun de ses saints une dévotion spéciale qui s’accorde avec la tâche que chacun d’eux est plus particulièrement chargé d’accomplir ; la dévotion de cette missionnaire de la Douleur qu’était Lydwine était naturellement celle du chemin de la Croix ; elle la pratiquait, ainsi qu’il fut dit, d’une manière canoniale, divisant en sept étapes, selon le nombre des heures liturgiques, la voie du supplice ; mais cette méditation quotidienne de la Passion, cette ardeur à suivre, sur le chemin du Calvaire, les vestiges du Christ, ne lui faisaient pas oublier cette autre dilection qu’elle avait eue, toute petite, et qui avait grandi avec elle, la dilection de la Vierge.
Ne la rencontrait-elle pas, chaque jour, d’ailleurs, sur la voie du Golgotha, alors qu’elle en gravissait, en pleurant, la pente ? Notre-Dame-des-Larmes avait toujours un regard pour elle, quand elle l’apercevait, mêlée au cortège des saintes femmes ; mais souvent aussi, Lydwine, repassant les jours de sa vie écoulée, revenant sur la route même de son enfance, pensait à cette Notre-Dame-de-Liesse dont la statue lui avait si aimablement souri, dans sa chapelle ; et le désir de la revoir, sous la forme de ce bois sculpté qui lui rappelait tant de souvenirs, s’implantait en elle.
Sans doute, elle l’avait visitée, depuis, en extase, alors que son ange la déposait devant elle, mais ce n’était pas encore cela ; elle aurait voulu la contempler, là, près d’elle, la choyer de ce qui lui restait de regard, ne fût-ce qu’une seconde.
Ce souhait lui paraissait si parfaitement inexauçable — car comment présumer qu’on ôterait cette effigie de l’église pour l’amener chez elle ? — qu’elle n’osait le formuler ; et, d’autre part, elle n’était pas femme à solliciter un miracle pour la satisfaction d’un caprice !
Mais cette convoitise la hantait quand même ; elle essayait de la repousser comme une tentation, lorsqu’elle fut avertie que la Vierge allait la contenter.
C’était quelques jours avant l’incendie de Schiedam ; et Marie arrangea les choses de la façon la plus simple.
L’église avait été très endommagée par le feu, mais la statue était sauve ; en attendant que l’on réparât sa chapelle, il fallait placer son image dans un lieu convenable et l’on eut l’idée de la transférer dans la chambre même de la sainte où elle fut installée sur le petit autel dressé pour recevoir les saintes Espèces, les jours de Réfection ; et tant qu’elle demeura là, elle sembla à tous ceux qui l’approchèrent plus belle qu’elle n’était en réalité ; elle eut une expression de gaieté et de douceur qu’elle perdit lorsqu’elle fut séparée de Lydwine.
Elle, débordait de joie ; mais l’on peut s’imaginer aussi la foule qui fit irruption dans sa chaumine, pour prier la Madone ! Comment Lydwine pouvait-elle endurer ce va-et-vient et ce piétinement incessant de monde même en étant enfermée, derrière les rideaux de son lit, car cette porte, constamment ouverte, introduisait des rais de jour qui lui eussent crevé l’oeil comme des flèches, si elle n’avait été abritée par des courtines ? — La vérité est que ces oraisons qu’elle entendait bruire, autour d’elle, la dédommageaient de cette gêne de n’être plus chez elle et la réjouissaient certainement, parce qu’elle pensait que la Mère les agréait et ce fut pour elle un gros crève-coeur lorsqu’on reporta la statue dans son sanctuaire recrépi à neuf.
La Vierge partit, mais elle chargea l’ange gardien de Lydwine de la lui conduire plus souvent, dans le Paradis.
Elle la traitait alors, en enfant qu’on gâte, la questionnait et s’amusait de l’ingénuité de ses réponses.
Une nuit, elle lui dit, d’un ton sérieux :
— Comment se fait-il, ma chère petite, que vous soyez arrivée, ici, dans une tenue si négligée ? Vous n’avez même pas sur le front un voile !
— Ma chère dame Marie, balbutia Lydwine inter. dite, mon ange m’a emmenée telle que j’étais ; je n’ai, du reste, à la maison, ni robe, ni voile, puisque je suis toujours couchée !
— Eh bien, proposa en souriant la Vierge, voulezvous que je vous donne ce voile-ci ?
Lydwine contemplait ce voile que lui tendait la Mère ; elle mourait d’envie de l’accepter ; mais elle craignit de déplaire à jésus, en contentant son propre désir et elle interrogea du regard son ange qui détourna les yeux.
De plus en plus intimidée, elle murmura : Mais il me semble, bonne Vierge, que je n’ai pas le droit de manifester une volonté, et elle implora encore d’un coup d’oeil son ange ; il lui répliqua cette fois par ces mots qui ne firent qu’accroître son embarras :
— Si vous souhaitez de posséder ce voile, prenez-le.
Elle savait de moins en moins à quoi se résoudre quand la Madone mit fin, en riant, à sa gêne.
— Allons, dit-elle, je vais le placer moi-même sur votre tête, mais écoutez-moi bien ; de retour sur la terre, vous le garderez chez vous pendant sept heures ; ce après quoi vous le confierez à votre confesseur, en le priant de le fixer sur le chef de ma statue dans l’église paroissiale de Schiedam.
Et, après cette recommandation, Notre-Dame disparut.
Revenue de son extase, Lydwine se tâta le front pour s’assurer qu’elle n’avait pas été le jouet d’une illusion ; le voile y était ; elle le retira et l’examina. Il paraissait vraiment tissé avec les fils de la Vierge, tant sa trame était fine ; sa couleur était d’un vert d’eau très pâle et il exhalait une odeur à la fois pénétrante et ténue, exquise.
Tout en le considérant, Lydwine s’était si bien absorbée dans ses actions de grâce, qu’elle avait absolument perdu la notion du temps ; elle s’avisa tout à coup que le terme des heures déterminé par Marie pour conserver ce présent, allait expirer.
Aussitôt et bien que le jour ne fût pas encore éclos, elle fit appeler Jan Walter et lui raconta sa vision.
Il palpait, stupéfié, le voile.
— Mais, s’écria-t-il, vous n’y songez pas, la nuit est très noire, l’église est fermée et je n’en ai pas les clefs ; en admettant, du reste, que je puisse y pénétrer, cela ne servirait de rien puisque je ne saurais atteindre, dans l’obscurité, le sommet de la statue qui domine l’autel et qui est, par conséquent, très haut ; attendons donc, si vous le voulez bien, que l’aube nous éclaire et j’irai.
— Non, non, repartit la sainte ; l’ordre que j’ai reçu est formel ; ne vous inquiétez pas d’ailleurs de tous ces détails ; l’église s’ouvrira, la lanterne que vous avez allumée pour venir ici vous fournira une clarté suffisante pour découvrir, appuyée contre le mur latéral, au nord du sanctuaire, une échelle ; une fois monté dessus rien ne vous sera plus facile que de coiffer la statue ; partez donc, je vous en prie, mon père, sans différer.
Walter s’en fut réveiller le sacristain qui lui ouvrit la porte de l’église et il trouva aussitôt l’échelle à la place indiquée par sa pénitente.
— Que voulez-vous faire ? demanda le sacristain, étonné de lui voir déranger l’échelle.
— Vous ne pouvez le comprendre maintenant, répliqua le prêtre, mais Dieu vous l’expliquera par la suite.
Cet homme, pressé de regagner son lit, ne prêta que peu d’attention à cette réponse et s’éloigna.
Walter s’acquitta de la commission, puis il s’agenouilla devant la statue et pria ; lorsqu’il fut sur le point de se retirer, il voulut admirer une dernière fois la délicate élégance de ce voile, mais il n’y était déjà plus. L’ange l’a aussitôt ravi, racontait plus tard Lydwine à la veuve Simon qui l’interrogeait pour savoir ce qu’il était devenu.
Ces relations de la sainte avec la Madone étaient continuelles ; dans ses abominables nuits d’insomnies et de fièvre, alors que la malade se retenait pour ne pas réveiller, en criant, son neveu et sa nièce couchés dans la chambre, elle apercevait soudain, penchée sur son lit, la Vierge qui relevait son oreiller et la bordait ; et elle s’apaisait, heureuse, et remerciait, confuse.
Entendait-elle parfois aussi les douces plaintes de la Mère au Fils ? Car il est impossible de ne pas se figurer la compassion de Marie devant le cumul de tant de maux ! Certes, Celle dont le coeur éclata sous la pression des glaives, savait la nécessité de ces atroces souffrances, mais elle était trop tendre pour ne point avoir pitié du martyre de sa pauvre fille. Et il semble qu’on la voit implorer la miséricorde du Christ qui sourit tristement et lui dit :
— O Mère, rappelez-vous, sur le Calvaire, cette croix qu’en leur satanique orgueil les hommes voulurent créer plus grande que leur Dieu ; rappelez-vous qu’elle fut plus haute et plus large que mon corps qui ne l’a pas emplie ; les bourreaux ont laissé dans ce cadre de bois dont ils m’entourèrent des vides que, seuls, des monceaux de tortures peuvent combler ; et c’est précisément parce qu’il y reste de la place pour souffrir que j’ai donné à mes saints l’irrésistible attrait de l’occuper et d’y achever à leurs dépens les tortures de la Passion ; puis pensez que si Lydwine n’expiait pas des fautes dont elle est innocente, une multitude de vos autres enfants serait damnée ! — Mais cela n’empêche que notre fille a, pour cette nuit, assez souffert ; prenez-la donc dans vos bras pour l’endormir aux tourments de la terre.
Et la sainte Vierge dorlotait Lydwine qu’elle remettait, ravie, à son ange, pour la promener dans les jardins du ciel.
Une autre fois, pendant une nuit de Noël, elle fut brusquement transportée au Paradis et elle y fut, de même que la vénérable Gertrude d’Oosten, cette béguine hollandaise qui l’avait précédée dans la voie des holocaustes, l’objet d’une singulière grâce.
Cette grâce lui avait été annoncée d’avance, mais elle ne l’avait pas révélée à ses intimes. Or, la veuve Catherine Simon qui habitait maintenant avec elle, eut un songe pendant lequel un ange lui décela que son amie recevrait, dans la nuit de la Nativité, un lait mystérieux qu’elle lui permettrait de goùter.
Elle en parla à Lydwine qui, par humilité, répondit évasivement ; mais elle revint à la charge et, lassée par le vague de ses répliques, finit par s’exclamer : Savezvous, ma mie, que c’est un peu fort que d’oser nier ce qu’un ange m’a appris !
Alors, la sainte avoua qu’elle était, elle aussi, prévenue de ce miracle et elle invita Catherine à se préparer par la confession et la prière à la réception de cette faveur.
Et pendant la nuit de la Théophanie, Lydwine, saisie par l’emprise divine, perdit l’usage de ses sens et son âme s’envola dans l’Eden.
Là, elle fut admise, comme tout naturellement, au milieu d’une nuée de vierges vêtues de blanc, coiffées de fleurs fabuleuses ou couronnées de cercles d’or ponctués de gemmes ; toutes tenaient à la main des palmes et dessinaient un demi-cercle au centre duquel Marie siégeait sur un trône étincelant que l’on eût cru sculpté dans des éclairs solidifiés, dans des foudres durcies ; et des multitudes d’anges se pressaient derrière elles.
Tous ces purs Esprits, Lydwine les contemplait, sous un aspect humain, mais seuls les contours existaient sous la neige plissée des robes ; ces corps glorieux n’étaient emplis que d’une pâle lumière qui fluait des yeux, de la bouche, du front, s’irradiait derrière la nuque en des nimbes d’or ; et de cette foule agenouillée, les mains jointes, des adorations s’élevaient éperdues vers la Maternité de la Vierge, des adorations où le verbe liturgique fusait en une flore de flammes, d’un feuillage de senteurs et de chants.
De grands séraphins brûlaient, détachant de harpes en feu des perles embrasées de sons ; d’autres tendaient ces coupes d’or, pleines d’essences embaumées qui sont les prières des Justes ; d’autres versellaient les psaumes messianiques et chantaient, en des choeurs alternés, de transportantes hymnes ; d’autres, enfin, près de l’Archange debout, à la droite de l’autel des Parfums, activaient l’ignition des olibans, tissaient avec des fils de fumée bleue les langes chauds dont ils allaient envelopper, en l’encensant, la nudité frileuse de l’Enfant.
En hâte, ils préparaient, car l’instant de la délivrance était proche, la layette nébuleuse des aromes, l’odorant trousseau du Nouveau-Né.
Lydwine retrouvait dans le ciel les formules d’adoration, les pratiques cérémonielles des offices qu’elle avait, ici-bas, lorsqu’elle était bien portante, connues ; l’Église militante avait été, en effet, initiée par l’inspiration de ses apôtres, de ses papes et de ses saints, aux joies liturgiques du Paradis ; en une déférente imitation, elle répétait le langage réduit des louanges ; mais quelle différence entre ses émanations et ses chants et les accords vertigineux de ces harpes, la puissance et la subtilité de ces fragrances, le zèle fulgurant de ces voix !
Lydwine écoutait et regardait, ravie ; et à mesure que l’heure de la Nativité s’avançait, les accents de la psallette des anges, les exhalaisons des encensoirs et des coupes, les vibrations des cordes se faisaient plus implorants et plus doux ; et quand l’heure sonna dans les beffrois divins, quand Jésus apparut, radieux, sur les genoux de sa Mère, quand un cri d’allégresse traversa les vapeurs sacrées des thuribules et les rumeurs extasiées des harpes, le lin des chastes tuniques des Vierges s’ouvrit et, en d’intarissables flots, le lait jaillit.
Et la bienheureuse fut traitée de même que ses compagnes ; l’Enfant laissait ainsi comprendre, affirme A Kempis, qu’il les associait à l’honneur de la Maternité céleste ; il signifiait, de la sorte, dit, de son côté, Gerlac, que toutes les Vierges étaient aptes à nourrir le Sauveur.
La pauvre Lydwine, elle ne se possédait plus de bonheur, maintenant ! elle était si loin de sa géhenne mortelle ! — Et déjà cependant la vision s’effaçait ; il ne restait plus sur un firmament de nuit que l’immense trajectoire de ce lait qu’éclairaient, par derrière, des milliers d’étoiles.
L’on eût dit d’une autre voie lactée, d’une arche de neige saupoudrée d’une poussière d’astres !
L’entrée dans la chambre de Catherine Simon impatiente de voir se réaliser la promesse de son rêve, ramena Lydwine à elle-même et lorsque son amie lui réclama du lait, elle toucha de sa main gauche la fleur de son sein et le lait qui avait disparu avec son retour ici-bas, revint et la veuve en but par trois fois et ne put, pendant plusieurs jours, prendre aucune nourriture. Tout aliment naturel lui semblait d’ailleurs, en comparaison de cet extraordinaire sue, de bouquet plat et de saveur fade : et cette scène se renouvela, d’autres années, à cette même époque de Noël.
Brugman assure que le confesseur Jan Walter obtint la même faveur que Catherine et qu’il but de ce lait ; mais Gerlac atteste, au contraire, qu’il ne put joindre en temps opportun sa pénitente et qu’il ne profita point de cette grâce.
Si l’on recense les étonnants miracles dont foisonne cette vie menée en partie double, saturée de souffrances lorsqu’elle se passe sur la terre, débordée de joie lorsqu’elle s’évade dans l’Éden ; si l’on récapitule les exceptionnels privilèges dont le Seigneur combla Lydwine ; si l’on envisage enfin la somme énorme de ses bienfaits, l’on n’est pas loin de croire qu’à force de se dévouer pour les autres, de prier et de pâtir, la bienheureuse avait atteint la cime de la vie parfaite.
Elle n’en était malheureusement pas pour elle encore là ; des échelons n’étaient pas gravis. La terrible remarque sur laquelle saint Jean de la Croix ne cesse d’insister, dans la « Montée du Carmel » qu’une attache quelconque, lors même qu’elle ne constituerait que la plus petite des imperfections, obscurcit l’âme et fait obstacle à sa parfaite union avec Dieu, s’appliquait, malgré tout, à elle. Elle s’appartenait encore trop ; elle possédait le déchet d’une qualité, la tare d’une vertu, elle était trop liée aux siens, elle les aimait trop.
Il sied de dire, à sa décharge, que, si avancée qu’elle fût dans les voies du Seigneur, il lui était bien difficile de se rendre compte par elle-même des limites qu’il lui était interdit de franchir ; à l’âme qui le cherche, le point de repère se montre à peine, car il se dissimule sous les subterfuges les plus avantageux, sous les prétextes les plus vraisemblables.
Dieu ne défend pas, en effet, d’aimer les siens, au contraire — ce qu’il défend à ceux sur lesquels il a mis l’empreinte de ses serres, à ceux qu’il désire expulser d’eux-mêmes pour qu’ils ne puissent vivre qu’en Lui, c’est cette incontinence de l’affection humaine qui refoule, en les contrecarrant, ses amoureux desseins ; — mais la pauvre âme qui, sans défiance, s’abandonne à ces excès les rapporte ou croit les rapporter à son Créateur qu’elle entretient constamment de ceux qu’elle aime ; elle le prie pour eux et elle estimerait ne pas remplir son devoir envers Lui et manquer à la charité envers eux si elle n’agissait pas de la sorte. Elle s’imagine en un mot les aimer en Lui et elle les aime autant sinon plus que Lui ; son intention est donc bonne quand elle veut imposer à son maitre une association d’amitiés, un partage qui ne tend à rien moins qu’à le bannir de ses propres domaines.
Il y a là une erreur que suscite l’Esprit de Malice car, ainsi que l’exprime, en des termes définitifs, dans son Traité de la vie spirituelle et de l’oraison, Mme l’abbesse de Sainte-Cécile de Solesmes, « le Démon aime les violences, tout ce qui est poussé à l’outrance, même dans le Bien ».
Et c’est le chef-d’oeuvre de son art que de détruire une vertu en l’exaltant !
Or, c’est ce qui advint à Lydwine ; elle n’avait pu se dépouiller de cette intempérance de tendresse qui lui avait déjà attiré, lors du décès de son frère, des remontrances. Depuis cette mort, sa dilection s’était accrue pour ses deux petits gardes-malade, son neveu et sa nièce, et le Seigneur la frappa, en plein coeur, en lui supprimant Pétronille ; cette jeune fille avait alors dix-sept ans et depuis qu’elle avait été blessée par les Picards, en voulant secourir sa tante, elle boitait et languissait, n’avait jamais pu parvenir, malgré les traitements des meilleurs médecins, à se rétablir.
Une nuit, Lydwine, ravie en esprit, aperçut une procession qui sortait de l’église de Schiedam ; en une lente théorie, cheminaient sur deux lignes, précédés des cierges et de la croix, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saintes femmes, les personnages du Commun des saints ; ils se dirigèrent du sanctuaire vers sa maison, y firent la levée d’un corps exposé à la porte et l’accompagnèrent à l’église.
Et elle-même se voyait derrière le convoi, avec trois couronnes ; une sur la tête, et une dans chaque main.
Et le rêve s’évanouit.
Lorsqu’elle eut repris ses sens, Lydwine pensa tout d’abord que cette vision la concernait et qu’elle était le présage de sa fin ; mais elle fut détrompée par Jésus qui lui révéla que ce simulacre se référait à sa nièce et il lui indiqua, en même temps, le jour et l’heure où Pétronille naîtrait au ciel.
Lydwine sanglotait, accablée ; elle réagit pourtant en songeant à l’agonie de celle qu’elle aimait comme une fille et elle s’écria : Ah ! Seigneur, accordez-moi au moins dans ma détresse une grâce ; cette heure que vous me désignez est une de celles où je dois être rongée par cette fièvre qui se rallume, vous le savez, à des heures fixes ; et alors, je ne suis plus bonne à rien, incapable de toute attention, de tout effort ; je vous en supplie, réglez autrement la marche de mon mal, afin que je sois en état d’assister ma pauvre Pétronille, lorsque le moment de me séparer d’elle sera venu.
Jésus exauça cette prière et, au grand étonnement de ceux qui soignaient la sainte, l’accès si précis d’habitude fut anticipé de six heures et sa durée fut moins longue que de coutume.
A peine en fut-elle délivrée, que Pétronille entra en agonie et Lydwine, qui la voyait toute tremblante, put la soutenir et prier avec elle ; et elle mourut peu après et alla recevoir les trois couronnes que sa tante portait, en son ravissement : l’une à cause de la virginité de son corps, l’autre à cause de sa chasteté spirituelle, la troisième enfin à cause même de cette blessure que des chenapans de la Picardie lui firent.
Lydwine s’était jusqu’à ce moment roidie contre sa peine ; elle avait écouté, navrée, la sentence du Seigneur, mais elle n’avait pas faibli tant qu’il s’était agi de réconforter sa nièce ; elle avait refoulé ses larmes et adouci, par son apparente fermeté, les derniers moments de la petite ; mais lorsque celle-ci fut inhumée, sa vaillance tomba ; elle succomba à la douleur et ne cessa de pleurer ; et, au lieu de s’atténuer avec le temps, son chagrin s’aggrava ; elle le cultiva, le nourrit de ses regrets sans cesse présents, se submergea en lui de telle sorte que Jésus, délaissé, se fâcha.
Il ne lui adressa aucun reproche, mais il s’éloigna.
Alors, ce fut, ainsi qu’à ses débuts, dans la vie purgative, l’angoisse de l’âme prisonnière dans les ténèbres ; rien, pas même le pas furtif du geôlier qui rôde dans les alentours, mais un silence absolu dans une nuit noire.
Ce fut l’in-pace de l’âme, enchaînée dans un corps perclus ; forcément, dans cette solitude, elle dut se replier sur elle-même et se chercher ; mais elle ne trouva plus en elle que des ruines d’allégresse, que des décombres déshabitées de joie ; une tempête avait tout jeté bas ; elle ne put devant ces débris de ses aitres que se susciter l’amer souvenir du temps où l’Époux daignait les visiter ; et ce qu’elle était heureuse alors de servir son Hôte, de s’empresser autour de Lui et comme Il payait, au centuple, ses pauvres soins ! Ah ! ce logis que les anges l’aidaient à préparer pour accueillir le Bien-Aimé, il en subsistait quoi, maintenant ? Il avait suffi d’un instant d’inadvertance, d’une minute d’oubli pour que tout croulât !
Elle se tordait de désespoir et, sous la force expansive de la douleur, l’âme se brisa et ce fut affreux.
Cependant, si l’on y réfléchit, cette détresse ne put être la même que celle qu’elle subit, lorsqu’elle préluda dans les voies du douaire mystique ; elle s’en rapproche certainement, mais elle en diffère par certains points ; dans la première qui est évidemment cette « Nuit obscure » que saint Jean de la Croix a si merveilleusement décrite, il y a, en outre des sécheresses, des aridités, du chagrin issu des dérélictions et du délaissement intérieur, une sorte de peine du dam ; l’on s’imagine, en effet, que cet état durera toujours, que l’abandon du Seigneur est irrémissible ; et cela, c’est épouvantable ; il faut avoir été tenaillé par cette angoisse dont rien ne peut donner une idée, pour se douter de ce que souffrent, dans l’Enfer, les damnés.
Or, Lydwine avait vu de trop près le Seigneur pour appréhender une telle infortune ; elle se savait assez aimée pour être certaine que son repentir désarmerait le mécontentement de l’Époux ; d’autre part, elle n’était pas non plus, comme à ses débuts, dans l’impossibilité de se recueillir et de prier ; elle se recolligeait sans goût, elle priait sans ressentir de douceurs sensibles, mais elle pouvait quand même, et sans s’éparpiller, prier ; c’était une faible lueur, un rayon bien lointain qui pénétrait dans l’ombre de sa geôle, mais enfin, si pâle qu’elle fût, cette clarté attestait une attention, avérait une pitié, prouvait qu’elle n’était pas complètement répudiée, définitivement omise. Elle était, en somme, dans la situation d’une âme au Purgatoire qui souffre mais attend avec résignation sa délivrance.
Et néanmoins, quelle misérable existence était la sienne ! ses tortures corporelles étaient devenues sans contrepoids ! aucun relai pour les modérer, aucune halte pour les amortir ; littéralement, elles la saccagèrent ; la nature, privée de son soutien supernel, livrée à elle-même, éclata en cris déchirants et Lydwine vomit le sang à pleine bouche.
En vain, Jan Walter, qui lui était si dévoué, tentait de la consoler ; elle éprouvait une lassitude des conseils, un dégoût de tout.
Effrayée de la voir ainsi déprimée, sa fidèle Catherine, installée à son chevet, s’écria, désespérée, un jour : Mais enfin, mon Dieu, que se passe-t-il donc ici ?
A ce moment, plus calme, Lydwine répondit :
— C’est à cause de mes péchés que vous me voyez si malheureuse ; j’ai perdu par ma faut, tout attrait spirituel, même lorsque je communie. Je n’ai plus ni ravissements, ni lumière prophétique, ni réconfort, rien. Le Seigneur ne m’a laissé, pour me soulager, que la faculté de pouvoir méditer, ainsi qu’autrefois, sa vie sans m’évaguer ; mais je n’y découvre plus aucune aise. Il me semble que je suis déportée sur une terre de glace, dans une région inconnue que rien n’éclaire et où je ne suis nourrie qu’avec de la myrrhe et du fiel.
Cette épreuve dura cinq mois ; puis, un 2 juillet, fête de la Visitation de la Très-Sainte Vierge, les pans de nuit qui muraient l’âme de la sainte tombèrent ; le jour jaillit à flots et Jésus parut.
Ce ne fut qu’un élan et qu’un cri ; l’âme se jeta, éperdue, à ses pieds et il la releva et la serra tendrement contre Lui. Elle défaillit de bonheur et, pendant près de dix jours, vécut hors d’elle-même, au-dessus du temps, au delà des images et loin des formes, immergée, comme absorbée dans l’océan de la divine Essence. Si elle n’eût respiré, ses amis l’auraient crue morte.
Mais ce qui les émerveilla plus que tout, ce fut une odeur nouvelle qui s’échappa de ses stigmates et de ses plaies. Cette senteur si particulière, unique dans les monographies des saintes, cette senteur qu’elle seule exhalait depuis des années et qui était telle qu’une quintessence des aromates de l’Inde et des épices du Levant s’évanouit et fut remplacée par une autre et celle-là rappelait, mais épurée, mais sublimée, le parfum de certaines fleurs coupées fraîches. Brugman raconte, en effet, qu’elle expirait, au plus fort de l’hiver, des effluves tantôt de rose, tantôt de violette et tantôt de lys.
Ces émanations moins rares, nous les retrouvons, avant et après Lydwine, chez d’autres saints. Rose de Viterbe, qui vécut au treizième siècle, dégageait en effet l’odeur de la rose et sainte Catherine de Ricci et sainte Térèse, qui vécurent au seizième siècle, fleuraient, l’une la violette et l’autre la violette et le lys, symboles de l’humilité et de la chasteté.
Ce changement eut lieu, alors qu’elle s’était entièrement dépossédée et alors que le terme de ses jours était proche ; il semblait que le souffle printanier des floraisons succédant au fumet hivernal des épices conservées et des coques sèches annonçât la fin de son hiver terrestre et l’arrivée de cet éternel printemps dans lequel elle allait, après sa mort, entrer.
Sa chambre embaumait à un tel point que toute la ville défila chez elle pour respirer ce bouquet.
— Qu’est cela ? nous n’avons jamais rien humé de pareil, s’écriaient les badauds, et Lydwine répondait :
— Dieu seul le sait ; quant à moi, je ne suis qu’un pauvre être et il m’a fallu bien des châtiments pour me faire comprendre combien j’étais encore sujette aux infirmités de la nature humaine ; louez le Seigneur et priez-le pour moi !
N’est-il pas utile de remarquer, à ce propos, que les hagiologes ne contiennent guère de biographies qui soient plus odorantes que celle de Lydwine ? Je n’en connais, pour ma part, aucune où la bénéolence divine s’affirme ainsi, à chaque page. Outre que la bienheureuse était une cassolette vivante, toutes les fois que Notre-Seigneur, que sa Mère, que ses anges venaient la visiter, ils laissaient, en partant, des traces flagrantes de leur passage et les personnes même que Lydwine conduisait avec elle dans le Paradis, y étaient saturées de célestes effluences qui leur enivraient l’âme et en guérissaient les maux.
XIV
DE toute la famille de Lydwine, qui fut nombreuse, il ne restait plus, pour habiter avec elle et la veiller, qu’un neveu, âgé de douze ans. Des huit frères qu’elle avait, deux étaient morts, Wilhelm, le père de Pétronille et de Baudoin, et cet autre Baudoin dont le nom nous a été révélé par une vision de la sainte. Les six autres étaient-ils aussi décédés ou résidaient-ils au loin ? on l’ignore ; en tout cas, aucun ne nous est signalé comme s’étant jamais occupé de sa soeur.
Baudoin, son neveu, était un petit garçon, sage et pieux, que l’on se figure aisément tel que tant d’enfants du peuple en Hollande, un blondin, un peu massif, avec une face ronde, rendue avenante par de bons yeux ; il menait, en somme, une assez triste existence, car, au lieu de jouer avec les gamins de son âge sur la place, il devait demeurer silencieux, dans une chambre, attentif à contenter les désirs d’une malade. Sa tante voulut lui manifester sa gratitude pour son dévouement et ses soins et elle le fit d’une façon singulière ; craignant peut-être qu’il ne fût, quand elle ne serait plus là, tenté par des doutes contre la foi, elle souhaita qu’il ne pût oublier les surprenantes merveilles dont il était le témoin, dans cette maison hantée par Notre-Seigneur, par sa mère et par les anges, et la grande Douloureuse qu’elle était pensa que, seule, la souffrance serait assez forte pour frapper l’imagination de l’enfant et y sceller à jamais le souvenir de tant de grâces.
Elle pria, en conséquence, le Sauveur de lui envoyer un accès de fièvre qui ne mît point ses jours en danger, mais qui lui rappelât, par la suite, le temps où il vivait auprès d’elle.
Sa requête fut exaucée.
Un soir, vers la fête de la Nativité de sainte Marie, Lydwine demanda à son neveu, qui tenait à la main une cruche de petite bière, de la déposer sur une table, au chevet de son lit. Baudouin obéit et la cruche passa là la nuit. Le lendemain, cette bière s’était changée en un élixir aromatisé avec les fougueuses écorces d’idéales cannelles et les zestes éveillés de fabuleux cédrats.
Plusieurs personnes en goûtèrent et cette liqueur les stimula de même qu’un cordial, mais l’enfant, en ayant bu quelques gouttes, fut aussitôt appréhendé par une fièvre qui ne le quitta pas avant la saint-Martin.
Après qu’il eut été rétabli, ce fut le tour de Jan Walter d’être malade ; lui, fut féru d’une fièvre intermittente dont les accès correspondaient à ceux de Lydwine, ce que voyant, l’une de ses soeurs, nommée Cécile, s’enquit auprès de la sainte pour savoir combien de jours cette maladie durerait. — Jusqu’au dimanche de Carême, répondit-elle. — Et Walter recouvra, en effet, la santé à cette époque. Plus tard, il fut encore atteint d’une affection, mais si grave celle-là, que tous ses amis le crurent perdu, tous, sauf Lydwine qui, après avoir harcelé le ciel de suppliques, obtint sa guérison.
Elle éliminait par ses prières les tortures des autres, mais les siennes augmentaient d’autant. Elle approchait de sa fin. En nous racontant l’histoire de son neveu, Gerlac nous laisse entendre qu’elle eut lieu, l’année même de sa mort ; mais Thomas A Kempis antécède d’une année, et la reporte par conséquent à l’an 1432.
Ce qui est certain, c’est que ses moments étaient maintenant comptés et Dieu la paracheva dans sa mission de victime réparatrice, en l’écrasant sous une dernière avalanche de maux. Elle n’avait plus une partie du corps qui fût indolore et cependant il découvrit des places de douleurs presque vides et il les emplit. Il la frappa d’attaques d’épilepsie et elle en eut jusqu’à trois par nuit. Avant la première, elle prévint ses intimes pour qu’ils eussent à la maintenir et à l’empêcher de se briser le crâne contre les murs.
— C’est très bien, répliquèrent-ils, mais il serait mieux de détourner ces assauts que vous nous annoncez en suppliant le Seigneur de vous en préserver ; vous avez assez de maladies sans encore y adjoindre celle-là ; mais elle les blâma de juger des volontés de Dieu.
Bientôt, aux furies du haut-mal vinrent s’ajouter des crises de démence ; seulement elles furent très courtes ; elles sévirent juste assez pour qu’il fût dit, qu’excepté la lèpre, aucune maladie ne lui avait été épargnée ; elle fut encore terrassée par un coup d’apoplexie dont elle se releva, mais les névralgies et les rages de dents ne cessèrent Plus ; un nouvel ulcère lui rongea le sein ; enfin depuis la fête de la Purification jusqu’à Pâques, la gravelle lui suscita des tourments terribles et elle eut de telles contractions de nerfs que ses membres déplacés se mêlèrent ; elle devint quelque chose de bizarre, d’informe d’où dégouttaient du sang et des larmes et d’où sortaient des cris.
Elle souffrait le plus impitoyable des martyres, mais elle embrassait maintenant, dans son ensemble, la tâche qu’elle était chargée d’accomplir.
Jésus lui exhibait, en une épouvantable vision, le panorama de son temps.
L’Europe lui apparaissait convulsée — comme elle-même l’était, — sur le lit de son sol et elle cherchait à ramener, d’une main tremblante, sur elle, la couverture de ses mers pour cacher son corps qui se décomposait, qui n’était plus qu’un magma de chairs, qu’un limon d’humeurs, qu’une boue de sang ; car c’était une pourriture infernale qui lui crevait, à elle, les flancs ; c’était une frénésie de sacrilèges et de crimes qui la faisait hurler, ainsi qu’une bête qu’on assassine ; c’était la vermine de ses vices qui la dépeçait ; c’étaient des chancres de simonie, des cancers de luxure qui la dévoraient vive ; et terrifiée, Lydwine regardait sa tête tiarée qui ballottait, rejetée tantôt du côté d’Avignon, tantôt du côté de Rome.
Vois, fit le Christ, et, sur un fond d’incendies, elle aperçut, sous la conduite de fous couronnés, la meute lâchée des peuples. Ils s’égorgeaient et se pillaient sans pitié ; plus loin, en des régions qui semblaient paisibles, elle considéra les cloîtres bouleversés par les brigues des mauvais moines, le clergé qui trafiquait de la chair du Christ, qui vendait à l’encan les grâces du Saint-Esprit ; elle surprit les hérésies, les sabbats dans les bois, les messes noires.
Elle serait morte de désespoir si, pour la consoler, Dieu ne lui avait aussi montré la contre-partie de ce siècle, l’armée des saints en marche ; ils parcouraient sans s’arrêter le monde, réformaient les abbayes, détruisaient le culte de Satan, mataient les peuples et refrénaient les rois, passaient, en dépit de tous les obstacles, dans des tourbillons de crachats et de huées ; et tous, qu’ils fussent actifs ou contemplatifs, souffraient, eux aussi, aidaient à acquitter par leurs oraisons et leurs tortures la rançon de tant de maux !
Devant l’immensité de la dette, elle s’estimait si pauvre ! qu’étaient ses infirmités et ses afflictions, en face de cette marée d’ordures ? une goutte d’eau à peine ; et elle suppliait le Seigneur de ne plus la ménager, de se venger sur elle de ce monceau d’offenses !
Elle savait que le terme de son existence était proche et elle craignait maintenant de n’avoir pas rempli sa mission, d’avoir été trop heureuse ; elle se jugeait une ouvrière improductive qui n’apportait à la ruche des douleurs qu’un infime butin, qu’une faible part ; et, cependant, l’infortunée, ce qu’à certains moments, elle était lasse, lorsque, descellée de ses extases, elle retombait dans sa pauvre chambre ! mais des apparitions la réconfortèrent.
Un jour qu’elle était dans le ravissement, elle rencontra son grand-père, à la porte du Paradis.
— Ma très douce fille, lui dit-il, je ne puis vous permettre d’entrer dans ce lieu du perdurable repos, car ce serait une calamité pour ceux qui ont besoin de vos services ; vous avez encore des péchés d’autrui à compenser, des âmes du Purgatoire à affranchir ; mais consolez-vous, ma chère enfant, ce ne sera plus long.
Une autre fois, son ange lui désigna un rosier qui avait la stature d’un arbre et qui était couvert de boutons et de fleurs et il lui expliqua qu’elle ne serait libérée de la peine de la vie que lorsque toutes les roses seraient épanouies.
— Mais enfin, lui demandèrent Jan Walter et la veuve Catherine Simon : reste-t-il encore beaucoup de boutons à éclore ?
— Toutes les roses sont actuellement ouvertes, sauf une ou deux, fit-elle ; aussi ne tarderai-je pas à vous quitter.
Elle dit également à un prieur des chanoines réguliers qu’elle semble avoir tenu en une particulière estime :
— Je vous serai reconnaissante, mon cher père, de revenir encore me voir après Pâques ; cependant, si Dieu me retirait de ce monde avant votre visite, je recommande mon âme à votre charité, n’est-ce pas ?
Le prieur conclut de cette restriction qu’elle ne chanterait pas l’alléluia sur la terre, à cette époque ; et, elle-même, finit par avouer à ses intimes qu’elle trépasserait pendant le temps Paschal, mais elle ne leur précisa ni le jour, ni l’heure, parce qu’elle voulait s’en aller, seule, sans autre assistance que celle de Jésus.
— Et votre maison, que deviendra-t-elle, après votre décès ?
— Rappelez-vous, fit-elle à ses amis qui lui posaient cette question, rappelez-vous ce que je répliquai à un bon Flamand lorsque, touché de ma détresse, il m’offrit de me bâtir un refuge plus commode : Tant que je vivrai je n’aurai pas d’autre logement que celui-ci ; mais si, après ma mort, quelqu’un veut convertir cette triste demeure en un hôpital pour les indigents, je prie d’avance le Seigneur de le récompenser.
Ce fut là, elle le savait, une parole prophétique, qu’un pieux médecin, Wilhelm, le fils de ce brave Godfried de Haga, dit Sonder-Danck, qui l’avait soignée dans sa jeunesse, accomplit, après son trépas.
Et à quelqu’un qui, comprenant qu’elle s’attendait à prochainement mourir, l’interrogeait pour connaître si Dieu opérerait des miracles sur sa tombe, elle repartit :
— Je n’ignore pas que des âmes simples s’imaginent que ma disparition s’accompagnera de phénomènes extraordinaires, elles se trompent absolument ; quant à ce qui doit survenir après mon enterrement, Dieu seul le sait et je n’ai nulle envie d’être renseignée sur ce point. Je désire seulement que mes amis n’exhument pas mes restes avant que trente années ne se soient écoulées, depuis le jour de ma sépulture et que mon corps qui n’a pas touché la terre pendant trente-trois ans, ne l’effleure même pas dans sa bière ; je voudrais enfin que mes obsèques se fissent sans aucun retard.
Telles furent ses dernières volontés ; elle les communiqua aux intimes qui l’entouraient ; ils ne doutèrent plus, en l’entendant s’exprimer de la sorte, que sa fin ne fût imminente ; ils en furent plus certains encore, lorsque, les ayant tous réunis autour de son grabat, elle leur dit :
— Je vous conjure de me pardonner les peines que j’ai pu vous causer ; ne me refusez pas ce merci que je sollicite pour l’amour de Dieu ; de mon côté, je le prie et le prierai bien pour vous.
Tous fondirent en larmes, protestant que loin de les avoir jamais offensés, elle les avait, au contraire, grandement édifiés par sa bonté et sa patience.
Enfin, le jour de Pâques fleuries vint. Lydwine sortit de sa réserve avec l’Époux. Il l’inondait de telles délices qu’elle se pencha sur son coeur et murmura : Oh ! je suis lasse de vivre, enlevez-moi d’ici-bas, mon Seigneur, enlevez-moi !
Jésus sourit et la Vierge et les douze Apôtres et une multitude d’anges et de saints parurent derrière Lui. Jésus se mit à la droite de Lydwine et Marie à sa gauche ; tout près du Christ, une table jaillit sur laquelle étaient une croix, un cierge allumé et un petit vase ; les anges s’approchèrent du lit et découvrirent la patiente. Alors, le Sauveur prit le petit vase qui contenait l’huile des infirmes et il fit les onctions accoutumées, sans proférer un mot ; les anges la recouvrirent ; Jésus lui plaça le cierge dans la main et posa le crucifix sous ses yeux et il y demeura visible pour elle seule, jusqu’à sa mort.
Lydwine lui dit alors humblement :
— Mon doux Maître, puisque vous avez daigné vous abaisser jusqu’à la plus misérable de vos servantes ; puisque vous neavez pas eu le dégoût d’oindre mon malheureux corps avec vos très saintes mains, soyez indulgent jusqu’au bout. Accordez-moi cette dernière grâce de souffrir autant que je le mérite personnellement, afin qu’aussitôt exonérée de la vie, je sois admise, sans avoir à passer par le Purgatoire, à contempler votre suradorable Face.
Et Jésus répondit :
— Tes voeux sont exaucés, ma fille ; dans deux jours, tu chanteras l’alléluia avec tes soeurs les Vierges, dans le Paradis.
Lorsque le soleil fut levé, vers quatre heures du matin, son confesseur Walter la visita. Il avait été ravi en contemplation pendant la nuit et il avait vu Lydwine rayonnante de joie, parmi les anges ; la chambre embaumait quand il y pénétra.
— Oh ! s’écria-t-il, je sais que votre Époux part d’ici, mais ne l’aurais-je pas su, que je le devinerais rien qu’en aspirant ce fleur de l’Eden ! Vous a-t-il annoncé votre délivrance ? Ne me cachez rien, s’il se peut, chère soeur.
Transportée d’allégresse, elle s’exclama : mes souffrances vont redoubler, mais ce sera bientôt terminé !
Et, en effet, la gravelle et le charbon la supplicièrent, sans aucune trêve ; elle vécut le lundi de Pâques, dans d’épouvantables affres ; le mardi, elle s’apprêta à mourir et comme sa chambre était pleine de monde, elle dit doucement :
— Laissez-moi seule aujourd’hui avec le petit, elle désignait son neveu Baudouin, assis près du lit, — si vous êtes mes amis, faites cela pour moi ; soyez sans inquiétude d’ailleurs ; au cas où j’aurais besoin de vous, j’enverrais l’enfant vous prévenir.
Tous crurent qu’elle souhaitait de se recueillir et de prier en paix et, ne pensant pas que la mort la talon. nait, se retirèrent ; Jan Walter s’éloigna, à son tour, et s’en fut à l’église réciter les vigiles des trépassés pour la supérieure du couvent des soeurs Tertiaires qui venait de décéder ; à peine l’eut-il quittée, que l’agonie commença ; elle dura de sept heures du matin à quatre heures du soir ; les vomissements la déracinaient et la jetaient, brisée, sur le carreau ; elle rendait, avec des matières verdâtres, le fiel à pleine bouche ; Baudouin n’avait que le temps de vider la cuvette au dehors et de la rapporter.
— O mon enfant, dit-elle au petit qui pleurait, si le bon Walter voyait ce que je souffre !
Baudouin s’exclama : Tante, voulez-vous que j’aille le chercher ?
Elle ne répondit pas ; elle avait perdu connaissance.
Alors, l’enfant terrifié courut à toutes jambes à l’église qui était très peu distante de la chaumière, car l’on pouvait à peine réciter, en allant de l’une à l’autre, trois fois le psaume « Miserere ». Walter se hâta d’arriver et il trouva la sainte inanimée. Il espéra qu’elle n’était qu’insensibilisée par l’extase ; néanmoins il fit quérir toutes les amies de Lydwine qui, ne voulant pas, elles non plus, croire au décès et ignorant que le Seigneur lui avait, comme à saint Antoine de Padoue, donné, de ses propres mains, l’Extrême-Onction, lui demandèrent de leur faire connaître par un signe si elle ne désirait pas recevoir les derniers sacrements ; mais Lydwine ne bougeait plus ; alors Walter alluma une chandelle qu’il plaça derrière la tête de la sainte, de peur que la lumière ne lui blessât les yeux, si elle respirait encore et il l’examina de près ; le doute n’était plus possible, elle avait cessé de vivre.
Les femmes éclatèrent en sanglots, mais Catherine Simon, qui refoulait ses larmes, leur enjoignit de se taire.
— Voyons, fit-elle, si ce que Lydwine m’a souvent prédit, que ses mains se rejoindraient, après sa mort, s’est réalisé.
Son bras droit avait été, en effet, consumé par le feu des ardents et il ne tenait, depuis bien des années, que par un fil. Un chirurgien avait réussi, avec un pharmaque de sa composition, à le consolider, mais non à le guérir et à le mettre en état de remuer ; il était donc humainement impossible que les deux mains pussent se rapprocher l’une de l’autre et se toucher.
Catherine souleva la couverture et constata que les doigts des deux mains étaient enlacés sur la poitrine ; elle découvrit, stupéfiée aussi, que sa rude ceinture en crins de cheval ne lui ceignait plus les reins, mais qu’elle avait été pliée, sans que les cordons qui l’attachaient eussent été dénoués, et déposée près de ses épaules, par son ange sans doute, sur le chevet du lit.
J’ai palpé cette ceinture, raconte Brugman, j’ai humé le parfum qu’elle exhale et j’affirme que, m’en étant servi, dans des séances d’exorcisme, elle s’est révélée d’une puissance irrésistible contre les démons. Quant à moi, atteste, de son côté, Michel d’Esne, « je l’ai maniée de mes propres mains et ai vu par expérience que les diables l’ont en grande horreur et crainte ».
La nuit après la mort, Walter qui, harassé de chagrin, ne parvenait pas à s’endormir, aperçut l’âme de sa pénitente, sous la forme d’une blanche colombe dont le bec et la gorge étaient couleur d’or, les ailes du ton de l’argent, les pattes d’un rouge vif ; et Brugman explique de la sorte le symbolisme de ces nuances : l’or du poitrail et du bec signifiait l’excellence de ses enseignements et de ses conseils ; l’argent des ailes, l’essor de ses contemplations ; l’écarlate des pieds indiquait la marche de ses pas dans les traces sanglantes du Christ ; la candeur du corps allégorisait enfin l’éclatante pureté de la bienheureuse.
L’une des trois soeurs de Jan Walter, qui avaient veillé le cadavre, distingua à son tour l’âme de Lydwine, emportée au ciel par des anges, et Catherine Simon la vit entrer dans sa chambre, accompagnée d’un grand nombre de déicoles et elle participa au céleste festin des noces.
Toujours, en cette même nuit, elle se montra à des saintes filles qui l’aimaient sans la connaître, habillée de blanc, couronnée de roses par le Seigneur et menée au chant de la séquence « Jesu corona Virginum » qu’entonnèrent les Anges, au-devant de la sainte Vierge qui lui passa autour du cou un collier de gemmes en feu et la serra tendrement dans ses bras.
Le lendemain matin, dès l’aube, Walter se rendit à la maison mortuaire ; il s’agenouilla devant le lit et, le coeur défaillant de tristesse, pleura ; puis il se releva et dit à ses soeurs et à Catherine Simon : ôtez le voile qui couvre le visage de notre amie ; elles obéirent et ce ne fut qu’un cri.
Lydwine était redevenue ce qu’elle était avant ses maladies, fraîche et blonde, jeune et potelée ; on eùt dit d’une fillette de dix-sept ans qui souriait, endormie. De la fente du front qui l’avait tant défigurée, il ne subsistait nulle couture ; les ulcères, les plaies avaient disparu, sauf, cependant les trois cicatrices des blessures faites par les Picards ; elles couraient comme trois fils de pourpre, sur la neige des chairs.
Tous étaient, devant ce spectacle, béants et ils odoraient, sans pouvoir se lasser, une senteur inanalysable, si roborative, si fortifiante, qu’ils n’éprouvèrent, pendant deux jours et trois nuits, aucun besoin de sommeil et de nutriment.
Mais bientôt ce fut une foison de visites ; dès que le bruit se fut confirmé que la sainte était morte, non seulement les habitants de Schiedam, mais encore ceux de Rotterdam, de Delft, de Leyde, de Brielle, défilèrent dans la pauvre chambre.
A Kempis évalue à plusieurs milliers le nombre des pèlerins et, avec Gerlac et Brugman il narre qu’une femme de mauvaise vie ayant effleuré avec son chapelet le cou de la morte, l’on constata, après son départ, que les grains du chapelet s’étaient marqués, ainsi que des gouttes de poix, sur la peau, en noir ; pareil fait s’était produit, de son vivant, ajoutent les biographes, car lorsque ses doigts touchaient une main impure, ils se couvraient aussitôt de macules. Walter défendit alors aux visiteurs de frôler avec des objets de piété ou des linges la dépouille de la bienheureuse.
Il avait hâte d’ailleurs, pour satisfaire aux voeux de Lydwine, d’inhumer son corps, mais les magistrats de Schiedam s’y opposèrent. « L’on n’osait enterrer le cadavre, dit Michel d’Esne, d’autant que le comte de Hollande avait dit de le venir voir. »
N’est-il pas à observer, à ce propos, que tous les petits potentats de la Hollande fréquentèrent la sainte ? Nous avons noté ses relations avec Wilhelm VI, la comtesse Marguerite et avec le due Jean de Bavière. Philippe, due de Bourgogne et comte de Hollande, la connut évidemment, lui aussi, puisqu’il se proposait d’assister à ses funérailles. Seule, la légitime souveraine Jacqueline est absente de ce récit. Il est vrai qu’elle vécut, constamment évincée de ses domaines par la perfidie de ses oncles, qu’elle erra, chassé d’une province à l’autre, tantôt en prison et tantôt assiégée dans des places fortes ; elle n’ignora vraisemblablement pas l’existence de Lydwine, mais en admettant qu’elle eût pu joindre la sainte, alors qu’elle était encore libre et que ses ennemis n’occupaient pas le territoire de Schiedam, peut-être ne se souciait-elle point de réclamer des conseils ou de recevoir, à l’occasion de ses fallacieux mariages, des avis qui ne pouvaient que très certainement lui déplaire. Toujours est-il que son nom n’est même pas prononcé une fois, par les trois historiens.
Pour en revenir à Lydwine, quand Walter apprit le refus des échevins d’autoriser l’enterrement, il s’indigna et voulut passer outre, mais il lui fut enjoint, sous peine de la prison et de la confiscation de ses biens, de ne pas changer le cadavre de place. Force lui fut donc de se soumettre. En attendant l’heure des obsèques, et bien que, malgré sa liaison avec les soeurs tertiaires, Lydwine ne fit pas partie du tiers-ordre de saint François, — car Brugman qui était franciscain n’eût pas manqué de nous en avertir, — on la revêtit d’une robe de laine et d’une ceinture pareilles à celles de ces religieuses ; on la coiffa, en outre, d’un bonnet de vélin sur lequel étaient écrits à l’encre les noms de Jésus et de Marie ; puis Walter glissa un oreiller de paille sous sa tête et, ainsi qu’elle en avait manifesté le désir, un petit sachet contenant ce qu’elle appelait ses « roses », qui n’étaient autres que les larmes coagulées de sang qu’elle avait tant de fois versées. Walter les détachait, en effet, du visage, lorsqu’il allait, le matin, chez elle et il les serrait avec soin chez lui, dans une cassette.
Elle demeura ainsi exposée, pendant trois jours ; enfin, le due de Bourgogne ayant avisé les magistrats qu’il ne fallait pas compter sur sa présence, l’ordre d’inhumer fut obtenu.
Le vendredi matin, après un service solennel, célébré sous la présidence du P. Josse, prieur des chanoines réguliers de Brielle, celui-là peut-être qu’elle avait prié de la visiter, après Pâques, elle fut enterrée, à midi précis, dans la partie méridionale du cimetière contigu à l’église.
Suivant ses volontés, pour que sa dépouille ne touchât pas la terre, l’on plaqua sur le fond et les parois de la fosse des cloisons de bois, puis on couvrit la tombe d’une maçonnerie en forme de voûte et l’on scella sur le tout, à une hauteur d’environ deux coudées, une grande pierre rougeâtre à l’envers de laquelle furent tracées, avec du cinabre, des croix. L’an d’après, le clergé fit construire sur sa sépulture une chapelle de pierre qui communiqua par une ouverture avec l’église. Lydwine avait alors cinquante-trois ans et quelques jours ; elle mourut, le 18 des kalendes de mai, autrement dit le 14 avril, jour de la fête des saints martyrs Tiburce et Valérien, l’an du Seigneur 1433, le mardi dans l’octave de Pâques, après vêpres, vers quatre heures.
Les miracles ne tardèrent pas à éclore ; parmi ceux qui sont avérés, nous en citerons trois.
Le premier se produisit à Delft ; une jeune fille, qui gardait depuis huit années le lit, avait été abandonnée par les médecins, lorsqu’un jour Wilhelm, le fils de Sonder-Danck qui exerçait ainsi que son père la profession de médecin, lui dit, après lui avoir confessé que son mal était incurable :
— Que sont vos souffrances, en comparaison de celles qu’endura cette bienheureuse Lydwine que traita mon père ? Dieu effectue maintenant, par ses mérites, de nombreux miracles dans nos contrées. Invoquez-la donc !
La malade se sentit aussitôt incitée à implorer la sainte qui lui apparut et la guérit.
Le second se passa à Gouda. Il existait dans un couvent de religieuses une nonne qui avait une jambe plus courte que l’autre et si contractée qu’elle ne pouvait marcher. Elle avait demandé qu’on la transportât à Delft pour être examinée par ce Wilhelm Sonder-Danck qui avait soigné une autre soeur de ses amies ; mais ses supérieures lui refusèrent la permission de partir. Elle se désespérait, quand Lydwine surgit, pendant la nuit, dans sa cellule et l’invita à engager les moniales de la communauté à réciter, chacune, cinq pater et cinq ave, en l’honneur de Dieu et aussi pour elle ; ce après quoi, on la descendrait, le dimanche suivant, dans la chapelle du cloître où elle recouvrerait la santé ; et il advint, comme elle l’avait prédit ; l’estropiée sortit, joyeuse, et radicalement guérie, de l’église.
Le troisième fut accompli, à Leyde, au profit d’une autre nonne qui avait depuis huit années, au cou, une tumeur cancéreuse de la grosseur d’une pomme. Elle fut autorisée à pèleriner, par mortification, nu-pieds et simplement vêtue d’une robe de laine, sans linge dessous, au tombeau de Lydwine ; elle y alla mais en revint, navrée : la tumeur n’avait pas disparu. Elle se coucha, suppliant la sainte de ne pas ainsi la dédaigner et elle s’endormit. Au réveil, l’excroissance s’était fondue, le cou était redevenu sain.
Ces miracles, qui ont été dûment constatés et ont fait l’objet d’enquêtes approfondies, ont eu lieu en 1448, sous le pontificat de Sa Sainteté le pape Nicolas V.
XV
TELLE fut la vie de sainte Lydwine de Schiedam ; elle réjouira sans doute les achristes et affligera les nombreux catholiques qui, par tiédeur de foi, par respect humain, par ignorance, relèguent de leur mieux la mystique dans les asiles d’aliénés et les miracles dans le rancart des superstitions et des légendes. A ceux-là les biographies expurgées des Jansénistes pourraient suffire, s’ils n’avaient, à l’heure actuelle, toute une école d’hagiographes prêts à satisfaire leur haine du surnaturel, en fabriquant des histoires de saints confinés, avec défense de s’en échapper, sur la terre, de saints qui n’en sont plus. N’est-ce pas l’un de ces rationalistes et non l’un des moindres, Mgr Duchesne, qui, consulté, il y a quelques années, à propos d’une révélation de l’incomparable soeur Emmerich que venait de confirmer une découverte près d’Ephèse, répondit : « Je vous ai déjà dit qu’il est impossible d’introduire dans un débat sérieux un livre comme celui des visions de Catherine Emmerich ; l’archéologue se fonde sur des témoignages et non sur des hallucinations. »
Voilà qui proféré par un prêtre est bien ; ce qu’il doit la contemner la Mystique, celui-là !
N’en déplaise aux oracles de ce gabarit, il convient d’affirmer pourtant que, si étrange qu’elle paraisse, l’existence de Lydwine ne se singularise par rien d’anormal et par rien de neuf.
Sans parler des grâces spirituelles et des apparitions de Notre Seigneur et de la Vierge et des entretiens avec les Anges qui abondent dans toutes les vies des Saints et pour s’en tenir simplement aux phénomènes physiques, la plupart de ceux que nous avons divulgués, au cours de ce livre, se retrouvent consignés dans les biographies des innombrables élus qui vécurent avant ou après Lydwine.
Nous avons déjà remarqué, à l’occasion de ce don de l’ubiquité qu’elle posséda, que plusieurs autres célicoles se géminaient et se transféraient, dans des endroits différents, au même instant.
Si nous recherchons maintenant quels autres saints et quels autres serviteurs ou servantes de Dieu vécurent, ainsi que Lydwine, sans autre aliment que l’Eucharistie, nous découvrons, entre beaucoup de ces privilégiés, la vénérable Marie d’Oignies, sainte Angèle de Foligno, sainte Catherine de Sienne, la bienheureuse Élisabeth, la bonne de Waldsée, sainte Colombe de Riéti, Dominique du Paradis, la bienheureuse Marie Bagnesi, Françoise de Serrone, Louise de la Résurrection, la Mère Agnès de Langeac, Catherine Emmerich, Louise Lateau et pour signaler, au hasard, deux hommes : le bienheureux Nicolas de Flue et saint Pierre d’Alcantara.
Parmi la foule de ceux qui vécurent aussi sans réfection de sommeil, nous discernons sainte Christine l’admirable, sainte Colette, sainte Catherine de Ricci, la bienheureuse Agathe de la Croix, saint Elpide, sainte Flore ou Fleur, hospitalière de l’ordre de saint Jean, et j’en passe.
Les plaies devenues des cassolettes de parfums agissant non seulement sur l’odorat, mais encore sur les âmes qu’elles sanctifient, nous les reconnaissons également chez sainte Humiliane, sainte Ida de Louvain, Dominique du Paradis, Salomoni de Venise, la clarisse Jeanne-Marie de la Croix, Venturini de Bergame, le bienheureux Didée, chez le lépreux Barthole.
La bonne odeur de sainteté après la mort, elle exista chez le pape Marcel, sainte Aldegonde, saint Menard, saint Dominique, sainte Catherine de Bologne, la bienheureuse Lucie de Narni, la bienheureuse Catherine de Racconigi, sainte Claire de Rimini, sainte Fine de Toscane, sainte Élisabeth de Portugal, sainte Térèse, sainte Rose de Lima, saint Louis Bertrand, saint Joseph de Cupertino, saint Thomas de Villeneuve, saint Raymond de Pennafort, chez combien d’autres !
Au nombre des saints dont les corps furent, ainsi que celui de Lydwine, rétablis, après leur décès, dans leur jeunesse et leur beauté, figurent saint François d’Assise, saint Antoine de Padoue, saint Laurent Justinien, sainte Lutgarde, une victime réparatrice, elle aussi, sainte Catherine de Sienne, saint Didace, sainte Colombe de Riéti, sainte Catherine de Ricci, Sainte Madeleine de Pazzi, la vénérable Françoise Dorothée, Marie Villani de Naples, sainte Rose de Lima et je pourrais prolonger la liste.
Par contre Lydwine ne fit point partie du groupe des Myroblites, c’est-à-dire des déicoles dont les cadavres distillèrent des essences et des baumes. Tels ceux de saint Nicolas de Myre, de saint Willibrord, l’apôtre de la Hollande, de saint Vitalien, de sainte Lutgarde, de sainte Walburge, de sainte Rose de Viterbe, de la bienheureuse Mathie de Nazzarei, de sainte Hedwige, de sainte Eustochie, de sainte Agnès de Montepul. ciano, de sainte Térèse, de sainte Madeleine de Pazzi, de la carmélite Marguerite Van Valkenissen et je ne les inscris pas tous.
Pour résumer maintenant, en quelque mots, l’existence de cette sainte que l’on ne voit jamais debout et jamais seule, l’on peut dire qu’elle fut peut-être celle qui souffrit le plus, et le moins, en paix. Cette infirme du corps devait, en effet, donner des consultations aux infirmes de l’âme ; sa chambre était une clinique des maladies de conscience ; elle y recevait indistinctement prêtres et moines, échevins et bourgeois, patriciennes et bonnes femmes, gens de la plus basse extraction et princes et elle les opérait et les pansait.
C’était un hospice spirituel ouvert à tout venant ; et Dieu le voulait ainsi pour que les grâces qu’il lui dispensait fussent connues du publie, pour que les miracles qu’elle oeuvrait, en son nom, fussent visibles.
Sa vocation de guérisseuse des maux corporels fut, si l’on y songe, moindre. Elle fut moins prononcée, en tout cas, que celle de beaucoup d’autres saints ; mais elle présente cette particularité que les maladies ôtées par Lydwine n’étaient pas, la plupart du temps, détruites mais simplement transplantées sur elle.
Au point de vue de l’ascèse même, il faut encore noter que le Seigneur exigea d’elle plus qu’il n’exigea d’autres élus ; elle était déjà parvenue au sommet de la vie unitive, et il la replongeait dans la nuit ou plutôt dans le crépuscule de la vie purgative.
Cette division des trois étapes de l’ascension mystique, si distincte chez les théologiens, s’embrouille chez elle. Il n’est plus question de la halte du milieu, du relais illuminatif, mais des deux extrêmes, de la première et de la dernière étape dans lesquelles elle semble, à une certaine époque, s’être en même temps tenue. Cependant si Dieu l’humilia et la punit, il ne la fit pas descendre des cimes qu’elle avait atteintes. Il enténébra ces cimes et il l’y esseula ; mais quand l’orage fut terminé, elle s’y retrouva, sans avoir perdu un pouce de terrain, indemne.
Elle fut, en somme, un fruit de souffrance que Dieu écrasa et pressura jusqu’à ce qu’il en eût exprimé le dernier suc ; l’écale était vide lorsqu’elle mourut ; Dieu allait confier à d’autres de ses filles le terrible fardeau qu’elle avait laissé ; elle avait pris, elle-même, la succession d’autres saintes et d’autres saintes allaient, à leur tour, hériter d’elle ; ses deux coadjutrices, sainte Colette et sainte Françoise Romaine, avaient encore quelques années à souffrir ; deux des autres stigmatifères de son siècle, sainte Rite de Cassie et Pétronille Hergods, touchaient à leur fin ; mais de nouvelles semailles de douleurs levaient, prêtes à les suppléer.
En thèse générale, tous les saints, tous les serviteurs du Christ sont des victimes d’expiation ; en dehors même de leur mission spéciale qui n’est pas toujours celle-là, car les uns sont plus personnellement désignés soit pour effectuer des conversions, soit pour régénérer des monastères, soit pour prêcher aux masses, tous néanmoins apportent au trésor commun de l’Église un appoint de maux ; tous ont été des amoureux de la Croix et ont obtenu de Jésus d’être mis en demeure de lui administrer la preuve authentique de l’amour, la souffrance ; l’on pourrait donc justement avancer que tous ont contribué à parachever l’oeuvre de Lydwine ; mais elle eut des héritières plus proches encore, des légataires plus directes, des âmes plus particulièrement indiquées, comme elle-même le fut, pour servir de victimes propitiatoires, d’holocaustes ; et c’est parmi ses consoeurs que le Fils blasonna de ses armes, marqua de l’étampe de ses plaies, c’est surtout parmi les stigmatisées qu’il les faut chercher.
Ne sied-il pas d’observer, à ce propos, que toutes ces victimes appartiennent au sexe féminin ?
Dieu paraît, en effet, leur avoir plus spécialement réservé ce rôle de débitrices ; les saints, eux, ont un rôle plus expansif, plus bruyant ; ils parcourent le monde, créent ou réforment des ordres, convertissent les idolâtres, agissent surtout par l’éloquence de la chaire, tandis que, plus passive, la femme, qui n’est pas revêtue d’ailleurs du caractère sacerdotal, se tord, en silence, sur un lit. La vérité est que son âme, et que son tempérament, sont plus amoureux, plus dévoués, moins égoïstes que ceux de l’homme ; elle est également plus impressionnable, plus facile à émouvoir ; aussi jésus rencontre-t-il un accueil plus empressé chez elle ; elle a des attentions, des délicatesses, des petits soins qu’un homme, lorsqu’il n’est pas saint François d’Assise, ignore. Ajoutez que chez les vierges, l’amour maternel rentré se fond dans la dilection de l’Époux qui se dédouble pour elles et devient, quand elles le désirent, l’Enfant ; les allégresses de Bethléem leur sont plus accessibles qu’à l’homme et l’on conçoit aisément alors qu’elles réagissent moins que lui contre l’emprise divine. En dépit de leur côté versatile et sujet aux illusions, c’est donc chez les femmes que l’Époux recrute ses victimes de choix et c’est sans doute cela qui explique comment, sur les 321 stigmatisés que l’histoire connaît, il y a 274 femmes et 47 hommes.
La liste de ces réparatrices, héritières de Lydwine, elle existe tout au long dans un ouvrage merveilleusement documenté et absolument remarquable, dans « la Stigmatisation » du docteur Imbert-Gourbeyre.
Nous n’en extrairons cependant que celles des patientes dont la vocation de malades expiatrices ne peut être douteuse, celles dont la mission est écrite en toutes lettres et nous y adjoindrons quelques victimes qui, si elles ne portèrent pas sur leur corps les cachets sanglants du Christ, furent de grandes extatiques et de grandes infirmes dont la vie présente les plus complètes analogies avec celle de Lydwine.
Parmi ces femmes qui, après la mort de la sainte de la Hollande, acquittèrent par des souffrances la rançon des péchés de leur temps et se substituèrent, en étant innocentes, aux coupables, nous trouvons :
AU QUINZIÈME SIÈCLE
Sainte Colombe de Riéti, une Italienne, du tiers-ordre dominicain ; celle-là ne fut pas stigmatisée ; chargée par le Seigneur de sommer le Pape de corriger ses moeurs et d’épurer sa Cour, elle fut soumise aux plus impitoyables investigations et aux pires sévices, à Rome ; elle compensa aussi, par des maladies inconnues des médecins, les forfaits de son époque et mourut à la peine, en 1501.
La Bienheureuse Osanne, la patronne de la ville de Mantoue, une Italienne, tertiaire de l’ordre de SaintDominique ; elle naquit six années après le trépas de Lydwine et à sept ans Jésus lui posa sur l’épaule sa croix et lui prédit une vie de tortures ; sa chambre fut, ainsi que celle de la sainte de Schiedam, un cabinet de consultation pour les affections spirituelles. Les princes, les religieux, les laïques y défilèrent et elle débridait, elle aussi, les plaies des vices, perçait les apostumes des fautes et les pansait ; elle décéda, après une existence de douleurs atroces, en 1505.
Sainte Catherine de Gênes, une Italienne. Elle fut mariée et vécut d’abord de la vie mondaine, puis Jésus jeta sur elle son épreinte et sa conversion eut lieu, en coup de fondre, comme celle de saint Paul ; modèle des maladies extraterrestres, elle fut, suivant son expression « déchirée de la tête aux pieds » ; elle endura, de son vivant, les feux du Purgatoire pour sauver des âmes et elle a laissé, sur ce séjour des supplices, un traité persuasif et surélevé ; elle connut également les affres de la Passion et trépassa, en 1510, après une série de macérations et de souffrances dont le détail effraie. Son cadavre subsiste, à l’état d’incorruption, visible pour tous, à Gênes.
AU SEIZIÈME SIÈCLE
La Bienheureuse Marie Bagnési, une Italienne du tiers-ordre de Saint-Dominique, non stigmatisée, mais dont la vie semble une copie de celle de Lydwine ; elle souffrit pour réparer les scélératesses des hommes tout ce qu’il est possible de souffrir ; pendant quarante-cinq ans, elle fut tenaillée par des maux de tête, brisée par des fièvres, frappée de mutisme et de surdité ; elle n’eut pas un seul de ses membres qui fût intact, attestent les Bollandistes ; elle mourut de la pierre, ainsi que Lydwine, en 1577.
Sainte Térèse, une Espagnole, la réformatrice des carmels, l’inégalable historienne des luttes de l’âme et des combats divins. Son histoire est trop connue pour qu’il soit besoin d’en parler ici ; notons seulement qu’elle fut constamment malade et expia, de même que la sainte des Pays-Bas, pour les âmes du Purgatoire, pour les pécheurs, pour les mauvais prêtres ; elle naquit au ciel en 1582.
Sainte Catherine de Ricci, une Italienne, issue d’une illustre famille de Florence et appartenant à un monastère du tiers-ordre dominicain dont elle fut élue abbesse ; la demande qu’elle adressa à Jésus de subir dans son corps et son âme les châtiments mérités par l’expansion des hérésies et le dérèglement des moeurs fut accueillie ; son existence fut un enfer de maux ; le Seigneur avait sculpté les instruments de la Passion dans ses chairs, affirme la bulle qui la canonise ; elle trépassa en 1590.
Archangèle Tardera, une Italienne, tertiaire de l’ordre de Saint-François ; elle fut malade pendant trente-six ans et passa les vingt-deux dernières années de sa vie au lit ; sa mission consistait à rédimer les offenses des impies ; elle mourut en 1599.
AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
Sainte Madeleine de Pazzi, une Italienne, carmélite ; elle avait proposé au Sauveur d’endosser les péchés du monde et elle fut prise au mot. Elle vécut toujours malade et dans un état presque permanent d’extase ; elle fut douée de l’esprit prophétique et elle a dicté des oeuvres spirituelles qui sont des dialogues entre l’âme et Dieu et, surtout des apostrophes volubiles, des hourras d’allégresse, des cris enflammés de joie ; elle décéda en 1607.
Pudentienne Zagnoni, une Italienne, fille d’un tailleur de Bologne, tertiaire de Saint-François. Elle fut, ici-bas, écrasée par des infirmités dont l’origine surnaturelle fut reconnue par les médecins ; elle était, en outre, traînée par les cheveux et rouée de coups par les démons ; elle satisfaisait de la sorte aux iniquités qu’elle n’avait pas commises ; neuf semaines avant qu’elle mourût, les neuf choeurs des anges la communièrent, à tour de rôle ; elle succomba en 1608.
La Bienheureuse Passidée de Sienne, une Italienne, de l’ordre des capucines ; elle se sacrifia pour désarmer le Seigneur irrité par les impuretés de son temps. En sus de ses maladies qu’aucun remède n’apaisait, elle s’infligea, les jugeant inefficaces, d’épouvantables pénitences ; elle se fouettait jusqu’au sang avec des branches de genévriers et des tiges d’épines et elle étuvait ses déchirures avec du vinaigre salé chaud ; elle marchait dans la neige, pieds nus, ou se mettait des dragées de plomb dans ses chaussures ; elle s’enfonçait dans des tonnes d’eau glacée l’hiver et l’été, se pendait, la tête en bas, au-dessus du feu ; elle fut communiée par Jésus, par sa Mère, par les anges, et ses extases étaient si fréquentes que le P. Venturi, son historien, écrivait « qu’elles la faisaient bien plus vivre dans le Paradis que sur la terre ». Elle expira en 1615.
La Vénérable Stéphanie des Apôtres, une Espagnole, carmélite, non stigmatisée ; elle sollicita et obtint du Seigneur l’autorisation de se subroger aux pécheurs ; elle accéléra les détresses d’une santé déjà débile, par des jeûnes prolongés, des cilices, des cercles de fer et des chaines. Elle acheva sa mission purificatrice en 1617.
Ursule Bénincasa, une Italienne, la fondatrice de la congrégation des théatines ; elle para par ses tortures aux dangers qui menaçaient l’Église : son existence fut effroyable ; elle brûlait des flammes du Purgatoire pour exonérer des âmes et l’amour divin l’incendiait de telle sorte qu’il lui sortait une colonne de fumée de la bouche ; en sus de ses maladies propitiatoires, elle fut soumise, à Rome, aux plus durs traitements et mourut en 1618.
Agathe de la Croix, une Espagnole, tertiaire de l’ordre de Saint-Dominique ; elle devint par désir d’immolation estropiée et aveugle. Ses chairs, comme celles de Lydwine, tombaient en pourriture sur la paille et elle était aussi consumée par les feux du Purgatoire ; elle décéda en 1621.
Marine Escobar, une Espagnole, la réformatrice de la règle de Saine Brigitte ; elle fut cinquante ans malade et en passa trente, étendue sur sa couche ; elle exhalait, ainsi que la sainte de la Hollande, les plus délicats parfums. Quand on la changeait de linge, rapporte son biographe, il semblait que celui qu’on enlevait de son corps était un parterre odorant de fleurs ; elle trépassa en 1633.
Agnès de Langeac, une Française, tertiaire de l’ordre de Saint-Dominique ; elle supporta tous les tourments du Purgatoire pour affranchir des âmes ; elle vécut, infirme, se traînant sur des potences, atténuant par ses maux les méfaits du prochain ; elle mourut en 1634.
Jacqueline du Saint-Esprit, une Française, dominicaine, alitée, toujours obligée de garder la chambre ; elle expira, après d’horribles souffrances réparatives, en 1638.
Marguerite du Saint-Sacrement, une Française, carmélite ; celle-là endura des tortures extraordinaires ; elle souffrit de telles douleurs dans le crâne, qu’après l’avoir vainement piquée avec des clous de fer rouge, les chirurgiens la trépanèrent ; elle n’éprouva aucun allégement de ces sévices ; seule, l’apposition des reliques chassait son mal. Elle expia plus spécialement les offenses faites au Seigneur par le manque de charité des riches ; elle participa au supplice de différents martyrs pendant quinze mois, s’offrit au Sauveur, comme victime, pour délivrer la France de l’invasion des armées allemandes ; elle termina son sacrifice en 1648.
Lucie Gonzalès, une Italienne, rongée par les fièvres, n’ayant pas une place de son corps qui fut saine ; elle racheta plus particulièrement les abominations que commirent en 1647 les révolutionnaires de Naples ; sa vie fut un livre de douleur ; il se ferma en 1648.
Paule de Sainte-Térèse, une Italienne du tiers-ordre de Saint-Dominique, prenait à son compte les péchés des séculiers et des prêtres ; elle vécut couchée et fut, ainsi que Lydwine, communiée de la main du Christ ; elle libéra aussi par ses souffrances les âmes du Purgatoire qui la cernaient de toutes parts ; son décès eut lieu en 1657.
Marie de la Très Sainte Trinité, une Espagnole, tertiaire de Saint-Dominique ; elle était accablée d’infir. mités et réduite, lorsqu’elle n’était pas allongée sur des alèzes, à se traîner à genoux ; sa mission piaculaire prit fin en 1660...
Pudentienne Zagnoni, Italienne, clarisse, quil ne faut pas confondre avec sa soeur, la stigmatisée du même nom et du même prénom, citée plus haut. Elle fut, pendant trente-deux ans, malade. Ainsi que Lydwine, elle voyageait avec son ange, dans le Paradis et amendait sur son grabat les forfaits du monde ; elle mourut en 1662.
Marie Ock, une Belge, tertiaire carmélite ; elle souffrait des peines appropriées aux excès des personnes qu’elle suppléait dans leur pénitence ; elle purgeait les peines du Purgatoire et était tannée par les coups, roulée dans les escaliers, plongée dans des puits par les démons. Quand elle n’était pas alitée, elle courait dans les mauvais gîtes pour en retirer leurs hôtesses ; elle fut une des compensatrices les plus fertiles et les plus résolues dont la biographie, vraiment curieuse, est à lire. Elle succomba à la peine, en 1684.
Jeanne-Marie de la Croix, une Italienne, tertiaire franciscaine. Constamment malade, torturée par des douleurs atroces dans les reins, elle dut subir les traitements les plus barbares des médecins qui finirent cependant par reconnaître l’origine préternaturelle de ses maux et lui permirent de gémir en paix. Elle reçut l’anneau mystique, épandit de sa personne d’inexplicables parfums, guérit par sa bénédiction les infirmes et multiplia les pains. Elle s’immola plus spécialement pour combattre l’hérésie des protestants et naquit au ciel en 1673.
Marie-Angélique de la Providence, une Française, tertiaire carmélite ; elle intercéda plus particulièrement pour les communautés dévergondées et pour les prêtres. Le Seigneur lui indiquait, lui-même, les pécheurs dont il voulait qu’elle neutralisât par ses maladies les offenses ; elle fut une grande adoratrice du saint Sacrement et l’une des victimes sur laquelle s’acharnèrent le plus les démons. Ils la battaient comme tapis, la cognaient contre les murailles, la piétinaient sur le sol ; elle mourut en 1685.
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE
Marceline Pauger, une Française, soeur de la Charité, à Nevers ; celle-là fut une réparatrice des profanations du saint Sacrement et des vols d’hosties ; c’est elle qui disait : « Ma vie est un purgatoire où le corps délicieux souffre et où l’âme jouit » ; elle décéda en 1708.
Fialetta-Rosa Fialetti, Italienne, tertiaire de Saint. Dominique. Son existence ne fut qu’une série de maladies rédemptrices ; elle se termina en 1717.
Sainte Véronique Giulani, Italienne, clarisse ; elle fut une vivante image du Christ en croix. Tandis que les maladies la dévoraient, elle criait : vive la croix toute seule et toute nue, vive la souffrance ! Comme Lydwine elle s’offrait au Seigneur pour acquitter le supplément de péchés que suscitent les godailles des jours gras. Elle eut la transverbération du coeur ainsi que sainte Térèse et l’impression des instruments du Calvaire, ainsi que sainte Claire de Montefalco. Elle mourut en 1727.
Sainte Marie-Françoise des Cinq-Plaies de Jésus, une Italienne, du tiers-ordre de Saint-François ; sa vie fut un tissu d’infirmités ; elle souffrit de douleurs d’entrailles atroces, de fièvre, de gangrène. De même que Lydwine elle transbordait sur elle-même les maladies du prochain ; elle fut persécutée par sa famille et par son confesseur et communiée par les anges. Douée de l’esprit prophétique, elle annonça longtemps à l’avance la Révolution française et la mort de Louis XVI, mais à la vue des souffrances de l’Église qui lui furent montrées, son coeur éclata et elle supplia le Seigneur de la délivrer de la vie ; sa requête fut accueillie en 1791.
AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
Marie-Josépha Kümi, une Suissesse, dominicaine ; elle fut une victime expiatrice de l’Église, des pécheurs, des âmes du Purgatoire dont elle partagea les tourments ; son corps n’était qu’une plaie ; elle décéda en 1817.
Anne-Catherine Emmerich, une Allemande, augustine, la plus grande voyante des temps modernes et qui plus est, bien qu’illettrée, une magnifique artiste ; son histoire est trop connue pour qu’il soit besoin de la rappeler ; ses livres sont entre toutes les mains. Constatons seulement que cette stigmatifère fut toujours couchée et qu’elle est parmi les réparatrices celles qui, avec Marie Bagnési, se rapproche le plus de Lydwine ; elle est son héritière directe à travers les âges ; elle est morte après une vie de douleurs sans nom, en 1824.
Élisabeth Canori Mora, une Italienne, du tiers-ordre des trinitaires déchaussées ; elle amortit surtout la dette des iniquités des persécuteurs de l’Église et trépassa en 1825.
Anna-Maria Taïgi, une Italienne, du tiers-ordre des trinitaires déchaussées ; elle fut saccagée par une série de tortures ; les céphalalgies, les fièvres, la goutte, l’asthme ne lui laissèrent pas un instant de repos ; ses yeux, comme ceux de Lydwine, versaient du sang lorsqu’ils étaient atteints par les moindres lueurs ; elle se sacrifia plus spécialement pour les bourreaux de l’Église ; son holocauste prit fin en 1837.
Soeur Bernard de la Croix, une Française, de la congrégation de Marie-Thérèse, à Lyon ; elle acceptait les tentations des personnes trop faibles pour les supporter et souffrait mort et passion pour elles ; elle mourut en 1847.
Marie-Rosa Andriani, Italienne, du tiers-ordre franciscain ; elle fut, depuis l’âge de cinq ans, une martyre par délégation et le Seigneur aggravait ses tourments, en ne la consolant pas ; elle s’arrachait de la poitrine des os tout chauds et ne fut sustentée, pendant vingt-cinq ans, que par l’Eucharistie ; elle décéda en 1848.
Maria-Domenica Lazzari, l’une des stigmatisées du Tyrol ; médiatrice des mécréants, son existence fut une continuelle agonie ; brisée par des convulsions, par une toux opiniâtre, par des douleurs dans le bas-ventre, elle ne fut nourrie, durant quatorze années, que par les saintes Espèces ; sa mort eut lieu en 1848.
Marie de Saint-Pierre de la Sainte-Famille, une Française, carmélite, non stigmatisée. Elle s’interposa entre Dieu et la France qui était sur le point d’être châtiée ; elle eut gain de cause mais endura le martyre. Elle résumait, elle-même, sa vie en cette phrase : « C’est pour la réparation que j’ai été mise au monde et c’est d’elle que je meurs. » Elle succomba à la peine en 1848.
Marie-Agnès Steiner, une Allemande, clarisse dans un monastère de l’Ombrie ; elle éprouva, pour le bien de l’Église, les plus cruelles maladies ; elle effluait, comme Lydwine, de célestes aromes ; elle trépassa en 1862.
Marie du Bourg, en religion Mère Marie de Jésus, une Française, fondatrice de la congrégation des soeurs du Saint-Sauveur et de la Sainte Vierge ; elle fut, de même que la sainte de Hollande, une gloutonne de maux ; elle a terriblement pâti pour les impies, pour les possédés et pour les âmes en attente. « Elle est tout occupée à peupler le Ciel et à vider le Purgatoire », disait l’une de ses filles. Elle subit des attaques furieuses de la part des démons et mourut en 1862.
Marie de Moerl, la plus connue des stigmatisées du Tyrol, tertiaire de l’ordre de Saint-François ; elle expia surtout pour l’Église ; elle était douée de l’esprit prophétique et lisait dans les âmes ; l’abbé Curicque, l’un de ses historiens, narre ce fait qui pourrait figurer dans la vie de Lydwine : un religieux dont elle ignorait jusqu’au nom vint, accompagné de plusieurs personnes, pour se recommander à ses prières ; elle accepta d’invoquer le Seigneur à son intention, mais elle jugea nécessaire de lui signaler un défaut que, lui seul, pouvait connaître et dont il lui fallait à tout prix se débarrasser. Ne voulant point l’humilier devant des tiers, elle prit, sous son traversin, le psautier, l’ouvrit et lui montra du doigt un passage qui visait expressément ce défaut ; puis elle lui sourit doucement et retomba dans l’extase que cette visite avait interrompue elle décéda en 1868.
Barbe de Saint-Dominique, une Espagnole, dominicaine ; elle assuma les péchés du prochain, fut en butte aux assauts du Maudit et mourut, victime de la substitution mystique ; elle offrit, en effet, sa vie au Christ pour la guérison d’une autre religieuse dont l’état était désespéré ; celle-ci recouvra aussitôt la santé, et, elle, s’alita pour ne plus se relever ; elle avait à peine trente ans, alors qu’on l’inhuma, en 1872.
Louise Lateau, Belge ; son cas est célèbre ; elle vécut toujours couchée, rachetant par ses douleurs les forfaits d’autrui ; pendant douze années, la communion fut son seul aliment. Trop de livres ont été écrits sur cette sainte fille pour qu’il soit utile d’en parler ici ; elle mourut en 1883.
Marie-Catherine Putigny, une Française, visitandine ; elle s’était proposée comme victime réparatrice au Seigneur ; elle souffrit les plus lancinantes tortures pour les âmes du Purgatoire ; elle voyait, de même que Lydwine et que la soeur Emmerich, les tableaux de la Passion ; elle est décédée à son monastère de Metz, en 1885.
La cause de béatification de la plupart de ces femmes a été introduite à Rome ; sans préjuger en rien le jugement qui interviendra pour chacune d’elles, il sied d’espérer que l’origine céleste de leurs vocations et de leurs maux sera reconnue.
L’on remarquera que parmi les héritières de Lydwine, il n’en est pas une qui soit issue, ainsi qu’elle, du territoire des Pays-Bas. Il y a des Italiennes, des Espagnoles, des Françaises, des Belges, des Tyroliennes, des Allemandes, une Suissesse et pas une Hollandaise ; et cependant le Dr Imbert-Gourbeyre en cite une, mais sans renseignements assez précis pour nous permettre d’affirmer qu’elle fut une victime expiatrice ; c’est une nommée Dorothée Visser, née en 1820, à Gendringen et qui aurait été étampée des stigmates de la Passion, vers 1843 ; il serait bien désirable qu’un moine ou qu’un prêtre hollandais suivît cette piste et nous montrât, s’il y a lieu, que la succession de Lydwine a été recueillie dans son pays même.
L’on remarquera également la large part qui est faite au dix-neuvième siècle dans cette répartition des donatrices.
Ces listes sont, est-il utile de le dire, très incomplètes ; elles suffisent néanmoins à prouver que l’héritage de Lydwine n’est pas tombé en déshérence et que les desseins de Dieu n’ont pas varié ; son procédé de faire appel à la charité de certaines âmes pour satisfaire aux nécessités de sa Justice demeure immuable ; la loi de la substitution est toujours en vigueur ; depuis l’époque de sainte Lydwine rien n’est changé.
Il faut ajouter qu’à l’heure actuelle les besoins de l’Église sont immenses ; un vent de malheur souffle sur les régions inabritées des croyants. Il y a une sorte d’affaissement des devoirs, de déchéance d’énergie dans les pays qui sont plus particulièrement les fiefs spirituels du Saint-Siège.
L’Autriche est rongée jusqu’aux moelles par la vermine juive ; l’Italie est devenue un repaire maçonnique, une sentine démoniaque, au sens strict du mot ; l’Espagne et le Portugal sont, eux aussi, dépecés par les crocs des Loges ; seule, la petite Belgique paraît moins cariée, de foi moins rance, d’âme plus saine ; quant à la nation privilégiée du Christ, la France, elle a été attaquée, à moitié étranglée, saboulée à coups de bottes, roulée dans le purin des fosses par une racaille payée de mécréants. La franc-maçonnerie a démuselé, pour cette infâme besogne, la meute avide des israélites et des protestants.
Dans un tel désarroi, il eût peut-être fallu recourir aux mesures abolies d’antan, user de quelques chemises dûment soufrées et de quelques bons bûchers de bois bien sec, mais l’âme poussive des catholiques eût été incapable de souffler sur le feu pour le faire prendre ! puis, ce sont là des expédients sanitaires désuets, des pratiques que d’aucuns qualifieraient d’indiscrètes et qui ne sont plus, en tout cas, d’accord avec les moeurs desserrées de notre temps.
Étant donné alors que l’Église gît sans défense, l’on pourrait s’inquiéter de l’avenir, si l’on ne savait qu’elle rajeunit chaque fois qu’on la persécute ; — les larmes de ses martyrs, c’est son eau de Jouvence, à elle ! — Quand on refoule le catholicisme d’un pays, il s’infiltre dans un autre et revient à son point de départ, après ; c’est l’histoire des congrégations qui, lorsqu’on les chasse de la France, y rentrent quand même, après avoir fondé à l’étranger de nouveaux cloîtres. En dépit de tous les obstacles, le catholicisme, qui semble parfois stagnant, coule ; il s’insinue en Angleterre, en Amérique, dans les Pays-Bas, gagne peu à peu du terrain dans les régions hérétiques et il s’impose.
Fût-il d’ailleurs ligoté et saigné aux quatre veines qu’il revivrait encore, car l’Église détient des promesses formelles et ne peut périr. Elle en a vu d’autres, du reste, et elle doit, tout en peinant, patiemment attendre.
Il n’en est pas moins vrai qu’au point de vue des offenses divines, des sacrilèges et des blasphèmes, la situation de la France est lamentable. Ce commencement de siècle présente, dans ce pays surtout, cette singularité qu’il est imbibé, saturé comme une éponge de Satanisme et il ne paraît même pas s’en douter !
Dupés par les palinodies d’un fétide renégat, les catholiques ne soupçonnent même point que ce malheureux a plus menti le jour où il déclara s’être moqué d’eux que lorsque, pendant des années, il leur enrobait des documents dont la plupart étaient exacts, dans un excipient d’invraisemblables bourdes !
Il y a dans tous les cas, un fait, indéniable, absolu, sûr, c’est, qu’en dépit des dénégations intéressées, le culte Luciférien existe ; il gouverne la franc-maçonnerie et tire, silencieux, les ficelles des sinistres baladins qui nous régissent ; et ce qui leur sert dâme à ceux-là est si pourri qu’ils ne s’imaginent même pas qu’ils ne sont, quand ils dirigent l’assaut contre le Christ et son Église, que les bas domestiques d’un maître à l’existence duquel ils ne croient pas ! Si habile à se faire nier, le Démon les mène.
Le vingtième siècle débute donc, ainsi que le précédent a fini en France, par une éruption infernale ; la lutte est ouverte entre Lucifer et Dieu.
En vérité, il faut espérer que, pour contre-balancer le poids de tels défis, les victimes d’expiation abondent, et que, dans les cloîtres et que dans le monde, beaucoup de moines, de prêtres et de laïques acceptent de continuer l’oeuvre réparatrice des holocaustes.
Certainement, dans les ordres dont le but est la mortification et la pénitence, tels que les calvairiennes bénédictines, les trappistines, les clarisses, les carmélites, pour n’en nommer que quatre, des femmes prostrées sur des lits et dont les maladies déroutent les diagnostics des médecins, souffrent pour neutraliser les abominations démoniaques de notre époque ; mais l’on peut se demander si ces couvents d’immolées sont assez nombreux, car lorsque l’on connaît certains détails de bruyantes catastrophes, de celle du bazar de la Charité, par exemple, il est bien difficile de ne croire qu’à des causes matérielles énumérées dans des rapports de magistrats et de pompiers.
Ce jour-là, ce sont, en effet, les femmes vraiment pieuses, les femmes venues non pour arborer des toilettes et s’exhiber, mais pour aider à soulager des infortunes et à faire le bien, des femmes qui avaient toutes ou presque toutes entendu la messe ce matin-là et communié, qui ont été brûlées vives. Les autres s’en sont tirées. Il semble donc qu’il y ait eu une volonté du Ciel de choisir, dans cette mêlée, les meilleures, les plus saintes des visiteuses, pour les obliger à expier, dans les flammes, la plénitude sans regrets de nos péchés.
Et finalement l’on arrive à se poser cette question un pareil désastre aurait-il été évité s’il y avait eu plus de monastères de la dure observance, plus d’âmes déterminées à s’infliger des sacrifices volontaires et à se céder pour subir l’indispensable châtiment des impies ?
L’on ne peut évidemment répondre, d’une façon nette, à une semblable question ; mais ce qu’il est possible d’affirmer, c’est qu’il n’y a jamais eu tant besoin de Lydwine qu’à présent ; car, elles seules seraient à même d’apaiser la colère certaine du Juge et de nous servir de paratonnerre et d’abri contre les cataclysmes qui se préparent !
Je ne me dissimule pas qu’en parlant de la sorte, dans un siècle où chacun ne poursuit qu’un but : voler son prochain et jouir en paix dans l’adultère ou le divorce de ses dols, j’ai peu de chances d’être compris. je sais très bien aussi que devant ce catholicisme dont la base est la désaccoutumance de soi-même et la souffrance, les fidèles épris de dévotionettes et abêtis par la lecture de pieuses fariboles, s’exclameront ; ce sera pour eux l’occasion de ressasser, une fois de plus, la complaisante théorie « que Dieu n’en demande pas tant, qu’il est si bon ».
Oui, je sais bien, mais le malheur, c’est qu’il en demande autant et qu’il est néanmoins infiniment bon. Mais il faut le répéter, une fois de plus aussi, il dédommage, ici-bas même, par des joies intérieures, ceux qui le prient, de leurs afflictions et de leurs maux ; et chez les êtres privilégiés qu’il torture, l’outrance des liesses dépasse l’excès des peines ; tous ont dan le corps broyés des âmes qui rayonnent, tous s’écrient comme Lydwine qu’ils ne souhaitent pas d’être guéris, qu’ils n’échangeraient pas les consolations qu’ils reçoivent pour tous les bonheurs du monde.
D’ailleurs, les ouailles que l’existence exceptionnelle de ces protectrices effare, auraient tort de s’alarmer ; prenant en pitié leur ignorance et leur faiblesse, Dieu les épargnera plus sans doute qu’il n’a épargné son propre Fils ; il ne cherche pas parmi ceux qu’il n’a point nantis d’âmes bien robustes les poids destinés à rétablir l’équilibre de la balance dont le plateau des fautes descend si bas... De même que personne n’est tenté au-dessus de ses forces, de même personne n’est chargé de douleurs qu’il ne puisse, d’une façon ou d’une autre, tolérer. Il les dose aux moyens de résistance de chacun ; seulement, ceux qui ne souffrent que modérément auraient tort clé trop se réjouir, car cette abstinence de tourments n’est ni un signe de validité spirituelle, ni d’amoureuse préférence.
Mais ce livre n’est pas écrit, en somme, pour ceux-là. Il est, en effet, difficile, pour des gens qui vivent en bonne santé, de le bien comprendre ; ils le saisiront mieux, plus tard, lorsque séviront les mauvais jours ; par contre, il s’adresse plus spécialement aux pauvres êtres atteints de maladies incurables et étendus, à jamais, sur une couche. Ceux-là sont, pour la plupart, des victimes de choix ; mais combien, parmi eux, savent qu’ils réalisent l’oeuvre admirable de la réparation et pour eux-mêmes et pour les autres ? Cependant, pour que cette ceuvre soit véritablement satisfactoire, il sied de l’accepter avec résignation et de la présenter humblement au Seigneur. Il ne s’agit pas de se dire : je ne saurais m’exécuter de bon coeur, je ne suis pas un saint, moi, tel que Lydwine, car, elle non plus, ne pénétra pas les desseins de la Providence lorsqu’elle débuta dans les voies douloureuses de la Mystique ; elle aussi, se lamentait, comme son père Job et maudissait sa destinée ; elle aussi se demandait quels péchés elle avait bien pu commettre pour être traitée de la sorte et elle ne se sentait pas du tout incitée à offrir de son plein gré ses tourments à Dieu ; elle faillit sombrer dans le désespoir ; elle ne fut pas une sainte du premier coup ; et néanmoins, après tant d’efforts tentés pour méditer la Passion du Sauveur dont les tortures l’intéressaient beaucoup moins que les siennes, elle est parvenue à les aimer et elles l’ont enlevée dans un ouragan de délices jusqu’aux cimes de la vie parfaite ! La vérité est que Jésus commence par faire souffrir et qu’il s’explique après. L’important est donc de se soumettre d’abord, quitte à réclamer ensuite. Il est le plus grand Mendiant que le ciel et la terre aient jamais porté, le Mendiant terrible de l’Amour ! les plaies de ses mains sont des bourses toujours vides et il les tend pour que chacun les emplisse avec la menue monnaie de ses souffrances et de ses pleurs.
Il n’y a donc qu’à Lui donner. La consolation, la paix de l’âme, le moyen de s’utiliser et de transmuter à la longue ses tourments en joie, ne peuvent s’obtenir qu’à ce prix. Le récepte de cette divine alchimie qu’est la Douleur, c’est l’abnégation et le sacrifice. Après la période d’incubation nécessaire, le grand oeuvre s’accomplit ; il sort du brasier, de l’athanor de l’âme, l’or, c’est-à-dire l’Amour qui consume les abattements et les larmes ; la vraie pierre philosophale est celle-là.
Pour en revenir maintenant à Lydwine, il nous faut narrer, en quelques lignes, le sort qui fut réservé à ses reliques.
Ainsi qu’il fut dit, plus haut, les recteurs de l’église de Saint-Jean-Baptiste de Schiedam édifièrent, en 1434, une petite chapelle sur sa tombe et Molanus ajoute ce détail que cette chapelle fut parée de tableaux dépeignant divers épisodes de sa vie.
Les reliques y furent vénérées, jusqu’au moment où les protestants devinrent les maîtres de cette Hollande qu’ils n’ont plus quittée. Ils s’emparèrent à Schiedam de la dépouille de Lydwine et les catholiques durent la racheter.
En 1615 le corps fut exhumé sur les ordres du prince Albert, archiduc d’Autriche et souverain des Pays-Bas, et de sa femme Isabelle-Claire-Eugénie, fille de Philippe II, roi d’Espagne, et petite-fille de Henri II, roi de France.
Cette princesse, que passionnait la mémoire de Lydwine, fit transférer ses ossements, enfermés en une châsse d’argent, dans l’oratoire de son palais, à Bruxelles.
Un an après, en 1616, une partie de ces restes fut remise, dans un coffret d’ébène et d’argent, aux dames chanoinesses de Mons et confiée à leur garde, dans le sanctuaire de Sainte-Waudru.
Cette illation eut lieu en grande pompe ; une procession solennelle de plus de six cents cierges, à laquelle s’associèrent les magistrats de la cité, les ordres religieux, les prêtres, le peuple, se réunit à l’église Sainte-Élisabeth et accompagna les reliques portées par l’abbé de Saint-Denis jusqu’à la cathédrale de Sainte-Waudru.
Une seconde partie des ossements fut encore concédée par la princesse, en 1626, au couvent des carmélites qu’elle avait fondé, en 1607, à Bruxelles ; enfin une troisième partie échut, en 1650, après la mort d’Isabelle, à l’église Sainte-Gudule, dans la même ville.
Une note des Bollandistes constate, de son côté, qu’un fragment du corps et que l’un des tableaux de l’église de Schiedam furent impartis, au moment où les hérétiques allaient faire main basse sur ces biens, au supérieur des prémontrés d’Anvers. Ils furent déposés dans la chapelle des Saints-Apôtres où ils demeurèrent pendant de longues années ; puis le tableau se détériora et fut jeté au rebut et quant aux reliques, elles disparurent sans qu’on ait jamais su comment.
A l’heure actuelle, d’après les renseignements que nous avons pu recueillir, aucune trace ne subsiste à Sainte-Waudru et à Sainte-Gudule des dépouilles de Lydwine ; elles auraient été dispersées pendant la Révolution ; seul le carmel de Bruxelles garde encore son précieux dépôt, mais il en a abandonné une partie, en 1871, pour permettre au moins à la ville de Schiedam de posséder quelques vestiges de sa sainte. La portion la plus considérable de ce présent, les os entiers des deux bras, se trouvent maintenant dans l’église paroissiale de la Visitation, à Schiedam.
Enfin, les jansénistes de cette ville détiendraient, eux aussi, quelques détriments, mais ils les cachent et subitement ils n’entendent Plus le français, quand on leur en parle.
Peut-être bien que leurs ancêtres ont dérobé un reliquaire dont on pourrait, en déchiffrant le nom ou les armes gravées dans le métal, reconnaitre l’origine, et ils ne se soucient pas d’avoir à s’expliquer sur sa provenance.
Ajoutons, pour parler des honneurs rendus par l’Église à Lydwine, que l’archevêque de Malines, métropolitain de la Belgique, Mgr Mathias Hovius, a, par une lettre pastorale du 14 janvier 1616, autorisé le culte de la bienheureuse dans les Flandres.
Des années s’écoulèrent. Lydwine, dont le culte était antérieur aux décrets du pape Urbain VIII, était comprise au nombre des Béatifiées, mais il lui restait à acquérir le titre définitif de Sainte.
Ce fut, vers la fin du siècle dernier, qu’un prêtre de la Hollande se dévoua à cette cause ; la paroisse de la Visitation de Notre-Dame venait d’être instituée à Schiedam ; son premier curé fut M. l’abbé Van Leeuven ; il admirait et vénérait Lydwine. Il se mit en campagne et décida l’archevêque de Malines, l’évêque d’Harlem ainsi que les autres prélats des Pays-Bas et la prieure du carmel de Bruxelles, à introduire des instances auprès de Rome pour obtenir la canonisation de la bienheureuse.
Ces instances ont été accueillies et un décret du 14 mars 1890 a élevé Lydwine au rang des saintes ; mais le promoteur véritable de cette cause, l’abbé Van Leeuven, n’eut pas la joie d’assister à la réussite de ses efforts, car il mourut avant la promulgation de ce décret.
XVI
JE songeais dans le train qui nous emportait, mes amis et moi, à Schiedam, à un incunable que j’avais consulté à la bibliothèque de La Haye, la Vie de Lydwine, par Joannes Brugman, éditée à Schiedam, aux dépens des maîtres de la fabrique de l’église de Saint-Jean-Baptiste, en 1498, c’est-à-dire soixante-cinq ans après la mort de la sainte.
Ce volume, mince comme une plaquette, renferme de curieuses gravures sur bois, deux entre autres — l’une représentant Lydwine, debout, vêtue en grande dame du quinzième siècle, un long crucifix dans la main droite et dans la gauche la branche de ce rosier dont les boutons prêts à éclore signifiaient les jours qu’elle devait encore, ici-bas, vivre ; et elle considère, en face d’elle, assis sur une chaise de bois, le bon frère mineur Brugman en train d’écrire son livre ; mais il est si attentif et si pressé qu’il ne regarde que son manuscrit et ne voit même pas la sainte — l’autre, montrant Lydwine, plus âgée qu’elle ne pouvait être à ce moment, étendue sur le flanc et ramassée par deux femmes tandis qu’une troisième demeure immobile, figée par la stupeur, et qu’un homme dessine derrière elle des ronds de jambes, sur la glace ; pour compléter le petit tableau, d’autres patineurs se tiennent par la main, d’un côté, et, de l’autre, apparaît un enfantin donjon dessiné en quelques traits.
Ces xylographies qui ont été, au point de vue de l’histoire de la gravure dans les Pays-Bas, longuement étudiées par M. Jules Renouvier, valaient pour moi surtout par leur naïveté, mais elles étaient trop brèves pour suggérer l’aspect des lieux dans lesquels vécut la sainte.
Son souvenir si parfaitement oublié dans toutes les parties du monde et presque ignoré de toutes les villes calvinistes de la Hollande, existait-il au moins à Schiedam ? découvrirai-je dans ce bourg où elle naquit et mourut des traces d’elle, des débris de quartiers de son siècle, la place de sa maison, enfin des documents différents de ceux qu’avaient entassés, pêle-mêle, ses premiers biographes ?
Je ruminais ces réflexions, tout en feuilletant un guide Baedeker qui se débarrassait en quelques lignes dénuées d’enthousiasme de Schiedam et ne citait même pas, bien entendu, le nom de la sainte.
A dire vrai, j’avais retrouvé une Hollande si dissemblable de celle que j’avais parcourue dans mon enfance et depuis, une Hollande reconstruite, aux cités élargies pleines d’avenues et de bâtisses neuves, que je n’augurais rien de ce voyage. N’en serait-il pas de même de Schiedam que je n’avais encore jamais visité ? C’était probable.
D’autre part, ce qu’il nous avait fallu effectuer de marches et de contremarches pour parvenir à assister, dans ces agglomérations protestantes, à une messe ! allions-nous encore, dans la patrie de Lydwine, recommencer nos recherches en quête d’un sanctuaire de notre culte. Cela pouvait paraître plausible ; et cependant, mes amis et moi, nous reprenions un peu confiance ; nous savions qu’un pèlerinage très fréquenté existait dans les environs, le pèlerinage des martyrs de Gorcum, c’est-à-dire de dix-neuf fidèles dont onze capucins, deux prémontrés, un dominicain, un augustin et quatre prêtres séculiers qui avaient été pendus, après d’affreux tourments, en 1572, par les Réformés à Gorcum et béatifiés en 1675 et canonisés en 1867.
Leur souvenir était si vivace dans la contrée, que les pèlerins affluaient toujours pour vénérer leurs reliques. Un courant catholique subsistait donc dans ce pays ; or, Gorcum était situé à peu de distance de Schiedam ; il y avait par conséquent une chance pour qu’à l’aller ou au retour, l’on vînt aussi révérer les restes de la sainte et alors il y avait certainement au moins une chapelle.
La réponse à ces questions ne se fit pas attendre ; à peine débarqués à Schiedam, le soir, nous aperçûmes une vaste église. A tout hasard, nous y entrâmes ; elle était si noire que l’on ne distinguait rien, à deux pas, devant soi ; mais subitement, tandis que nous avancions à tâtons, nous demandant si nous n’étions pas chez des hérétiques, une lueur d’étoile scintilla au bout de la nef ; l’étoile voltigea, puis se fixa à six places différentes, en l’air ; et, dans la lueur qu’épandaient, au-dessus de l’autel, les six cierges, une statue coloriée sortit des ténèbres, une statue de femme, couronnée de roses et près de laquelle se tenait un ange ; le doute n’était pas possible ; comme pour nous rassurer, Lydwine se montrait aussitôt notre arrivée et tandis que nous l’examinions, l’église entière s’alluma et une foule silencieuse l’emplit ; des hommes, des femmes, des enfants, pénétraient par toutes les portes et se serraient dans des rangées de bancs ; l’autel se couvrit de lumières et, pendant que les prêtres arboraient le Saint-Sacrement, de majestueuses tempêtes de louanges jaillirent des grandes orgues et le « Tantum ergo » entonné en plain-chant par des centaines de voix monta dans des nuées d’encens, le long des colonnes, sous les voûtes ; puis après la bénédiction, ce fut le « Laudate » chanté également par l’assistance et, dans l’église qui s’éteignait, de ferventes silhouettes agenouillées, les mains jointes, dans l’ombre.
La bénédiction du Saint-Sacrement ! nous y sommes si habitués en France qu’elle ne nous éveille plus de sensations particulières ; nous nous y présentons heureux d’offrir une preuve d’affectueuse déférence à Celui dont l’humilité fut telle qu’il voulut naître dans la race la plus vile du monde, la race juive, et qu’il consentit, pour guérir les maladies dâme des siens, à se rabaisser au rôle de remède spirituel et à se donner sous l’aspect sans gloire d’un cachet de pain ! mais, à l’étranger, alors que, depuis des semaines, l’on vit, sans églises où l’on puisse à toute heure entrer, au milieu de personnes dont on ne comprend pas le langage, l’impression d’allégresse, de paix, que l’on ressent à entendre la langue latine de l’Église, à se retrouver subitement dans son milieu de prières, est vraiment exquise.
Il semble que l’on soit un enfant perdu qui reconnaît les siens, un sourd qui recouvre le sens de l’ouïe ; on a envie de presser la main à tous ces braves fidèles qui vous entourent et qui, dans un idiome différent, aiment et croient comme vous ; on se rend compte plus aisément de cette vraie fraternité qui dut unir les premiers chrétiens semés dans la foule des idolâtres.
Ce qui était étonnant, il sied de le dire aussi, c’était, dans ce sanctuaire inconnu, le nombre des hommes qui priaient ; c’était l’ardente ferveur de ces catholiques que l’on voyait si foncièrement, si simplement pieux.
Et une fois retournés à l’hôtel où les excellentes gens qui nous reçoivent sont, eux aussi, des orthodoxes, nous apprenons que Schiedam possède trois églises et que sainte Lydwine est la patronne et la maîtresse absolue de la ville.
Dans cette salle à manger du Hoogstraat où nous sommes si bien à l’aise, chez nous, dans un coin tiède et douillet, des bouffées de souvenirs de famille et d’enfance me remontent, suscitées par le parfum de la pièce, par ce parfum si spécial aux intérieurs du pays et qui est fait de pain d’épice et de thé, de gingembre et de cannelle, de salaisons et de fumures, une exhalaison blonde et tirant sur le roux, une émanation à la fois douce et acérée, très fine, qui me remémore tant d’amicales salles à manger, au moment des légers repas et qui subsiste, sans s’effacer complètement, alors même que la dînette est finie.
Toute la petite et la délicieuse Hollande se lève, ici, pour nous accueillir et nous souhaite, après Lydwine dont elle nous rappelle les célestes effluves, la plus aimable des bienvenues, en ce dialecte odorant, en ce salut d’aromes.
Le lendemain, nous allons visiter les églises et notre surprise de la veille s’accroît ; ce n’est pas un dimanche et beaucoup d’assistants suivent les messes, communient avant ou après le sacrifice, ainsi qu’il est d’usage, ici.
De ces trois églises toujours pleines, deux appartiennent aux dominicains qui, dans un pays protestant, ne peuvent revêtir le costume de leur ordre ; l’une de ces églises, placée sous le vocable de saint Jean-Baptiste, est celle où nous nous sommes introduits, par hasard, hier. Avec le jour, le charme tomberait si la vie de prières qui l’anime ne compensait le peu d’attrait que provoque la banale laideur de sa nef. Soutenue par des piliers à chapiteaux toscans, elle est d’un style chagrin, inclassable, et cette image de la sainte entrevue dans une échappée d’ombre est un vulgaire plâtre peint.
L’autre église, dite du Rosaire, est bâtie, mi-partie brique et mi-partie pierre, et éclairée par des vitres vertes ; elle simule assez gauchement le style gothique, mais elle est néanmoins plus allègre que l’autre et plus prévenante ; la chapelle dédiée à sainte Lydwine est agrémentée de vitraux sur lesquels figurent différents épisodes de sa vie, et d’une statue achetée dans le commerce et qui n’a rien à voir, de près ou de loin, avec une oeuvre d’art.
L’église de beaucoup la mieux est la troisième, l’église paroissiale, desservie, celle-là, par un curé et des vicaires et baptisée du nom de la Visitation de Notre-Dame ; moderne, ainsi que les deux autres ; elle imite également le style ogival ; elle est sans élégance et elle est nue, mais elle détient une incomparable chapelle, tout imprégnée de sainte Lydwine dont elle conserve les reliques cédées par les Carmélites de Bruxelles.
Cette chapelle qui est presque un minuscule oratoire, à la décrire, serait nulle ; son charme réside en son atmosphère saturée de souvenirs et de grâces et non dans sa coque, qui avec ses poutres et ses panneaux de bois blanc parait temporaire et est, en tout cas, inachevée ; il semble que le terrain ait manqué et qu’on ait emprunté pour la construire la place d’une petite cour ; seulement l’intimité de ce sanctuaire que n’offensent point ces bondieuseries qui gâtent les autres églises, est délicieuse.
Au fond, se dresse un autel très simple, de forme gothique, ornementé de croix et de passiflores et surmonté d’une statue de la sainte debout et à laquelle l’ange remet des roses, une statue inspirée de la statuaire des Primitifs, la seule vraiment convenable que nous ayons encore rencontrée dans ce pays ; et, sur le devant de l’autel, encastré dans la boiserie, un basrelief de marbre représente encore la sainte, mais couchée, cette fois, et l’ange lui apporte également la symbolique branche.
Malgré son concept classique et son ordonnance un peu prévue, ce bas-relief qui est l’ouvrage de M. Stracké, un sculpteur de Harlem, intéresse;. et tandis que je l’examine de près, je me dis : Où ai-je déjà contemplé cette figure couverte d’un bonnet, enveloppée de bandelettes, regardant un crucifix, fixé entre ses deux mains ? Et l’héritière de Lydwine, la soeur Emmerich, surgit soudain devant moi, sur son lit, telle que la dessina Clément Brentano et qu’Édouard Steinle la grava ; et j’avoue que je trouve vraiment ingénieuse l’idée de l’artiste qui, ne pouvant consulter aucun portrait authentique de la sainte, s’inspira de l’attitude, des traits pris sur le vif de sa plus parfaite image, de sa soeur en Dieu, pour nous la montrer.
Des tableaux du peintre Jan Dunselman doivent compléter la parure de cette chapelle ; cinq sont déjà en place et trois restent à livrer. Parmi ces toiles qui racontent les principaux événements de la biographie de Lydwine, l’une nous relate la chute sur la glace, en une langue qui se souvient un peu de celle de Leys ; et ce panneau, avec la petite maison de la sainte, en bois et en briques, la porte à pentures, les fenêtres résillées de plomb, les groupes des filles qui entourent l’enfant tombée dans la neige, les hommes qui ont froid et flânent, distraits, sans croire à la gravité de l’accident, tandis que, sur la droite, un vieux balayeur sort du cadre, aux cris d’une fillette, affolée par la peur, est expertement agencé et alertement peint ; c’est une oeuvre moyenne, et observée. Je ne puis cependant me convaincre que la petite Lydwine avait ce nez allongé sous des yeux à fleur de tête et cette bouche commune. Logiquement elle eût dû apparaître, dans ces ouvrages, horrible, car elle était déjà maigre et laide lorsqu’elle se brisa une côte ; mais étant donné que l’artiste n’a pas, avec raison, je pense, tenu compte de la vérité historique en cette oeuvre — car il aurait fallu du génie pour dégager la splendeur de l’âme de son cercueil de chairs ! — j’aurais voulu alors qu’il imaginât une Lydwine et plus éclairée et plus fine.
Elle fut jolie, belle de corps, d’une taille élégante et sa voix était douce et sonore ; c’est à peu près tout ce que nous apprennent ses monographes ; c’est court, mais enfin, ils s’entendent pourtant à la faire plus accorte, plus distinguée surtout que ne la conçut le peintre.
Vraiment, je crois bien que, personnellement, je la vis, un dimanche, parmi les orphelines que les soeurs dominicaines conduisaient, dans cette église même, à la messe ; elle était agenouillée, tendue vers l’autel, égrenant son chapelet ; elle avait de grands yeux d’un bleu avoisinant le vert et, sous le bonnet noir, s’échappaient d’admirables cheveux, de ces cheveux qui, cendrés près des racines, se dorent à mesure qu’ils s’en éloignent ; l’on eût dit d’un écheveau de soie éclairé par un rayon de soleil hivernal ; et la tenue de cette enfant, au teint blanc, à peine teinté de rose sur les joues, aux lèvres de fleur qui s’épanouit alors que commence à la friper le gel, était si modeste, si pieuse, si vraiment confinée en Dieu, que je ne pouvais me persuader que Lydwine eût été différente.
Ainsi que je l’ai dit, aucune image véridique de sa physionomie n’existe ; sur les vingt tableaux marqués par Molanus, comme ayant autrefois orné les murs de la chapelle édifiée en son honneur par les recteurs de Schiedam, douze ont été reproduits en un insignifiant format, au seizième siècle, par le graveur Jérôme Wierix ; ils cernent, de médaillons, un portrait plus grand de la sainte recevant des mains de son ange la fameuse branche. Il est difficile de créer un type conventionnel plus redondant à la fois et plus piètre que celui de cette estampe ; on ne sait si Lydwine est un garçon ou une fille, car elle y grimace ainsi qu’un être hybride dont le nez busqué et fend en deux une face privée de menton.
D’autre part, j’ai considéré chez un habitant de Schiedam une très belle gravure de Valdor, du commencement du dix-septième siècle, qui la portraiture ; elle y est plus sensément traitée, mais ce n’est sûrement pas encore elle ; d’autres médiocres de Pietro de Jode, de Sébastien Leclerc l’exhibent brandissant une croix, une couronne, ou une tige de rose, ou une palme, seule ou accompagnée d’un ange ; une dernière enfin, toute moderne, celle-là, mais assez curieuse, en tant qu’imitation des tableaux des Primitifs, est l’oeuvre d’un peintre allemand Ludwig Seitz ; c’est une des mieux ; mais dans celle-là, de même que dans toutes les autres, le visage, plus ou moins persuasif, est inventé.
Il est donc, en somme, permis, puisque rien de certain ne subsiste, de nous la figurer selon nos conceptions d’art et nos appétences de piété.
Et, ce dimanche, où j’entrevis cette extraordinaire fillette, nous pouvions véritablement nous certifier les premières impressions éprouvées dans cette ville ; les églises débordaient, étaient insuffisantes à contenir la foule des orants ; à la Visitation de Notre-Dame, des gens lisaient leur missel devant les portes laissées ouvertes, au seuil de la rue ; les communions ne décessaient pas ; après les hommes et les femmes, les pensionnats s’ébranlaient ; nulle part, nous n’avions encore constaté une si placide ardeur et j’ajouterai un respect plus absolu de la liturgie, du plain-chant exécuté non par des chantres gagés, mais par des personnes de bonne volonté, ayant de la voix et s’equittant consciencieusement de leur tâche, décidées pour honorer le Seigneur, à très bien chanter.
Cette petite chapelle de sainte Lydwine, dans les heures qui s’attristent, elle émerge de mes souvenirs, si lénitive, si familièrement attendrie ! Et comment ne pas me rappeler aussi le cordial et le délicat accueil de son pieux et savant curé, M. l’abbé Poelhekke, qui célébra, un matin, pour nous, la messe à son autel sur lequel il avait voulu exposer, comme en un jour de fête, la châsse des reliques.
Sauf ces ossements et sa mémoire qui resplendit dans cette ville, rien hélas ! ne reste, ici, de Lydwine, sinon sa plaque tombale ; elle a été ôtée de l’ancienne église désaffectée et muée en un temple protestant et transférée dans la petite chapelle des soeurs dominicaines qui tiennent un orphelinat et font la classe aux enfants du peuple. Cette pierre est sculptée d’une figure âgée et un peu renfrognée de femme, endormie, les mains jointes sur le ventre, et enveloppée, de la tête aux pieds, d’un linceul ; en haut, deux angelots descendent pour lui ceindre d’une couronne le chef et, aux quatre coins, les quatre animaux évangéliques sont gravés dans un cercle.
Cette pierre est très bien conservée ; d’après une note des Bollandistes, les calvinistes l’auraient retournée, non pour la préserver, mais pour empêcher les catholiques de s’agenouiller devant ; d’après une autre tradition, au contraire, les protestants, par déférence pour la sainte, faisaient un détour dans l’église afin de ne pas marcher dessus et de ne point l’abîmer. Je ne sais laquelle de ces deux versions est la vraie ; je les donne telles quelles.
Quant à la bâtisse qu’elle occupa, elle est le sujet de nombreuses controverses que nous allons résumer en quelques lignes :
Selon les uns, sa maison aurait été située dans une sente appelée Bogaarstraat ; selon les autres dans une ruelle dite Kortekertstraat. Il y aurait eu jadis en cette ruelle, un puits qui guérissait les fiévreux et le bétail malade ; d’après d’anciens documents, à ce signe, l’on reconnaîtrait le gîte de la sainte ; des recherches ont été effectuées dans ce sens, mais le puits n’a pas encore été découvert ; enfin une troisième opinion qui semble la plus accréditée attribuerait sa résidence au Leliendaal là où s’élève encore un orphelinat protestant, une bâtisse du dix-huitième siècle, flanquée d’un bonhomme et d’une bonne femme sculptés et peints, de chaque côté, en haut de la porte.
Voici, dans tous les cas, l’histoire de la demeure de Lydwine.
Après sa mort, le fils du docteur Godfried de Haga acheta sa maison qui devint ce qu’on appelait « une maison du Saint-Esprit », c’est-à-dire un refuge de femmes pauvres ; puis en 1461, le jour de la fête de sainte Gertrude, cette maison qui renfermait une chapelle fut cédée, avec l’assentiment des bourgmestres et des conseillers de Schiedam, par le collège du Saint-Esprit à une communauté de clarisses ou de soeurs grises de Saint-François, venues de Harlem. Il y avait, dans ce couvent, dit Molanus, un autel dédié à sainte Lydwine et érigé juste à l’endroit où reposait son lit ; et l’on distribuait, tous les ans, le jour de sa fête, aux personnes riches ou pauvres qui se présentaient, un pain blanc.
En 1572, les gueux, après avoir dévasté l’église de Saint-Jean-Baptiste, démolirent la chapelle du Leliendaal et le cloître fut pillé. Il devint en 1605 un orphelinat qui fut rasé en 1779, car il tombait alors en ruine et reconstruit à la même place, c’est-à-dire à la place de la demeure de Lydwine.
Mais ce dernier point est justement celui qui n’est pas admis, sans conteste, par tous. Je n’ai pas à prendre part à ce débat qui n’intéresse d’ailleurs que les habitants de Schiedam ; je dois ajouter cependant qu’une quatrième opinion me fut exprimée à Amsterdam ; celle-là aurait l’avantage de mettre tout le monde d’accord, la voici : Lydwine aurait habité plusieurs logements et aurait été transportée, après la mort de ses père et mère, au domicile de son frère.
Je ne sais ce que vaut cette allégation dont je ne discerne dans les historiens aucune trace ; elle me suggère cependant une remarque.
Brugman nous raconte que la maison du père de Lydwine était basse et humide, plus semblable à une tombe qu’à une chaumine ; or, je me demande comment, dans une bicoque si exiguë, tant de personnes purent camper. Après la mort de son père, son fils, sa femme, ses deux enfants, un cousin nommé Nicolas, l’augustin Gerlac et finalement la veuve Catherine Simon y auraient résidé. Il est fort possible qu’ils n’y aient pas séjourné tous ensemble, au même moment, mais il n’en reste pas moins douteux que ce réduit ait pu être assez grand pour héberger autant d’hôtes. Il y aurait peut-être lieu de croire alors que la maison dans laquelle mourut Lydwine n’était pas la même que celle dans laquelle elle était née et avait vécu les premières années de ses souffrances.
L’emplacement du canal sur la glace duquel elle s’est brisé une côte, est le sujet de moins de débats ; les archéologues semblent d’accord pour désigner une rue qui s’affuble encore du nom de « chemin des boiteux », « Kreupelstraat » ; cette rue était un canal, il n’y a pas bien longtemps encore, car j’ai acquis, à Schiedam même, une photographie prise sur nature et qui le représente ; elle est sans caractère et il est difficile de s’imaginer le lieu exact où se passa la scène relatée par les biographes et peinte sur l’un des tableaux de l’église.
Du temps de Lydwine, il n’existe, en somme, que l’antique église de Saint-Jean-Baptiste, devenue un temple réformé ; mais la sainte n’y a pas, corporellement du moins, prié, puisque ce sanctuaire, brùlé dans l’incendie de 1428, fut rebâti, en partie, pendant sa vie, et alors qu’elle était alitée et ne pouvait sortir.
Cette église, la seule ancienne de Schiedam, est un édifice de brique, surmonté d’une haute tour coiffée d’un petit chapeau rajouté et attifée d’un très puéril carillon ; son intérieur, à ogives, est soutenu par sept piliers à chapiteaux sculptés de feuillages et plafonné de poutres ; sa nef est coupée en deux par un tablier de bois. Au dedans, ce sont des estrades de distribution de prix ou de foire foraine, des bancs d’oeuvre, des amas de bibles. La tristesse de ce sanctuaire souillé, sans autel et sans messes !
Plus que dans cette basilique, plus que dans ces rues que je viens de citer, le souvenir de Lydwine vous hante, alors qu’on erre dans les vieux quartiers de Schiedam, moins réparés et moins remis à neuf ; que de fois, le long de ces canaux ombragés d’arbres et dont les ponts tournent pour laisser filer les bateaux, nous l’avons évoquée, tandis que les grands moulins à vent bénissaient, avec la croix de leurs ailes, la ville ; elles dessinaient le rond d’une croix grecque et me rappelaient le mémorial de cette Passion que finit par méditer si ardemment la sainte ! et, pendant que ces croix silencieuses signaient l’horizon, au loin, un sergent de ville, débonnaire, malgré son casque à pointe et sa petite épée de chasse, surveillait les déchargeurs en vêtements de laine rouge et en culotte courte, qui débarquaient des tonnes sur le quai, les manoeuvres qui, devant les distilleries, pompaient la drèche chaude coulant en rigoles de café au lait dans les barques ; et moi, je songeais au père de Lydwine, au bon Pierre, qui avait été l’homme du guet, le sergent de ville de son époque, à Schiedam.
Devant nos pas, les rues d’eaux s’allongeaient, en tournoyant, plantées de moulins du dix-huitième siècle, superbes, avec leurs briques culottées, leurs grandes collerettes de bois, leurs petites croisées peintes en vert Véronèse ; leurs ailes parfois sans voiles simulaient alors des lames de rasoirs prêtes à fendre l’air ; et ces moulins apparaissaient géants à côté des tout Petits que l’on construit maintenant et qui sont revêtus, comme d’une houppelande de peluche grise, habillés comme avec des peaux veloutées de souris.
Et cette minuscule cité s’adorne de coins charmants ; dans les vieux quartiers que traverse la rivière à laquelle elle doit son nom, la Schie, ce sont des lacis de ruelles bordées par des bâtisses enfumées de briques, dessinant avec l’onde qui les mire d’amusantes courbes, d’antiques masures ajourées ainsi que des séchoirs de mégissiers ou précédées de hautes façades couvertes de grands toits qu’effleurent les mouettes ; et des files de sansonnets perchés sur leurs arêtes, de même que sur des bâtons, chantent.
Subitement, au détour d’une de ces sentes, d’immenses échappées de campagne fuient, des plaines encore coupées par des canaux qui font l’effet de marcher avec les nuages qu’ils réverbèrent. Très au loin, des mâts de navires qu’on ne voit point semblent piqués en terre ; une voile se déplace et, derrière elle, le bras du moulin, qu’elle cachait, surgit ; des vaches blanches tachées d’encre, des moutons, des pourceaux noirs et roses s’aperçoivent, à perte de vue, sous l’infini d’un ciel que rien n’arrête ; et, à regarder ces végétations si fraîches et si vertes, qu’en comparaison de celles-là, les prairies les mieux arrosées de la France, sont jaunes et sèches ; à contempler ce firmament d’un bleu pâle, presque polaire, que bouillonnent des nuées d’argent qui se dore, une très douce mélancolie nous vient.
Ces sites placides, ces étendues taciturnes, ces paysages graves ont quelque chose de personnel, un je ne sais quoi d’affectueux et de quiet ; le charme de cette nature si spéciale tient, je crois, à cette bonhomie qu’elle dégage, une bonhomie qui sourit, un peu triste, et se recueille.
Comme contraste à ces plaines et à ces petites rues qui s’embrouillent dans d’étroits canaux, à l’autre extrémité de la ville, s’épand un fleuve immense, la Meuse ; elle se jette, à cet endroit, dans la mer. Au fond, Rotterdam émerge de l’eau avec ses monuments dressés sur le ciel qui s’illimité ; les petits vapeurs qui assurent le service des côtes fument à l’horizon, tandis que le souffle d’une formidable fabrique de bougies domine tous ces bruits ; le quai est hérissé de grues à vapeur et comblé de tonnes. Ce rappel de la vie moderne, dans le pays de Lydwine, déconcerte et l’on se prend à regretter le temps où de maladroits pêcheurs incendièrent Schiedam, la veille du jour où ils s’embarquèrent sur ces plages alors vides, pour aller pêcher le hareng.
Et, à ce propos d’incendie, ne faut-il pas noter que la sainte, qui en subit trois, de son vivant, est ici considérée, même par les protestants, comme une sauvegarde contre les ravages du feu ; il n’existe pas, en effet, d’exemple que lorsqu’une usine d’alcool flambe, celles qui l’avoisinent s’enflamment ; Lydwine est aussi, cela va de soi, invoquée pour la guérison des malades ; l’on prête à la cure un petit philactère d’argent contenant quelques-unes de ses parcelles, pour les faire toucher à ceux qui souffrent et, tous les lundis, à sept heures du soir, on la prie, avant le Salut du Saint-Sacrement, afin qu’elle détourne les fléaux de la ville.
Elle vit, on le voit, à Schiedam où les catholiques la vénèrent et où il sied de dire, pour être juste, que les réformés ne lui sont nullement hostiles ; elle compte des amis à Harlem, mais plus loin, son souvenir s’efface.
Voilà déjà près de douze jours que nous habitons la minime cité et, en sus de son aspect extérieur, nous commençons à connaître ses antécédents et à pénétrer dans sa vie intime.
Schiedam ne fut jamais une grande ville, mais elle fut jadis un bourg prospère. Maintenant, elle décline ; les anciennes familles riches sont parties ; son industrie particulière, celle du genièvre, du schiedam qui lui emprunte son titre, est bien déchue, depuis que des villes telles qu’Anvers se sont décidées, elles aussi, à fabriquer les eaux-de-vie de grains. Elle possédait autrefois trois cents distilleries et l’on en compte à peine, à l’heure actuelle, cent vingt. Où sont les bateaux qui arrivaient naguère de Norvège avec leur cargaison de grains bleus ? Je n’en ai découvert aucun et je doute un peu que le fruit du genévrier entre désormais dans la confection de cette magnanime liqueur. Elle semble préparée, ainsi que le whiskey d’Irlande et le gin d’Écosse, avec le blé, le mais et l’orge ; et c’est, par toutes les rues, près des canaux, non l’odeur un peu d’allumette des vrais genièvres, mais la senteur de la farine de lin chaude, de la drèche, des résidus en bouillie de l’orge. On les évacue, à la sortie des usines, dans des citernes, le long des quais et, là, des hommes les pompent et les déversent dans des barques, pour servir à la nourriture des bestiaux.
La population de la ville peut se composer de 13.000 réformés, de 10.000 catholiques, de 60 ou de 70 jansénistes et de 200 juifs.
Les catholiques y sont donc en minorité, de même que dans la plupart des villes des Pays-Bas ; et c’est sans doute pourquoi ils se serrent si délibérément les coudes et forment une colonie modèle de gens pieux. Un catholique qui ne l’est que de nom et qui ne pratique pas, est rare, ici ; il n’y a décidément rien de tel que d’avoir été persécuté à cause de sa religion, pour vous la rendre chère ; si le calvinisme a décimé les ouailles du Seigneur, il faut avouer qu’il a singulièrement virilisé celles qui lui résistèrent ; le catholicisme néerlandais, tel que je l’observe ici, n’a rien de ce côté efféminé qui s’affirme de plus en plus dans les races latines. Il adore un Christ au corps impartible, en croix, qu’il ne relègue pas, ainsi que trop souvent chez nous, après ses saints.
En un mot, il est un catholicisme simple, un catholicisme mâle ; il convient de déclarer aussi qu’en Hollande, le clergé est excellent ; dispensé de l’éducation subalterne de nos séminaires, alimenté par de fortes études, il n’est pas soumis à ces préjugés qui font de nos ecclésiastiques une classe du monde, à part ; le prêtre hollandais est un homme comme un autre, mêlé, de même que n’importe qui, à la vie commune ; il est plus indépendant que chez nous, mais son existence s’écoule au grand jour et c’est justement parce qu’il n’a rien d’obscur, rien de caché, qu’il impose le respect, même aux cultes dissidents, par la dignité de sa vie, par la ferveur indiscutée de sa foi, par l’honnêteté reconnue de son sacerdoce.
Sa tâche n’est pas des plus faciles. Il faut veiller à la sécurité d’un troupeau parqué au milieu du camp des infidèles et l’accroître, s’il se peut ; mais là, il se heurte à de terribles bornes, car ce n’est que lentement que le Pays plat revient à ses premières croyances ; il y a un motif pour cela ; la défense acharnée du temple, la mise en quarantaine par les protestants des convertis ; il faut donc des cas bien exceptionnels pour qu’un égaré rentre au bercail ; il faut qu’il puisse se passer de l’aide de ses anciens coreligionnaires qui, avec les jansénistes, détiennent l’argent.
Car la richesse est chez ces sectes, chez les jansénistes surtout ; la boîte à Perrette a fait des petits ; ceux-là distribuent, pour les convaincre, d’efficaces prébendes à ceux qui se marient en leurs églises. Il ne siérait pas, sur ce mot de janséniste, de se figurer une religion prolongée de Port-Royal, de chrétiens ascétiques péchant par excès de scrupules. Les disciples de Port-Royal qui furent très intéressants, en somme, ne sont plus ; leurs successeurs sont de honteux hétérodoxes, de troubles protestants ; s’ils pèchent, ce n’est plus par outrance de rigorisme, ce serait plutôt le contraire ; Jansénius s’est marié et Quesnel a, lui aussi, pris femme ; ils sont devenus des Hyacinthe Loyson ; leur hérésie est une hérésie de coffre-fort et de pot-au-feu !
Cette Hollande qui, avec son archevêché janséniste d’Utrecht, est le dernier refuge de ce schisme, cette Hollande qui est surtout un incontestable repaire d’hérétiques, — car, si j’en crois l’annuaire du clergé, elle compterait, sur une population approximative de 4.800.000 habitants, 1.700.000 catholiques, soit un peu moins de 35 pour cent, — elle a été pourtant une terre sanctifiée, une pépinière dans laquelle la culture monastique fut intense ! les bénédictins, les cisterciens, les prémontrés, les dominicains, les augustins, les franciscains, les croisiers, les alexiens, les chartreux, les antonites y ont bâti les plus florissants des cloîtres. La Frise avait, à elle seule, 90 monastères et abbayes et, dans la seule province d’Utrecht, dit Dom Pitra, l’on a retrouvé 198 fondations d’ordres. Tout à disparu dans la tourmente.
Dans ce pays de saint Éloi, de saint Willibrord, de saint Wérenfride, de saint Willehah, de saint Boniface, de saint Odulfe, de sainte Lydwine, malgré les persécutions qui s’y révélèrent terribles, le culte catholique s’est quand même maintenu ; il a beau être noyé dans la masse de cette religion réformée suivant la confession de Calvin, il s’étend.
En 1897 un journal hollandais, le Katholicke Werkman, dénombrait ainsi les institutions catholiques des Pays-Bas : 96 maisons de religieux desservant 66 paroisses et instruisant dans les lycées 725 élèves ; 44 maisons de frères, soignant des malades, des aliénés, des orphelins, des sourds-muets, des vieillards, et faisant la classe à 1.035 pensionnaires et à 12.120 élèves ; 22 maisons de moniales vouées à la vie contemplative ; 430 maisons de soeurs hospitalières prenant soin de 12.000 orphelins et d’incurables et d’aveugles. On enregistrait, en somme, à cette époque, 592 couvents en Hollande.
D’après une autre statistique parue en 1900 dans le Residentiebode, de la Haye, la Néerlande énumérait :
En 1784 : 350 paroisses et 400 prêtres ; en 1815 : 673 paroisses et 975 prêtres ; en 1860 : 918 paroisses et 1.800 prêtres ; en 1877 : 985 paroisses et 2.093 prêtres ; et, en 1900 : 1.014 paroisses et 2.310 prêtres.
La progression est lente mais sensible ; l’Église réoccupe, peu à peu, ce sol, qui fut sien ; les anciennes semailles engourdies dans cette terre que la Réforme dessécha, lèvent ; l’on entend, dans la région des Tropiques, pousser certains roseaux ; il semble que si l’on écoutait bien dans les Pays-Bas, l’on entendrait les vieux ossements et la poudre de ses très antiques saints, bruire.
Ligugé. Fête de sainte Scholastique, 11 février 1901.