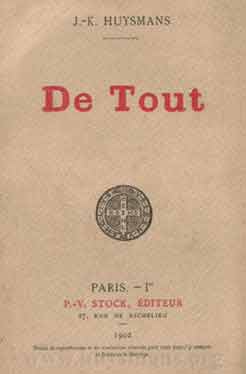LES HABITUÉS DE CAFÉ
CERTAINS breuvages présentent cette particularité qu’ils perdent leur saveur, leur goût, leur raison d’être, quand on les boit autre part que dans les cafés. Chez un ami, chez soi, ils deviennent apocryphes, comme grossiers, presque choquants. Tels les apéritifs. Tout homme, — s’il n’est alcoolique, — comprend qu’une absinthe, préparée dans une salle à manger, est sans plaisir pour la bouche, malséante et vide. Enlevés de leur nécessaire milieu, les dérivés de l’absinthe et de l’orange, les vermouths et les bitters blessent par la brutalité de leur saveur ardente et dure. Et qui dira la liquide horreur de ces mixtures ! — Servies dans de pâles guinguettes on dans d’opulents cafés, ces boissons fleurent les plus redoutables des vénéfices. Aiguisée par de l’anisette, assouplie par de l’orgeat ou de la gomme, devenue plus débonnaire par la fonte du sucre, l’absinthe sent quand même les sels de cuivre, laisse au palais le goût d’un bouton de métal longuement sucé par un temps mou. Les amers semblent des extraits de chicotin, rehaussés du suc de coloquinte et chargés de fiel ; les bitters rappellent des eaux de Botot ratées et rendues acerbes par des macérations de quassia et de suie ; les malagas sont des sauces longtemps oubliées de pruneaux trop cuits ; les madères et les vermouths sont des vins blancs croupis, des vinaigres traités à la gomme-gutte et aromatisés par on ne sait quelle infâme décoction de plantes !
Et pourtant, ces apéritifs, qui coupent l’appétit, — tout homme dont ils gâtèrent l’estomac : l’avoue, — s’imposent aux imprudents qui les dégustent, une fois, devant une table à plate-forme, mal essuyée, de marbre. Fatalement, ces gens reviennent et bientôt absorbent, à la même heure, chaque jour, des corrosifs qu’ils pourraient cependant se procurer, de qualité moins pernicieuse, de prix plus bas, chez des marchands, et savourer, mieux assis, chez eux. Mais ils sont obsédés par la hantise du lieu public ; c’est là que le mystère du café commence.
Parmi l’immense population de Paris, asservie, damnée par cette coutume, plusieurs catégories existent.
Les uns fréquentent régulièrement tel café, afin d’entretenir une clientèle qui s’y désaltère, d’amorcer des commandes ou d’apprêter avec d’autres habitués quelques-uns de ses spécieux larcins que la langue commerciale qualifie de « bonnes affaires » .
Les autres y vont pour satisfaire leur passion du jeu, poussent sur le pré tondu d’un billard de bruyantes billes, remuent d’aigres dominos, de fracassants jacquets, ou graissent, en se disputant, de silencieuses cartes.
D’autres fuient dans ces réunions les maussaderies d’un ménage où le diner n’est jamais prêt, où la femme bougonne au-dessus d’un enfant qui crie.
D’autres viennent simplement pour s’ingurgiter les contenus variés de nombreux verres.
D’autres encore recherchent des personnes résignées sur lesquelles ils puissent déverser les bavardages politiques dont ils sont pleins.
D’autres enfin, célibataires, ne veulent point dépenser chez eux de l’huile, du charbon, un journal, et ils réalisent d’incertaines économies, en s’éternisant devant une consommation, à la saveur épuisée par des carafes d’eau.
Qui ne les connaît, ces habitués ? Dans des livrées de café diverses, ce sont, plus on moins riches, mais d’une indigence de cerveau semblable, les mêmes magasiniers échappés pour une heure on deux de leurs boutiques, les mêmes négociants assermentés des estaminets voisins des boulevards, les mêmes courtiers ramassant d’analogues affaires derrière la Bourse, les mêmes journalistes en quête d’articles, les mêmes bohèmes à l’affût de crédit, les mêmes employés gorgés de plaintes ; tous se cherchent dans la fumée en clignant les yeux, et le garçon qu’ils hèlent par son prénom s’enfuit. Une fois installés, ils fument, crachent entre leurs jambes, échangent des aperçus sans nouveauté entre deux parties de cartes. Une certaine cordialité défiante se décèle entre gens d’un métier pareil ; une sorte de politesse commerciale réglemente ce débraiIIé d’hommes, à l’aise, loin des fernmes. Les coulissiers s’exceptent pourtant ; pendant la Bourse, ils entrent dans leurs cafés, ne disent ni bonjour, ni bonsoir, ne se saluent même pas, causent à la cantonade, boivent une gorgée de boue verte et, sans même toucher de la main à leur chapeau, se bousculent et sortent sans fermer les portes.
L’attrait que le café exerce sur ce genre d’habitués s’explique, car iI est composé de desseins en jeu, de besoin de lucre, de repos avine, de joies bêtes. Mais en sus de ces habitués dont la psychologie est enfantine et dont la culture d’esprit est nulle, il en est d’autres sur lesquels l’influence despotique agit : des habitués riches on de vie large, célibataires invaincus sans ménage à fuir, gens sobres exécrant le jeu, ne parlant point, lisant les journaux à peine. Ceux-là sont les amateurs désintéressés, les habitués qui aiment le café, en dehors de toute préoccupation, en dehors de tout profit, pour lui-même.
Cette clientèle se recrute parmi de vieilles gens, surtout parmi des savants et des artistes, voire même parmi des prêtres. Forcément les excentriques et les maniaques abondent dans cette petite caste d’individus reunis et s’isolant dans une passion unique. A les observer, ces habitués se regardent en dessous, sans désir de se connaitre, mais ils ont la provisoire bien veillance des complices. Chacun d’eux a adopté une place qu’il ne quitte plus, et, d’un tacite accord, tous s’assoient devant leur table d’éIection, se passent la carafe d’eau frappée et les journaux, et se saluent en souriant, puis se griment d’une mine rêche comme pour prévenir des appats de politesse et des avances. Involontairement, ils regardent la pendule, constatent que le voisin d’ordinaire si exact est en retard, éprouvent un certain soulagement lorsqu’il arrive, une vague appréhension s’il ne vient pas. Ils s’y intéressent presque, non pour sa personne même, mais pour la place qu’elle occupe auprès d’eux, pour sa figure dont l’absence les contrarie, pour l’accessoire qu’elle est dans ce café dont le milieu fait de mille détails se désagrège si l’un d’eux se modifie ou manque.
Parfois, alors que, pendant plusieurs jours et pour des motifs certainement impérieux, le voisin se dérobe, l’habitué se hasarde, quand il paye sa consommation, à demander au garçon de ses nouvelles — et si cet inconnu revient, il s’incline devant lui, puis se concentre, taisant le souci qu’allège ce retour, souhaité par tous.
Il va de soi que ce n’est ni dans les brasseries aux foules néglig’ees et empuanties par de la fumée de pipe, ni dans les estaminets commerçants, ni dans les cafés de gala, que ces exceptionnels clients s’assemblent. Il leur faut, à eux, des cafés spéciaux, des cafés où survit la tenue surannée des anciens âges, des cafés où officient d’immuables garçons qui, à les fréquenter, se décolorent et se font même, par flatterie, pour les mieux : servir, plus vieux.
Et ces cafés d’aïeul, ces cafés immobiles dans le brouhaha d’un siècle, existent à Paris, sur la rive gauche de la Seine dont certains quartiers exhalent un fleur clérical et intime, antique et doux. C’est sur la lisière de ce sixième arrondissement, peuplé de prêtres et de relieurs, d’imagiers religieux et de libraires, que ces habitués se recrutent et façonnent à leur image des estaminets où l’on ne joue pas, oùi l’on parle à peine, oil l’on se comporte un peu comme dans un salon démodé de vieux veuf.
Le plus curieux, le plus typique d’eux tous est situé rue des Saints-Pères, au coin de la rue de l’Université, non loin du quai ; maison séculaire tenant à des prix epicés un restaurant de fine chère dans un salon à parmeaux blancs et or, tendus d’étoffe en damas vert, genre Empire, le café Caron étend une salle un peu sombre, propice aux yeux fatigués et, de même que la petite pièce où l’on mange, liserée de filets d’or sur fond blanc. Des glaces couvrent les murs, séparées entre elles par de minces colonnes plates, barrées de raies d’or. Des divans de velours amarante usé bordent, derrière les tables de marbre, toute la salle.
Près d’un escalier en vis qui conduit au desert d’un étage toujours vide, sous un oeil-de-boeuf, un comptoir en acajou orné de colonnes à chapiteaux de cuivre et d’une mythologie de secrétaire Empire, une Cérès de cuivre dans un char escorté de femmes vêtues d’étoffes à tubes et à plis et dansant sur un pied, les bras en l’air, est surmonté du livre courant des comptes au-dessus duquel, entre deux vases désargentés, une dame en noir aligne les identiques recettes que chaque jour apporte.
Au premier abord, ce café ne semble pas différent des bons vieux cercles de la province ; mais sa clientèle qui est vieillotte et bizarre, et qui ne fleure ni le cancanage, ni le désoeuvré mesquin d’une province, a déteint sur la physionomie et marqué d’une particulière étampe la sénilité de ses pièces.
Des moeurs maintenant abolies s’y révèlent ; les garçons chenus, blanchis sous de très anciens harnais, servent en silence, vous remercient du pourboire, vous mettent votre paletot, vous précèdent lorqu’on sort, ouvrent et ferment la porte, en vous rendant grâce d’être venu. Ces manières ne paraissent-elles pas étranges dans un temps oil tous les garçons de café ne répondent pas aux appels ou hurlent boum ! jonglent avec les carafes et les tasses, cabriolent avec les plateaux et les verres, et s’enfuient alors qu’on leur demande un journal ?
De même que les gargons qui semblent plus vieux que leur age, les bouteilles partout si tapageuses des liqueurs s’apprivoisent dans ce café, taisent leurs voyantes étiquettes, se vieillissent sans tirer l’oeil, sur la petite table où elles bivaquent.
Là seulement, réunies, se faisant valoir en un groupe non échelonné sur des étagères, elles font courtoisement ressortir leurs formes variées, presque féminines, quasi humaines : absinthes coiffées d’un capuchon d’argent et écartelées de la croix de Genève, avec le nom de Pernod sur fond cobalt ; amers Picon enveloppés comme les bonnes de chez Duval, du col aux pieds, par le tablier blanc de leur étiquette ; flacons de sirops et de gommes aux cous bossués de glandes, au buste couvert par la serviette en couleur d’une petite affiche ; nounous à bavettes de papier rouge et à grosses gorges, pleines de menthe verte ; commères à bedons pour le curaçao ; gamines brunes et nues, fleuries d’une feuille de vigne au bas du ventre, garçonnes grandelettes, sans poitrine et sans hanches, réservées aux présomptueuses impostures des fines champagnes et des grands cognacs !
Et c’est dans ce milieu douillet, aux tons tranquilles, qu’il faut observer le véritable habitué dont j’ai parlé, l’homme qui va au café sans intérêt de jeu puisqu’on n’y joue pas, d’affaires, car aucun négociant ne le fréquente, sans désir de conversation, car on n’y parle guere, sans même le besoin de pipes fumées, libre, car l’usage de la pipe y est interdit.
Très déserté le soir, il est de cinq à sept heures presque plein. Au fond, souvent, deux jeunes prêtres qui chuchotent en buvant un vermouth noyé d’eau ; parfois un autre plus âgé, aux vastes épaules, fit le Correspondant et prend des notes. Il est le voisin d’une tête socratique, avec un nez en as de trèfle, des moustaches en brosses à dents, grises, des yeux clairets, tamponnés, qui sautillent dans une face grenue, piquée de lentilles et de loupes, une face jaune de mongole. Obése, flottant malgré son ventre dans une culotte tire-bouchonnée qui tombe, vêtu de vêtements fripés et gras, coiffé d’un claque terne dont on voit les ressorts, il s’affaisse sur la banquette, enléve d’une petite serviette en toile eirée un manuscrit asiatique, et, cassé en deux sur la table, tirant sur un porte-cigarette en plâtre imitant l’écume, il souffle, relève la tête, apprête longuement le bain de Barèges de son absinthe, boit une gorgée, grimace, remet de Feau, remonte son pantalon, griffonne, avec un crayon dont il mouille le bout, sur les marges du manuscrit que ses doigts tapotent.
Et près de cet homme qui doit être ou professeur ou répétiteur à l’École des sciences orientales voisine, jaillit d’une masse de cheveux blancs la tête d’un savant juif ; avec sa barbe raide, en pointe, ses lunettes rondes, sa calotte de velours noir, on dirait, s’iI portait le rabbat blanc, d’un très antique rabbin. Celui-là boit une tasse de café et rêve, sans bouger, les yeux vides, pendant des heures ; puis il ôte sa calotte, l’engouffre dans le sac d’une immense poche, et, très poli, saluant très has avee l’un de ces antiques chapeaux noirs qui s’évasent comme des pots d’enfants, il disparaît toujours dans la rue, à gauche. Membre de l’une des sections scientifiques de l’Institut, il ne persécute point, ainsi que je le supposais, le texte reprisé du Talmud, mais il évoque sans doute, sur les murs de la salle, une saltarelle de signes algébriques, décante les nombres qui cavalcadent devant lui, en un mirage de pattes de mouche, les uns au-dessous des autres. Et au moment où il sort, apparait sur le seuil une tête porcine, un groin qui remue entre deux petits yeux rusés, au-dessus d’une vaste bouche aux larges Ièvres et entre un vieux homme à carrure bourguignonne, l’air bon enfant et narquois, gourmand et pingre. Celui-ci porte encore le col en gueule de brochet, la cravate blanche à trois tours, l’ancien goître, rattaché sur le devant par un tout petit noeud, et il arbore la redingote ancestrale, la redingote verte du portier. Il dépose soigneusement le parapluie rouge à bec-de-cane qu’il traine par tous les temps et se fait servir le bitter spécial à la maison, le bitter pour exportation de la Hollande. Maître du droit féodal, inquisiteur des capitulaires et des coutumiers, ce Jurisconsulte du nom de Coquille écrit dans les journaux religieux d’incommensurables articles, pieux et lourds. D’un geste m’prisant, il repousse les feuilles que les garçons empressés apportent, se rentre la tête dans le cou, somnole ou songe, en pianotant quelquefois de ses doigts spatulés le ballon de son verre. Parfois, il grimace un defférent sourire, alors qu’Eugène Veuillot vient s’asseoir près de lui et rit, en le regardant très-à-fond de ses yeux clairs. D’autres fois, avec un traducteur de Walter Scott, employé de la maison Didot, un petit homme grassouillet et gelé dont le crâne est ecclésiastiquement bouclé de cheveux très blancs, il ergote et son groin joyeusement s’effare, alors que l’autre, suçant un tout petit cigare, répond en baissant les yeux, d’un ton docte.
Çà et Ià quelques gens décorés lisant des journaux et des revues, buvant tous des bitters, puis, au fond du café, un inexplicable couple.
Un homme et une femme encore jeunes. L’homme, une figure d’officier — sorti du rang — tirée à droite par l’O majuscule d’un monocle ; la femme, une bourgeoise sans emphase et sans flaflas, peut-être aimable. Aussitôt assis, l’homme déplie un rouleau, tire des dessins ou des gravures, et longuement, en se tortillant la moustache, les regarde. Puis, un mot hésitant, très bas, à sa compagne qui les scrute et les replie ; alors, sans plus parler, l’homme s’allonge, les jambes tendues, son chapeau noir, à bords plats, en pot a beurre, sur la tête, les mains dans les poches, et il fume une cigarette, les yeux au ciel, tandis que la femme verse de l’eau glacée dans les bitters. Ces gens sont-ils des collectionneurs ou des marchands ? Mais s’ils achetaient et vendaient des dessins et des estampes, l’un des deux au moins garderait la boutique, et comment admettre, d’autre part, des amateurs qui trouveraient tous les jours une aubaine ? — Comme ils sont venus, sans bruit, ils partent, bras dessus, bras dessous, unis en un couple aimant, l’homme ruminant on ne sait quoi, la femme souriant d’un sourire vague.
Tels les habitués de ce café, auxquels on peut adjoindre une sorte de pot à tabac, de gros Yankee muet qui s’absorbe dans les panaches de fumée déroulés du trone d’arbre qu’il a en bouche ; puis, devant une bouillie de vert-de-gris et de gomme, le triste paysagiste Harpignies qui dormasse, congestionné, sur des feuilles a images ; enfin, un homme plus jeune, pale et sec, coiffé de cheveux couleur de poussière, en brosse, pourvu d’un nez en sabre turc, d’une barbe blonde, d’yeux qui, sous d’épais sourcils, explorent les voisins, tandis que ses maigres doigts roulent les machinales cigarettes qu’il allume.
Une année, ce milieu placide s’attrista, sentit l’hospice, pua Bicêtre ; un vieillard hémiplégique et gateux était amené par une bonne qui le faisait asseoir, coupait du pain dans une tasse de café au lait, puis s’en allait et revenait chercher son maître, après une heure.
Ce malheureux était sinistre. Transporté par instants de silencieuses rages, il soulevait des tempêtes dans son café qu’il fouettait, en grognant, de ses mouillettes. Que venait-il faire là, lorsque, sans bouger, il aurait pu boire chez lui l’eau saumâtre d’un semblable bol ? — Personne ne le sut.
Il s’absenta, ne vint plus, et tous pensèrent qu’il était mort.
Disparu aussi un type des plus bizarres, un petit homme, goutteux, la tête dans les épaules, vetu par tous les temps, d’un mac-farlane et coiffé d’un chapeau mou. Il avait une face barbue, surmontée d’un long crâne, qui semblait ciré au siccatif, des yeux aigus et en garde, une physionomie attentive et mauvaise. Il dînait dans la salle du restaurant, entre quatre heures et demie et cinq heures, et rentrait dans la pièce commune, en tenant un morceau de pain. On apportait alors une assiette blanche sur laquelle il posait son cigare, puis une tasse de café et une carafe.
Debout, arpentant le plancher d’un bout à l’autre, il dénouait sa cravate et déboutonnait son gilet. Il allait ensuite s’asseoir, goûtait le café, émiettait son pain dedans, mangeait, vidait à mesure la carafe dans sa tasse, rallumait son cigare qui s’éteignait. Il réclamait enfin un verre et d’anciens journaux qu’il dépeçait en laniéres avec lesquelles il essuyait ses doigts qu’il trempait dans l’eau. Les garçons l’appelaient « monsieur le comte », et subissaient en souriant des rebuffades qu’il mâchonnait d’une voix zézayante, tout en faisant voyager sur son front la peau glissante, comme savonnée en dedans, de son crâne.
Ce vieillard débraillé, vêtu d’habits sordides, possédait quatre-vingt mille livres de rente et logeait dans un hôtel voisin, où ses exigences le faisaient haïr. Il était Italien, comte, avait été camérier secret du pape Pie Xl, et exilé par le cardinal Antonelli ; rentré en grâce, il est récemment parti pour Rome, où il a, sexagénaire et maniaque, épousé une jeune fille de dix-huit ans qu’il doit, ainsi que son mac-farlane, traîner dans les cafés.
Il a laissé ici comme une légende. Florentin, le très sénile garçon qui a si longtemps supporté ses acrimonies et ses frasques, perd toute solennité, rajeunit, s’éveille lorsqu’il en parle.
En supposant que cet ancien diplomate fut à Paris, — le bruit en courait du moins, — l’un des plus effilés espions du Vatican, ce n’était certainement pas dans ce café qu’il pouvait surprendre de précieux secrets. Alors, pourquoi y venait-il ? Mais pourquoi ces gens qu’il coudoyait, tous les jours, s’y attablaient-ils régulièrement, eux aussi ? L’appât d’un bitter roboratif, cordial, sûr, est insuffisant à expliquer cette coutume, d’autant que parmi ces habitués plusieurs ne savouraient point les rechigneuses délices de cet amer rose.
Dans l’une de ses boutades rapportées par M. Bergerat, M. Théophile Gautier affirme que l’attrait du café est triple. — Il satisfait d’abord, disait-il, un besoin de vie publique et se substitue à la vie de famille dont on est las. — Puis le café est le temple du dieu Tabac, et c’est là que l’on fume bien, et non ailleurs. — Enfin, ajoutait-il, sa séduction n’est que le goût de l’abrutissement par la boisson.
Ces motifs me semblent seulement applicables à quelques pochards et à quelques sots. Ils sont, en tout cas, subsidiaires. L’attirance des foules sur certaines personnes peut se démontrer en effet, et l’horreur de la solitude existe ; mais il n’en est pas du tabac comme de l’absinthe ou des vermouths ; tout le monde fume une cigarette dans son logis et n’a mil besoin de l’odeur d’un estaminet pour la humer. Et parmi les habitués, combien sont des gens sobres et qui boivent sans s’abrutir, comme le veut le bon Gautier !
Le contraire serait peut-être plus juste. L’habitué intelligent, savant, exceptionnel, j’en conviens, celui dont je parle et le seul qui soit intéressant, par sa culture même, a besoin de se visiter, de s’asseoir en soi-même, de rester seul pendant quelques minutes, loin d’amis, s’il est célibataire ; loin de sa femme, s’il est marié. Cette distraction de sa vie, il la savoure dans une atmosphère quiète, sur une berge propice, dans ce café mort. D’autre part, ces gens sont visiblement des gens très bien élevés, mais ils n’aiment pas le monde. Leur tenue et un certain laisser-aller le décèlent. La solution de l’énigme est peut-être là. Ces habitués trouvent une sorte de salon, mais un salon où l’on n’est pas forcé de s’habiller, de parler, de subir le bavardage exténuant des dames. Ils réalisent sans doute cet idéal de pouvoir songer et voyager en repos, au. loin, dans le tiède milieu d’une convenable compagnie muette.
Il faut croire cependant que cette clientèle restreinte de rêveurs, ne suffit pas à faire vivre les cafés qu’ils fréquentent, car le café Caron est mort de misère et a eté naturellement remplacé dans la rue des Saints-Pères par un bas zinc ; ses habitués errèrent pendant quelques jours, ne sachant plus que devenir, puis ils émigrèrent dans un lieu presque semblable, mais gâté pourtant par un élément militaire, au café d’Orsay, situé au coin de la rue du Bac et du quai ; ce café moribondait quand ils vinrent et ils l’achevèrent ; une inéluctable faillite l’emporta ; ce fut la fin de tout. Et depuis lors l’âme des habitués se désempare.