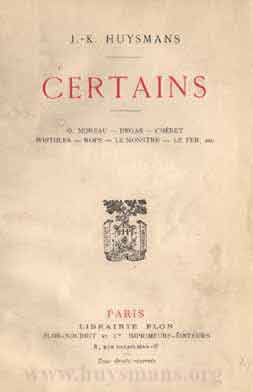Chéret.
SI j’étais l’homme qui incarne si formellement le goût du siècle, l’homme qui secrète la pensée de tout le monde et qui, par conséquent, professe pour l’art une insatiable haine, si j’étais M. Alphand, je voudrais interdire l’affichage des oeuvres de M. Chéret, le long des murs.
Elles gàtent, en effet, la taciturne tristesse de nos rues ; à l’heure qu’il est, les ingénieurs ont démoli les quelques maisons, les quelques sentes qui pouvaient demeurer aimables ; tous les coins intimes ont disparu, tous les vestiges des anciens âges sont tombés, tous les jardins sont morts ; le boulevard Saint-Germain, l’avenue de Messine s’imposent comme le type du Paris moderne ; nous ne verrons bientôt plus que des rues rectilignes, coupées au cordeau, bordées de maisons glaciales, de bàtisses peintes au lait de chaux, d’édifices plats et mornes, dont l’aspect dégage un ennui atroce.
L’irrémédiable sottise des architectes a, du reste, ardemment suivi l’idéal casernier des ingénieurs ; le public est enfin satisfait car aucune oeuvre d’art n’offusquera plus désormais sa vue. Il est d’ailleurs convaincu que Paris est sain. Jadis les rues étaient étroites et les logis vastes, maintenant les rues sont énormes et les chambres microscopiques et privées d’air ; l’espace demeure le même, mais se répartit de façon autre ; il parait qu’au point de vue de l’hygiène, cela constitue un exorbitant bénéfice.
Toujours est-il que sur cette teinte générale, d’un gris morose, les affiches de M. Chéret détonnent et qu’elles déséquilibrent, par l’intrusion subite de leur joie, l’immobile monotonie d’un décor pénitentiaire enfin posé ; cette dissonance compromet l’ensemble de l’oeuvre réalisée par M. Alphand.
Autrefois, en effet, les placards en couleur sur les palissades des maisons en construction ou le long des murs étaient d’une telle laideur qu’en dépit de leurs tons crus, ils s’harmonisaient avec la teinte des alentours. La tristesse sourde et le cri coriace se mariaient à peu près, faisaient presque bon ménage, ne blessaient pas, en tout cas, par un faux accord. M. Chéret a changé cela ; mais, on peut le dire, lui ou la rue, l’un des deux tel qu’il est, n’a pas de raison d’être.
Il est, on le conçoit, impossible de rendre compte, par le menu, de l’oeuvre de M. Chéret qui a dessiné des milliers d’affiches, qui, dans ce journalisme, au jour le jour, de la peinture, s’est révélé véritable écrivain, très authentique peintre. Je ne puis donc que noter, en examinant quelques-unes de ses planches, les très spéciales qualités qu’elles décèlent.
M. Chéret a d’abord le sens de la joie, mais de la joie telle qu’elle se peut comprendre sans être abjecte, de la joie frénétique et narquoise, comme glacée de la pantomime, une joie que son excès même exhausse, en la rapprochant presque de la douleur.
Plusieurs de ses affiches l’attestent. Qui ne se rappelle, parmi ses nombreuses illustrations, celles qui célèbrent le Pierrot, ce Pierrot en habit noir qu’il arbora le premier et qu’a repris, à sa suite, M. Willette ? Qui ne se rappelle l’incompressible gaieté de son Agoust conduisant la pantomime des Hanlon-Lees, dans Do mi sol do ? Cet homme, en maillot vermillon, agitant un crâne piriforme surmonté de deux touffes de cheveux en escalade, projetant les yeux hors du front, tordant sa bouche en fer à cheval, dans un rire d’hospice, s’enlevait en l’air, et fouettait à tour de bras, le délire de l’orchestre audessus duquel passait subitement, en pétillant comme une fusée, un minuscule train. Agoust devenait presque satanique dans ce dessin qui bondissait, étoffé de rouge sur un fond verdâtre pointillé d’encre, surmonté d’éclatantes lettres blanches, doublées de noir.
Cette joie démentielle, presque explosible, il l’exprimait aussi sur une couverture bleue et jaune, qu’il fit pour un volume de M. Duval, « Paris qui rit ; » là, c’était une sarabande de gens se culbutant, se roulant, dans des accès d’allegresse folle. Une sorte de gnaff, un Auvergnat, se débridait la mâchoire, se trouait le mufle jusqu’à la luette ; un gommeux à la renverse, le chapeau envolé du crâne, bombait le ventre et se le tambourinait, pâmé, avec ses poings ; un petit trottin, un carton dans chaque main, ricanait d’un rire sournois, avec des lèvres mauvaises et des yeux pincés, un concierge pilait du poivre à force de s’esclaffer, une femme s’extravasait, la jambe en l’air, tandis qu’une petite fille, assise, les jambes écartées, les bras au ciel, éclatait en de jubilants cris ; M. Chéret avait noté toute une série de rires, et très finement observé la qualité de l’esprit et l’aloi de gaieté de tous ces gens.
Mais, parmi les innombrables affiches dans lesquelles il a raconté le rire, nulle ne fut plus surprenante que cet immense placard qu’il a peint pour l’Hippodrome, un Cadet-Roussel, à cheval, vêtu d’un costume d’incroyable, d’un pantalon à pont, d’un gilet à revers jaune serin, d’un habit noir, d’une cravate à goître et de bas chinés ; ce vieillard avec sa bouche ouverte jusqu’aux oreilles, débusquait ses gencives, pompait un nez montueux sur des pommettes roses, s’auréolait comme d’un nimbe de feu, avec le fond d’un parapluie de pourpre ; le cheval lancé au galop en pleine piste, l’homme débonnaire et jovial, de carrure superbe, exubéraient de vie ! A citer entre toutes aussi, une petite affiche qui servait d’annonce aux Folies-Bergère et portait ce titre : « la Musique de l’Avenir par les Bozza. »
Celle-là était, dans son genre, une vraie merveille ; elle mettait en scène une cascade de clowns habillés de tenues bizarres. En bas, un marmiton, bouleversé par un rire qui lui fendait la face et lui pochait un oeil, donnait des coups de pieds dans le vide et sonnait avec ses casseroles de la cymbale ; un peu plus haut, une sorte de Yankee flottant dans un pantalon à pattes d’éléphant et dans une veste à damier, blanche et verte, avançait un museau de singe et jouait comme du flageolet, bouchant avec ses doigts de fictifs trous, suçant, ainsi qu’une idéale flûte, le bec d’une burette à lampe ; plus haut, encore, un autre gâte-sauce se trémoussait, éperdu, en choquant des casseroles et des pincettes, alors qu’une vieille femme, en bonnet à ruches, à nez retroussé, à bandeaux plats, un galfâtre déguisé en vieille et tenant de la poseuse de sangsues et du fruitier soûl, tournait rageusement la manivelle d’un moulin à café, soutenu dans son vacarme par un margougnat de Grenelle qui battait, avec des assiettes, des cymbales sur une grosse caisse figurée par un obèse fût.
La gaieté torrentielle de cette affiche débordait vraiment de son léger cadre ; elle avait un diable au corps, un délirant surjet de vie, un pépiement d’oiseaux fous ! Ces êtres lancés à toute volée dans les airs étaient enlevés en des traits brefs et rapides, avec une alerte de dessin rare et la couleur, en ses larges plaques, incitait, elle aussi, à d’artistiques aises, avec son rose tendre commençant au bas de la page, se muant en rouge flamme derrière l’homme armé de la burette à huile, sautant, derrière le marmiton qui brandissait des pincettes, dans un opulent vert tilleul sur lequel l’annonce crevait en lettres blanches.
Cela donnait une note de joie nerveuse, unique en art. Mais en sus de cette dispense, M. Chéret a, dans des sujets moins spéciaux ou ne s’adaptant pas à des personnages précis, à des Pierrots, à des clowns dont les types doivent être formulés sur l’affiche, divulgué une très particulière vision du Parisianisme.
Vision superficielle et charmante, adorablement fausse, aperçue ainsi qu’au travers d’un optique de théàtre, dans une féerie, après un diner fin.
Dans cette essence de Paris qu’il distille, il abandonne l’affreuse lie, délaisse l’elixir même, si corrosif et si àcre, recueille seulement les bouillonnements gazeux, les bulles qui pétillent à la surface.
Il verse une légère ivresse de vin mousseux, une ivresse qui fume, teintée de rose ; il la personnifie, en quelque sorte, dans ses femmes délicieuses par leur débraillé qui bégaye et sourit, sans cri vulgaire. Il prend une fille du peuple à la mine polissonne, au nez inquiet, aux yeux qui s’allument et qui tremblent, il l’affine, la rend presque distinguée, sous ses oripeaux, fait d’elle comme une soubrette d’antan, une friponne élégante dont les écarts sont délicats ; l’on peut à ce propos, citer, entre beaucoup d’autres, une planche de bal masqué où un Mephisto noir et rouge enlève une danseuse dont les allures chiffonnées ravissent. Il fait, à ce point de vue, songer aux dessinateurs d’il y a cent ans, il est, si l’on peut dire, le XVIIIe du XIXe siècle !
Et ce coin spécial d’art qu’il affectionne se retrouve aussi dans ses enfants qu’il dessine avec une incomparable verve, un peu joufflus, éveillés, toujours heureux, car ils sont presque constamment environnés de jouets. Les interminables affiches qu’il a prodiguées aux magasins de nouveautés l’affirment. J’aime moins, par exemple, ses grands placards pour libraires, tels que celui qui annonce les Mystères de Paris ou le Drame de Pontcharra; là, la terreur exigée s’édulcore, l’horrible s’enjolive ; puis l’enfant qu’il fait si bien rire, pleure mal.
En résumé, si nous parcourons l’oeuvre de cet ingénieux fantaisiste, nous trouvons dans des sujets imposés, souvent rebelles, et avec une réticence forcèe de tons qui se résument en quelques-uns pour les tirages, une expression de vie très personnelle, décorative et humoriste, une senteur parisienne portée à son acuité suprême et se résolvant en ces gaz hilarants dont les effluences réjouissent et grisent les gens qui les aspirent.
Pour tout dire, l’oeuvre de M. Chéret est une dînette d’art, exquise.
Wisthler.
L’AUTEUR des vigilantes et sagaces « critiques d’avant-garde, » M. Théodore Duret qui défendit, l’un des premiers, Manet, les impressionnistes, tous les évadés des pénitenciers fructueux de l’art, nous apprend que M. James Mac Neil Wisthler naquit à Baltimore, d’un major de l’armée américaine, qu’il suivit comme Edgard Poe les cours de l’école militaire de West-Point, et qu’il s’empressa, comme le poète aussi, d’échapper à un avenir de casernes et de gardes.
Venu à Paris en 1857, il fréquente l’atelier de Gleyre, envoie aux salons officiels de 1859 et de 1860 des toiles que le jury repousse ; en 1863, il figure dans le salon des refusés avec une femme vêtue de blanc et se détachant sur un fond blanc. Voici la description de cette oeuvre, que je copie dans une brochure de Fernand Desnoyers devenue rare.
« La peinture la plus singulière, la plus originale est celle de M. Wisthler. La désignation de son tableau est La Fille Blanche. C’est le portrait d’un spirite, d’un médium. La figure, l’attitude, la physionomie, la couleur sont étranges. C’est tout à la fois simple et fantastique ; le visage a une expression tourmentée et charmante qui fixe l’attention. Il y a quelque chose de vague et de profond, dans le regard de cette jeune fille qui est d’une beauté si particulière que le public ne sait s’il doit la trouver laide ou jolie. Ce portrait est vivant, c’est une peinture remarquable, fine, une des plus originales qui aient passé sous les yeux du jury. »
En 1865, la douane de l’Institut laisse passer La Princesse des pays de la Porcelaine. « Une princesse des mille et un jours, lumineuse comme ces formes que l’imagination croit voir dans les nuages, est debout, la chevelure ébouriffée et laissant trainer sur un tapis à dessins bleu de ciel, ses draperies. Je souhaite que la mode vienne de son costume ; elle viendra peut-être cet hiver, à quelque bal de la cour où la princesse du pays de la porcelaine aura du succès : robe gris-perle à ramage, manteau de couleur safran, avec bouquet de fleurs tropicales, ceinture coquelicot, un éventail en plumes de paradis dans la main droite. Pour fond un paravent pâle et au-dessus un lambris blanchâtre. Comme fantaisie de coloriste, cette princesse est affolante. » (William Burger. Salon de 1865.)
En 1867, M. Wisthler exhibe une toile « Au piano, » et, installé depuis longtemps déjà en Angleterre, ne fait plus parler de lui, n’expose plus en France.
En 1878, cependant, le bruit d’un procès qu’il intente à M. Ruskin passe la Manche. Dans la Revue « Fors Clovigera », M. Ruskin, le défenseur des préraphaélites, déclarait, à propos de certains tableaux du peintre, entre autres de ses « Harmonies » et de ses « Nocturnes », qu’il avait vu ou connu, par ouï dire, bien des impudences de cockney, mais qu’il ne se serait jamais attendu à ce qu’un farceur vînt demander 200 guinées pour avoir jeté un pot de peinture à la face du public.(1) (A Londres, dans les Expositions, un registre est ouvert sur lequel le peintre inscrit le prix auquel il prétend coter son oeuvre.)
M. Wisthler s’indigne et, en bon Américain, actionne, pour dépréciation de sa marchandise, le critique, devant la Chambre de l’Echiquoùier, qui condamne à un liard de dommages-intérèts M. Ruskin.
Puis M. Wisthler se décide à exposer de nouveau en France. Il envoie au salon de 1882 un portrait noir, fantômatique, surtout bizarre. Ce n’est, en somme, que l’année suivante qu’il nous sera permis d’admirer l’extraordinaire personnalité de ce peintre.
Au salon officiel, il apporte le portrait de sa mère, une vieille dame se découpant de profil, dans ses vêtements noirs, sur un mur gris que continue un rideau noir, tacheté de blanc. C’est inquiétant, d’une couleur différente de celle que nous avons coutume de voir. La toile est, avec cela, à peine chargée, montrant, pour un peu, son grain. L’accord du gris et du noir de l’encre de chine était une joie pour les yeux surpris de ces lestes et profonds accords ; c’était de la peinture réaliste, toute intime, mais s’éployant déjà dans l’au-delà du rêve.
Presque en même temps, à l’exposition internationale de la rue de Sèze, il exhibe ses toiles fameuses à Londres, ses paysages de songes, son délicieux « Nocturne en argent et bleu », où monte dans l’azur une ville bâtie sur une rive ; son « Nocturne en noir et or », où des feux d’artifice crèvent de baguettes sanglantes et parsèment d’étoiles les ténèbres d’une épaisse nuit ; enfin, son « Nocturne en bleu et or », représentant une vue de la Tamise au-dessus de laquelle, dans une féerique brume, une lune d’or éclaire de ses pâles rayons l’indistincte forme des vaisseaux endormis à l’ancre.
Invinciblement, l’on songeait aux visions de Quincey, à ces fuites de rivières, à ces rêves fluides que détermine l’opium. Dans leur cadre d’or blême, vermicellés de bleu turquoise et piquetés d’argent, ces sites d’atmosphère et d’eau s’étendaient à l’infini, suggéraient des dodinements de pensées, transportaient sur des véhicules magiques dans des temps irrévolus, dans des limbes. C’était loin de la vie moderne, loin de tout, aux extrêmes confins de la peinture qui semblait s’évaporer en d’invisibles fumées de couleurs, sur ces légères toiles.
En 1884, l’artiste revient avec deux portraits, celui « de miss Alexander » et de « Carlyle ». L’historien qui eut la bonne foi d’avouer qu’au fond il n’y avait pas d’histoire véritable et qui a quelque part écrit cette décisive phrase : « L’on devrait bien élever des autels à la solitude et au silence », est assis de profil, la redingote noire, bouffante, le chapeau placé sur les genoux. Cette figure triste, un peu bourrue, avec sa barbe poivre et sel, respire et médite, lentement résume ; c’est un portrait qui pénètre sous la peau, met sur la physionomie du personnage un reflet des pensées qui l’habitent ; c’est un portrait d’àme ouverte, mais si étonnant qu’il puisse être, celui de miss Alexander me paraît plus admirable encore.
Imaginez une petite fille, d’un blond cendré, vêtue de blanc, tenant, à la main, un feutre gris, empanaché d’une plume et s’enlevant sur un panneau d’un gris ambré appuyé par le noir pur d’une plinthe ; une blondine, aristocratique et anémiée, cavalière et douce, une infante anglaise se mouvant dans une atmosphère d’un gris doré par dessous, d’un or effacé de vieux vermeil. C’est encore, dans son large fini, peint à peine, et autant que les Vélasquez, brossés d’une si belle pàte dans la gamme des gris d’argent, cela vit d’une vie intense !
Ainsi que dans les autres oeuvres de M. Wisthler, il y a, dans cette toile un coin supraterrestre, déconcertant. Certes, son personnage est ressemblant, est réel, cela est sûr ; certes, il y a, en sus de sa chair, un peu de son caractère dans cette peinture, mais il y a aussi un côté surnaturel émané de ce peintre mystérieux, un peu spectral, qui justifie, dans une certaine mesure, ce mot de spirite écrit par Desnoyers. L’on ne peut, en effet, lire les révélations plus ou moins véridiques du docteur Crookes sur cette Katie, sur cette ombre incarnée en une forme dédoublée de femme tangible et pourtant fluide, sans songer à ces portraits de femmes de Wisthler, ces portraits-fantômes qui semblent reculer, vouloir s’enfoncer dans le mur, avec leurs yeux énigmatiques et leur bouche d’un rouge glacé, de goule.
Ces réflexions ne sont-elles pas applicables surtout à ce portrait de Sarrasate qu’il prêta en 1886, un portrait de médium, fuyant et nerveux et même à cette splendide lady Archibald Campbell qui glorifia le salon officiel de 1885.
Campée de côté, presque de dos, montrant la figure qui se retourne, elle se retire dans une ombre noire, tout à la fois profonde et chaude, et deux coups partent, deux coups de brun amadou, le coup des petits souliers et celui des longs gants qu’elle boutonne, deux coups qui réveillent la nuit dont les ténèbres s’éclaircissent, dans le bas de la toile ; mais ce n’est là que l’accessoire, le détail prenant place dans l’ensemble voulu du peintre. Du la pélerine de loutre, de la robe sombre, jaillit avec une suprême élégance Lady Campbell, dont le corps étroitement lacé palpite, dont le mystérieux visage se penche, avec son oeil incitant et hautain qui convie et sa bouche d’un rouge mat qui repousse. Cette fois encore, l’artiste a sorti de la chair une expression indéfinie d’âme et il a mué aussi son modèle en une inquiétante sphynge.
Je laisse de côté maintenant le portrait de M. Duret qui est représenté en habit noir, tenant sur le bras un domino rose et un éventail à lames rouges. L’oeuvre est curieuse, ferme mais moins jaillie dans les au-delà et les couleurs sont tristes ; — l’on dirait presque d’un Manet lisse et atone — et j’arrive à cette série de tableaux, de paysages, pour la plupart, qu’il exposa, au mois de mai 1887, dans la galerie de M. Georges Petit, et an mois de mai 1888, dans les salles de M. Durand-Ruel ; toute une série d’harmonies, d’arrangements ; un village intitulé : vert et opale ; une vue de Dieppe : argent et violet ; un site de Hollande : gris et jaune ; un pastel : bleu et nacre ; puis des duos de capucine et de rose, d’argent et de mauve, de lilas et d’or ; un solo enfin, chanté par une boutique de bonbons sous ce titre ; note en orange.
D’inégale valeur, ces tableaux dont quelques-uns semblaient n’être que des bouts d’esquisses, confirmaient l’aveu de ces paysages exhibés, en 1883, dans la rue de Sèze. C’étaient des horizons voilés, entrevus dans un autre monde, des crépuscules noyés de pluies tièdes, des brouillards de rivière, des envolées de brume bleue, tout un spectacle de nature indécise, de villes flottantes, de languissants estuaires, brouillés dans un jour confus de songe ; c’était, en dehors de l’art contemporain, une peinture convalescente, exquise, toute personnelle, toute neuve, « la peinture des fluides », que ce visionnaire s’est essayé à rendre, même dans ses précieuses eaux-fortes, où, en quelques traits, il éparpille des monuments, des cités, illimite l’espace, projette des sensations de lointains, uniques.
Artiste extralucide, dégageant du réel le suprasensible, M. Wisthler me fait songer avec ses paysages à plusieurs poésies d’une douceur murmurante et caline, comme confessée, comme frôlée, de M. Verlaine. Il évoque, ainsi que lui, à certains instants, de subtiles suggestions et berce, à d’autres, de même qu’une incantation dont l’occulte sortilège échappe. M. Verlaine est évidemment allé aux confins de la poésie, là où elle s’évapore complètement et où l’art du musicien commence. M. Wisthler, dans ses harmonies de nuances, passe presque la frontière de la peinture ; il entre dans le pays des lettres, et s’avance sur les mélancoliques rives où les pàles fleurs de M. Verlaine poussent.
M. Wisthler définit ainsi, dans son « Ten o’clock » traduit par M. Stéphane Mallarmé, l’art tel qu’il le conçoit : « C’est, dit-il, une divinité d’essence délicate, tout en retrait. » — Et ce sera sa gloire, comme ce sera celle des quelques-uns qui auront méprisé le goût du public, que d’avoir aristocratiquement pratiqué cet art réfractaire aux idées communes, cet art s’effaçant des cohues, cet art résolument solitaire, hautainement secret.