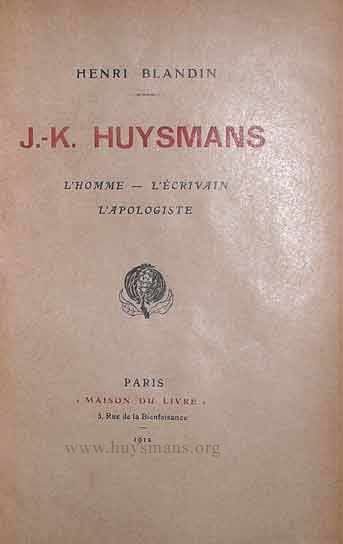Préface
Avec des traits empruntés à lui-même et aux écrivains qui l’ont le mieux connu, j’essaie de rendre la figure de Huysmans.
Peu d’années suffisent à mettre au point un homme de lettres dont les œuvres n’ont soulevé ni la curiosité ni la discussion. Il en faudra davantage pour fixer dans sa vérité complète l’originale et attachante physionomie de l’auteur d’En Route. Tentons seulement de la faire aussi ressemblante qu’elle peut l’être aujourd’hui.
Des nombreuses études publiées sur Huysmans depuis 1907, année de sa mort, l’une des dernières (1), celle de M. Coquiot, a l’attrait du réel et du vécu. Les friands d’indiscrétions et d’anecdotes ont dû la goûter. L’homme est pris sur le vif, avec son caractère, ses propos, ses gestes. Un crayon du maître par Raffaelli, un fac-simile de sa fine écriture ajoutent à l’intérêt du livre.
D’où vient toutefois que l’impression finale reste flottante ? Serait-ce que tous ces détails, si caractéristiques soient-ils, ne mettent point dans la lumière qui convient la puissante et complexe personnalité de l’écrivain ?
Le jour même où je parcourais cette biographie, un ouvrage de Charles Blanc (2) m’étant tombé sous la main, j’y notai la réflexion qu’on va lire. Bien qu’inadéquate à mon sujet, puisqu’elle a trait à la statuaire, elle répond à un sentiment que plus d’un lecteur partagera.
D’après Charles Blanc, les premiers artistes du XIIVe siècle, peintres ou sculpteurs, mettaient le plus de vérité qu’ils pouvaient dans la représentation des figures empruntées au règne animal, ne conservant de convention que dans les figures humaines, dans celles surtout des principaux personnages. Ce qu’ils avaient de réalisme était réservé pour la nature inférieure, « enseignement dont nous n’avons guère profité, ajoutait le critique, nous qui voulons partout le naturalisme, même quand il s’agit d’exprimer dans des figures qui pensent et qui sentent une beauté qui est au-dessus de la vraie, — pulchritudinem quas est supra veram, dit un latin, — c’est-à-dire une vérité supérieure à cette vérité commune qui est la vraie ».
Si appréciable que soit le « document » et si révélateur d’un homme que soit son habitus corporis, l’homme ne sera et ne paraîtra ressemblant que si sa figure s’éclaire du reflet de son âme et que si le peintre fait rayonner son modèle des plus hautes qualités qu’il posséda.
Huysmans, qui a passé déjà sous tant d’objectifs, qu’on a présenté sous des aspects si divers et même contradictoires, sera-t-il mieux jugé quand on aura vu dans ce livre, l’homme, l’écrivain et l’apologiste qu’il me paraît avoir été ?
Je me plais à l’espérer.
Notes
(1) Le vrai J.-K. Huysmans. Paris, Bosse, 1912.
(2) Histoire de la Renaissance artistique en Italie.
L’HOMME
A famille paternelle de Joris-Karl (Georges-Charles) Huysmans était originaire de Hollande. Son père, marié à Paris, où il exerçait la profession de dessinateur et de peintre, habitait rue Suger. C’est là que naquit en 1848 le romancier qui devait conquérir une renommée singulière.
Il fit ses humanités au Lycée Saint-Louis, prit quelques inscriptions à l’École de Droit et entra aux bureaux du Ministère de l’intérieur où il devait rester pendant trente-deux années consécutives, sauf le temps passé, avant et pendant la guerre, dans la garde nationale mobile.
Sa vocation d’écrivain date de cette période. Elle ne fut contrariée ni par sa famille ni par ses chefs. Ceux-ci lui laissaient faire une autre copie que la copie administrative. On devine celle des deux qui lui V3alut la croix et la rosette.
Avant d’en venir à sa carrière littéraire, parlons d’abord de sa personne, de son caractère, de ses habitudes, de la retentissante conversion qui retourna sa vie, de ses relations avec le monde religieux et de sa fin si douloureuse et si résignée.
En tête des Croquis Parisiens, parus en 1880 dans la forme d’un eucologe, se trouve une effigie de Huysmans, que M. Marcel Fouquier (Profils et Portraits) décrit ainsi : « Figure souffrante où transparaît dans le regard, avec l’acuité de la vision, une lassitude. La bouche mince naturellement semble se plisser en une expression de moquerie ou de dédain. Les cheveux courts en brosse achèvent de donner à ce portrait un air de lieutenant pessimiste. Attirante physionomie d’artiste qui intrigue la sympathie ».
J’ai sous les yeux le mémento mortuaire avec la photographie, la dernière et la meilleure de l’écrioain. Contre un fond de boiserie sculptée, il est assis, jambes croisées, tenant sur le genou droit un vieux livre grand ouvert. Les yeux regardent de face. Le « lieutenant pessimiste » vieilli conserve sous les rides l’air triste et pensif qu’il avait au repos. Dans ce visage, ceux qui l’ont connu retrouvent le malicieux sourire pétillant dans ses yeux bleus, quand se dissipait pour un instant sa mélancolie : « Maigre visage au ne5 finement busqué, à la courte barbiche grise, et que surmontait un front en coupole, planté de cheveux raides et drus » (1).
Dans la Revue Universelle du 1er mars 1903, au milieu d’un article sur l’Académie des Goncourt (2) se voit une reproduction des dix membres d’alors. Huysmans est au centre, assis dans un fauteuil. C’est toujours la même tête militaire, la même figure grave, songeuse et triste. Les portraits n’ont point manqué au sculpteur pour le médaillon dont v>a s’orner la tombe du vigoureux styliste.
Arrivons à son caractère et parlons-en avec sincérité, non sans dire un mot de son intérieur de célibataire dont la bibliothèque était la pièce favorite.
Les visiteurs de Huysmans et les journalistes, avant et après sa mort, ont souvent entretenu leurs amis et le public de cette bibliothèque. Elle était fort soigneusement tenue et offrait des trésors de littérature, d’érudition historique, d’archéologie et d’hagiographie. On sait que la partie littéraire a été léguée à M. Lucien Descaves, et la partie religieuse, y compris une uierge ancienne et une gravure originale de Durer, à l’abbé Fontaine, le dernier directeur spirituel du pénitent.
L’admirable uierge du XIVe siècle trônait rue Saint-Placide au-dessus des « idoles et des bibelots de jeunesse » parmi des statuettes de pierre ou de bois aux poses hiératiques et aux figures naïoes respirant la foi.
C’est surtout la conversation, révélatrice du caractère, qu’ont notée les publicistes. Sa manière de vivre, sa cordiale accueillance, ses déjeuners ou dîners intimes, tout fut révélé, et chacun de souligner la forme plaisante, facétieuse et paradoxale dont il revêtait sa pensée. Aucun d’eux qui n’ait rappelé aussi ses propos et ses gestes de bibliophile.
Que de fois, me servant du simple couteau de buis qui fut le coupe-papier de Huysmans — et qui m’a été si aimablement offert, — je crois voir le fin « bouquineur » coupant con amore les livres brochés et caressant les vieux vélins ou les maroquins de prix ! Et quand je pense qu’il fut un temps où il perdit l’usage de ses yeux, je me rappelle ce bibliophile aveugle dont parle une chronique de Mantenay. « Écrivain de haut talent, dit-il, et souffrant cruellement de sa terrible infirmité, il ne voulait pas toutefois qu’on lui fît la lecture. Il aimait à couper lui-même avec lenteur les pages des libres neufs, à respirer le parfum de l’encre fraîche, à promener sa main experte sur les précieux japons, sur les chines soyeux ou les nobles vélins, et il écoutait en silence le léger bruissement des feuilles tournées. »
Huysmans fut un ferment du livre ; c’est dire un familier des quais, un fureteur cherchant l’édition rare. N’a-t-il pas raconté comment il mit la main sur certain petit volume qui, par lui préfacé, déviait connaître la gloire de nombreux tirages ! « Je le découvris, un jour de flâne, sur les quais. J’étais las de pêcher avec mes doigts des épaoes de papier dans la poussière des boîtes ; tout ce que je rapportais n’était qu’un affligeant fretin ; j’allais partir, quand une plaquette enfouie sous un tas de tomes dépareillés m’attira. Elle était imprimée avec des caractères sans gloire sur un papier sans faste... Je l’achetai, ne comptant guère avoir profité d’une aubaine, mais réjoui par cette satisfaction que tout bouquineur éprouve lorsqu’il ne rentre pas au logis les mains vides. »
Mais laissons le bibliophile pour dire toute la vérité, mais rien que la vérité sur le mordant critique.
Huysmans eut la dent dure pour tout le monde, et quelqu’un qui l’a bien connu (3) parle, non sans circonstances atténuantes, de ce qu’il nomme sa duplicité. « Elle fut, dit-il, inconsciente chez ce raffiné qui, sans méchanceté foncière, et par jeu, aiguisait ses griffes sur les réputations comme son chat les exerçait sur ses fauteuils et sur ses rideaux. Il donnait l’exemple d’un « contraste que l’on trouve chez les gens qui ont trop d’esprit et surtout trop d’esprit critique... Sa parole d’une verdeur incroyable mais jamais exaltée, jamais violente, sedévidait avec confiance... Un recueil de ses conversations serait le plus curieux tableau satirique du Paris de vers 1890... Ses critiques étaient sans amertume. »
Ce croquis que l’on sent fidèle peut se réduire à deux traits : mauvaise langue et bon cœur. Oui, Huysmans fut médisant et satirique, n’épargnant ni ennemis ni amis. Il disait avant sa conversion beaucoup de mal de ses contemporains, il continua d’en dire après, moins peut-être, mais encore trop. Il resta jusqu’au bout méchant en paroles, licenzioso della lingua, mais bon en action.
Faites-lui grief de cet esprit caustique et mordant qui dépassait les bornes, je joins mon blâme au vôtre, mais vous me laisserez bien remarquer qu’il ne fut peut-être pas le premier homme de lettres critiquant ses confrères. Où ai-je lu que Callimaque, siîr de ses forces, et dédaignant une fausse modestie, lorsqu’il parlait de lui-même, ne ménageait point assez l’amour-propre de ses rivaux, dans une carrière où l’émulation dégénère quelquefois en haine implacable ?
Sans remonter aux Grecs, nous eussions rencontré chez les Romains l’invidia mordax et le genus irriiabile vatum ; sans même sortir de France — je prends des noms au hasard des réminiscences — ne vit-on pas Voiture rompre définitivement avec Balzac qui, dans l’ombre, l’accablait d’injures, et avec Chapelain dont il avait découvert la duplicité à son endroit ? La duplicité! mais celle de Voltaire fut inouïe ! Nous savons aussi que Victor Hugo et Chateaubriand ne se ménagaient guère. Quant à Sainte-Beuve, il ne se contenta point de « parler » ses antipathies. Les Goncourt nous le montrent patelin, goguenard, hargneux, rancunier et poltron, et l’on n’a point oublié, dit M. de Régnier, « comme petitement il décria les grands hommes ».
Pessimiste de caractère, conscient de sa valeur, sincère jusqu’à l’excès, et ne s’épargnant pas lui-même, Huysmans avait des mots cinglants et tranchants. Il pécha, en paroles, parce qu’il eut trop de finesse et de franchise. Que les irréprochables lui jettent la pierre, mais qu’au moins ils imitent la bonté d’âme dont il a donné tant de preuves.
Irréprochables, le sont-ils donc les écrivains en vue, arrivés ou en passe d’arriver à la grande notoriété ? Sont-ils équitables pour les confrères et les amis ? Entendez-les dans une réunion intime, dans un pique-nique, en voyage : ils ne peuvent s’expliquer les succès de librairie de celui-ci et de celui-là. Termes d’argot, de langue verte, mots à l’emporte-pièce pleuvent dru comme grêle sur les absents, mais, au fond, dans ce piment et ces épices, il y a plus de bavardage, plus de fantaisie et de pose que de haine et de méchanceté (4).
Les témoignages non douteux des familiers de Huysmans l’ont défendu des insinuations malveillantes et des « grognements de pharisien », comme dit Dom Besse. La chose a été faite et bien faite par Dom Du Bourg, un des Bénédictins qui l’eurent en haute estime, et aussi par le chevaleresque Vroncourt.
Il a été non moins nettement répondu à un autre reproche qui pèsera, je le crains, plus longtemps sur sa mémoire. On ne s’explique point aisément la liberté, j’allais dire la licence et l’irrespect qu’il met dans ses jugements sur les hommes et les choses d’église.
— D’où uient, a écrit Dom Du Bourg, posant carrément l’objection, ce contraste qui existe et persévère, déroutant et choquant, entre les sentiments de foi vive, d’ardente charité, de mysticisme profond du converti et toutes ces pages virulentes, satiriques et caricaturales qui surgissent si nombreuses dans ses œuvres ? Toutes les fois qu’il rencontre, même dans la religion, un objet ou un personnage qui choque son goût artistique, son purisme esthétique et liturgique, il les met en saillie et les flagelle avec un brio endiablé et souvent sans le respect dû, étonnant et scandalisant même certains.
J’attire ici toute l’attention du lecteur, le priant de la fixer sur la réponse topique du Bénédictin :
— La grâce de Dieu, en conquérant une âme, la surnaturalise dans sa vie, dans ses actes, dans le but qu’elle poursuit, dans l’idéal qu’elle se propose ; mais elle n’altère pas ses caractères personnels. Converti, Huysmans reste Huysmans, et c’est dans cette persistance même qu’il puisera sa puissance pour le bien. Si, à la place du Huysmans des anciens jours avec sa forme originale, avec ses qualités et aussi ses défauts, eût surgi un écrivain s’exprimant avec une irréprochable correction et comme tout le monde, aurait-il été un des grands remueurs d’âmes de son époque ! Comme le disait avec infiniment d’esprit et de vérité un de ceux qui l’ont le mieux compris et analysé, (4) Huysmans était un de ces primitifs flamands dont les peintures, d’un surnaturalisme idéal, illuminées de reflets célestes, émergent, lumineuses, du milieu de leurs ribauderies,de leurs caricatures, de leurs débauches grimaçantes. Primitif flamand, il l’était par origine, par instinct, par la manière littéraire qu’il s’était donnée et qui n’appartient qu’à lui. Il ne pouvait pas être autre chose et, qui plus est, il ne le voulut pas.
Huysmans a été Huysmans : prenons-le tel qu’il est et laissons les récriminations aux « chrétiens mieux intentionnés qu’éclairés, dont le zèle rude et simpliste comprend difficilement les cœurs revêches à entrer dans des cadres tout faits et dans des moules étroits, » (5)
« Je n’écris pas pour des catholiques, mais surtout pour le monde intellectuel de Paris, répétait-il... J’ai dià faire sou\?ent la part du feu et jeter à l’eau tout le côté déootionnette... Que les catholiques malades qui me lisent me prennent comme on prend un vomitif. En Route n’a pas été écrit pour eux, mais pour des gens qui étaient sur la lisière comme je le fus. »
Une lettre inédite datée de Ligugé, maison Notre-Dame, 2 juin 1900, a ici sa place. On y retrouve, aoec le ton habituel de ses livres, ces jugements arrêtés qui peuvent déplaire, mais dont la sincérité fait excuser la hardiesse :
Je vous remercie de l’aimable réconfort que m’apporte votre lettre, et je ris un peu en lisant les reproches du brave religieux sur mes livres. Je les ai tant entendus ! — et combien qui m’exprimèrent leurs regrets de ne me pas voir employer la langue Sulpicienne ! et sans doute l’épithète « édifiante ! »
Tout cela me semble dériver d’un insens absolu d’art : tout ce monde-là en est encore au XVIIe siècle — et remarquez bien que si l’on vous vante Bossuet, c’est justement dans ses livres emphatiques et ternes et pas du tout dans ce qu’il écrivit de vraiment bien comme les Élévations sur les Mystères ou certains sermons. Au fond, le monde catholique vit sur des idées acquises ; il n’est au courant de rien et puis, comme je l’ai dit dans la Cathédrale, et Dieu sait ce que cette page m’a valu, injures, dénonciations à l’index, brochures entières contre moi, tout ce monde-là a peur des mots, est ahuri par un insupportable bégueulisme, ne comprend, en un mot, qu’une religionnette de bougies et de chromos.
Jamais je n’ai pu me figurer le catholicisme ainsi ; et, de fait, dans les siècles de vraie foi, il ne fut pas ainsi ; c’est pour cela que j’aime tant les Trappes et l’ordre bénédictin oii l’on vit de la moelle de l’Église, de la liturgie, où l’on enseigne la théologie mystique, la seule que les séminaires n’enseignent pas, où l’on aime les vieux sanctuaires de la Vierge, sans se préoccuper de dévotionnettes qui changent comme des habits, selon la mode...
Pour ceux qui connaissent déjà Huysmans, ils retrouvjent dans cette lettre sa tournure d’esprit et de langage. On peut le taxer d’exagération ou d’erreur, mais non de mensonge, puisqu’il ne disait que ce qu’il croyait être la vérité.
Avant d’en arriver à cette conversion qui fut un événement dans le monde des lettres, je veux rappeler ne fût-ce que quelques traits de son humanité et de sa bienfaisance. Ils révèlent la réelle bonté d’âme qui se cachait sous son aspect sévère et sous l’âcreté de sa plume, et qui lui faisait accueillir si obligeamment les débutants.
Nous savons, par ses familiers et ses amis, combien sa table leur fut hospitalire et combien il était secourable à leurs détresses morales ou matérielles.
J’ai lu ses lettres si touchantes relatives à la madadie d’un de ses directeurs spirituels, M. Ferret, prêtre de Saint-Sulpice. Le mal s’étant aggravé, Huysmans de courir à un chevet lointain, et de remuer ciel et terre, c’est le cas de le dire, en recommandant son ami aux Bénédictins et aux Trappistes, et en redoublant ses demandes de prières à tous les cloîtres.
Il intéressait les écrivains riches au sort des confrères sans ressources. Lui et Coppée adoucirent ainsi les derniers jours de Villiers de l’Isle-Adam, l’un lui ouvrant la maison des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, l’autre sollicitant avec Gustave Guiches l’argent nécessaire de Francis Poictevin et de Francis Magnard. Il eut longtemps, le dimanche, à dîner, Villiers et son fils, et c’est lui qui fit d’activés démarches pour mener à bien le mariage in extremis de l’auteur d’Axel. Huysmans fut « le témoin profondement ému, le soutien des suprêmes défaillances de Villiers, le dernier vivant qui l’ait salué sur les bords de l’éternité, (6) »
Innombrables sont les services qu’il rendit aux hommes de lettres, et, pour m’en tenir à Villiers, j’aime à noter cette réflexion de son biographe : « que l’affection de Huysmans, à la fois tendre, prévoyante et virile, lui fut très salutaire, et qu’elle lui aurait donné, s’il eût vécu, le goût de la vie régulière, sobre, enfermée et travailleuse. »
Ce ne sont là que les charités connues. Il est telles autres largesses ignorées, qu’il me plaît de garder secrètes, comme il fit lui-même, suivant le conseil évangélique.
Abordons la fameuse conversion, dont il y a longtemps que la sincérité ne fait plus doute, et parlons-en non sans corriger sur ce point la légèreté et l’imprécision de certains publicistes.
L’un (7) étudie ce qu’il appelle l’évolution d’un type d’homme vers le catholicisme. Ce type, le même sous les divers personnages de ses romans, a gardé de son enfance et de sa jeunesse la vision de tantes religieuses, mais aussi d’amers souvenirs du collège et du régiment, où la mauvaise nourriture l’a rendu malade, ce qui lui fait rechercher maintenant la bonne cuisine et l’indigne fort contre la falsification des denrées alimentaires.
Ce type dyspeptique et névropathe devient artiste et jouisseur effréné, puis tombe dans la profanation et le sacrilège. Littérateur, il se fait anatomiste de la société, mais en montre surtout les tares. Il lui suroient une passion de l’artificiel, du faisandé, de la perversité en toutes choses ; mais de sadique et satanique, voilà qu’il se fait mystique, non sans rester pessimiste, misogyne et misanthrope. Il tombe dans une épouvantable détresse d’âme, d’autant qu’il voit le diable, et dans les tables tournantes, et un peu partout... Mais il se met tout à coup à répudier le surnaturel diabolique pour ne plus croire qu’au divin. Il est devenu catholique, presque moine, ne renonçant toutefois ni à son caractère bizarre ni à son amour de la cuisine, et se mettant à malmener l’église « bourgeoise », ennemie de l’art, n’ayant plus d’éloges que pour l’église « mystique » du moyen-âge et des cloîtres.
Il est à craindre, dit le biographe en terminant, que par cette conversion, Durtal-Huysmans, entré dans un monde mort, soit perdu pour la littérature.
Si les quarante pages que je viens de résumer sont un piquant raccourci de l’œuvre de Huysmans, leur psychologie estvraiment courte et par trop fantaisiste. Est-ce entendre quelque chose à une conversion que d’en parler de la sorte, et en diminuant le converti ?
M. Coquiot a consacré au même propos le même nombre de pages. Il leur donne pour titre : Les bienfaits d’une conversion, et en emprunte le récit à la meilleure source, à la préface d’A Rebours, rappelle les circonstances qui ont préparé l’évolution ; après quoi, il parle d’autre chose. Son livre a donné une nouvelle occasion à M. Jean de Gourmont d’écrire, d’un ton assuré, que la conversion de Huysmans est « pathologique ».
Avec M. Remy de Gourmont (8) nous entendons au moins parler de ce qu’il y a dans une conversion : « Je dois l’avouer, dit-il, dût ma perspicacité en paraître bien diminuée, je n’eus, jusqu’au dernier moment, aucune idée de la conversion possible de Huysmans. Je croyais que, pour lui comme pour moi, le décor catholique n’était qu’un décor. N’y voyant qu’une méthode d’art, qu’un moyen romantique, qu’une arme de guerre contre la laideur naturaliste, j’étais très loin de supposer que, sous le rideau de pourpre et d’or, Huysmans cherchât des réalités dogmatiques.... »
Réalités dogmatiques : voilà, en effet, le substratum de toute conversion. Poursuivons l’étude avec M. F. Strowski. « La vraie conversion, dit-il, (9) n’est pas l’acquisition d’une science ou d’une idée nouvelle. La première conversion de Pascal s’était réduite à cela et n’avait pas eu d’action durable et profonde. Certes, avant de se convertir, et pour s’y préparer, il faut écarter tous les obstacles d’ordre intellectuel, soit en les détruisant un à un, soit en les tournant par une distinction entre les différents ordres de vérités et les diverses sortes de méthode, soit en les oubliant. Mais la conversion ne commence qu’après. C’est un phénomène sui generis, irréductible à tous les autres, long, douloureux, mystérieux, caché dans le plus intime de la personnalité.
Les gens du XVIIe siècle sont peu prompts aux confidences ; et d’ailleurs peu de convertis ont eu l’œil assez attentif ou assez pénétrant, et la plume asses; exacte pour suivre cette élaboration, cette gestation de la foi. Remercions un grand romancier réaliste, M. Huysmans, d’aooir raconté dans le détail un de ces cas singuliers, et d’avoir éclairé ainsi pour nous l’histoire intérieure des grands convertis. »
Il m’a paru intéressant de reproduire le sentiment des hommes de lettres sur la conversion. La plupart pensent, comme les croyants, qu’elle est un mouvement tournant de l’âme, qui la fait passer de l’incrédulité à la foi ou d’une vie peu chrétienne à la pratique des devoirs religieux ; que ce mouvement s’opère à la suite d’une illumination ou d’une impulsion divine et gratuite, qui n’est autre que la Grâce. C’est une transformation de la vie intérieure, une renaissance de la vie surnaturelle perdue par le péché.
L’écrivain déjà cité, (10) qui aime à promener de libres jugements et une pensée vagabonde sur les hommes et les choses, les livres et les idées, dit qu’on se convertit à tout âge, généralement par un de ces coups qui ne laissent place à aucune délibération, ou seulement qu’on redevient ce que l’on était au début de la vie et ce que l’on est resté secrètement malgré les apparences. A l’en croire, une séance de tables tournantes aurait joué un rôle important dans le retour à Dieu de Huysmans, comme aussi telle influence féminine. Et quand cela serait ? Dieu se sert des gens et des évènements qu’il lui plaît. Tant de « filles d’Eve » pervertissent les hommes qu’on doit bénir les « enfants de Marie », qui assument le rôle contraire. Les deux prétendues influences me remettent en mémoire le nom de Mme Yéméniz, chez laquelle on vit à Lyon, vers 1845, les premières tables tournantes, et qui ramena l’un des habitués de son salon, Victor de Laprade, « du cap Sunium au Calvaire. »
Vers la même époque, n’est-ce pas l’influence d’Eugénie de Guérin et le deuil de sa mort qui firent répudier à Barbey d’Aurevilly les erreurs de sa jeunesse et l’amenèrent à confesser la foi chrétienne ? Touché d’une grâce soudaine, il devint, dit René Richard, le grand polémiste catholique qu’il resta jusqu’à sa mort, le « mousquetaire des Lettres » qui défendit, à travers tant de brillantes polémiques, l’orthodoxie romaine.
La grâce divine est multiforme : toutes les conversions ne s’opèrent point par coup de foudre, comme celle de saint Paul, et la plupart ne sont que la réponse, immédiate ou différée, aux coups discrets frappés à la porte des cœurs.
« Mlle Favre, fille du président Favre, était une pieuse jeune fille, qui aimait la danse. C’est dans un bal qu’elle fut cueillie par Dieu, et sentit brusquement l’invincible désir des solitudes du cloître.
« Mme de Charmoisy était une jeune femme sage et modeste assez ordinaire. Elle entendit un jour un sermon de saint François de Sales et en sortit bouleversée. Elle rejeta sa tiédeur, et accepta de chercher Dieu dans les plus modestes tâches de sa uie. Ainsi fut-elle l’héroïne de l’lntroduction à la vie dévote. »{11)
C’est à propos d’un écrivain, converti lui aussi, et dont on vient de publier deux volumes de Reliquiae, que M. Henry Bordeaux évoque ces deux exemples. L’auteur, des Reliquiae, M. Maurice Faucon, raconte, en deux lettres mémorables, la lointaine mais impérieuse attirance dont il fut l’objet. La première est adressée à M. Jean Aicard, le ii juillet 1892 :
« J’ai été soulevé par un attrait tellement irrésistible que toute velléité de lutte était abolie, et tellement contraire à ma nature raisonneuse, coutumière de réticences et d’arrière-pensées, tellement différent aussi de tout ce que j’avais senti jusqu’alors, que je suis forcé d’y voir cette mystérieuse action divine que l’Église appelle la grâce. Après deux ans écoulés, j’ai beau analyser, avec un esprit resté critique dans sa libre mais entière acceptation du dogme, les circonstances de ce changement, il me paraît, comme au premier jour, irréductible aux explications naturelles... C’était l’heure, prévue de toute éternité, où l’imploration irrésistible et la grâce préparée devaient se rencontrer. »
Voici l’autre lettre, qui fut adressée à M. Raymond Saleilles : « En vérité, ce n’est pas le génie ni le talent, ni l’éloquence, ni la conviction, ni le raisonnement, ce n’est pas l’homme, en un mot, qui produit dans une âme cette révolution mystérieuse qui s’appelle la conversion, et qui la conduit, ou de la négation, ou du doute, ou d’une croyance confuse, ou d’une adhésion sans actes, à la foi pratique, intégrale et sentie. C’est Dieu, dont la grâce, sollicitée par quelque prière irrésistible, par quelque immolation victorieuse, a choisi cette heure, et conduit l’âme à une lecture, à une parole entendue, à un accident, à un je ne sais quoi qui n’est rien et qui, cependant, est décisif, puisque Dieu l’a voulu. »
Huysmans ayant écrit tout un livre. En Route, où il raconte par le menu sa conversion, qu’il me suffise d’y renvoyer. L’on y verra comment il discerna l’appel divin dans le plain-chant des cathédrales et des chapelles, et comment il sut vaincre tous les obstacles et terrasser le vieil homme.
Les récentes conférences « amoureuses et cruelles » de Jules Lemaître sur Chateaubriand ont traité de la conversion de René. La part y fut mesurée à Dieu : « Je n’ai pas cédé, j’en conviens, à de grandes lumières surnaturelles, dit-il, ma conviction est sortie du cœur : j’ai pleuré et j’ai cru. » Nous n’en devons pas moins à cette conversion le Génie de Christianisme et les Martyrs et l’Itinéraire, mais sa croyance, remarque avec raison Jules Lemaître, fut « somptueuse et faible. » Louis Veuillot appelait avec autant de raison Chateaubriand un « chrétien honoraire. » Nous retrouverons dans une autre partie de ce livre le glorieux écrivain, avec sa piété poétique, mais non « avec la foi qui tient tout l’homme, même quand il pèche, qui est toujours présente à son esprit, qui est l’essentiel de sa vie, qui façonne à chaque instant ses sentiments et sa conduite. »
Telle fut la foi de notre Huysmans et telle, j’aime à penser, eût été celle de Brunetière, dont nous savons que l’ébranlement décisif, préparé par mille menus faits de la v»ie intérieure, (12) fut déterminé par la visite qu’il fit au grand vieillard du Vatican.
Résumons-nous. Dans toute conversion, il y a l’action et le don divins et la contribution humaine, la grâce et la correspondance à la grâce.
Dieu parle : il faut qu’on lui réponde,
a dit Musset. Aussi longtemps qu’il n’y a point réponse et acceptation, qu’indifférent ou rebelle, le pécheur ne se rend point à l’appel de Dieu, il n’y a pas de conversion : Dieu a parlé en vain. Certes, Musset ne porte guère ses lecteurs à se convertir, et bien peu remarquent l’il faut du célèbre sonnet : le poète lui-même ne s’y est sans doute point arrêté. Il n’en a pas moins traduit l’unum necessarium de l’Évangile, cet oportet, mot qui contient l’idée de besoin, de travail, opus, et de devoir.
Brunetière entendait ce mot dans sa plénitude, lorsque, parlant du problème qui s’agite dans les Pensées de Pascal, il disait : « Ce problème n’a pas cessé d’être celui qu’il faut que tout être qui pense aborde, discute et résolve, au moins une fois dans sa vie. »
S’exprimer ainsi, c’est être déjà sous l’action de la grâce, comme l’était Pascal, quand il fit honte aux libertins de leur illogisme, dans cette pensée vigoureuse, vengeresse de la droite raison : « Celui qui doute et qui ne cherche pas est tout ensemble bien injuste et bien malheureux. Que s’il est avec cela tranquille et satisfait, qu’il en fasse profession, et enfin qu’il en fasse vanité, et que ce soit de cet état même qu’il fasse le sujet de sa joie et de sa vanité, je n’ai point de termes pour qualifier une si extravagante créature. »
Quand je pense que c’est Huysmans qui, aux yeux du grand nombre, a paru être l’extravagante créature !
Tous ceux qui ont approché le maître, qui l’ont fréquenté ou ont correspondu avec lui — depuis les séjours qu’il fit à Igny, à Saint-Wandrille, à Solesmes et, en qualité d’oblat, à Ligugé, en sa maison Notre-Dame, puis à Paris, chez les Bénédictines d’abord, ensuite rue Monsieur, et enfin rue Saint-Placide, — furent édifiés de sa foi et de sa religion, que n’altéraient en rien ses conversations toujours spirituelles et piquantes. Ses commensaux et ses intimes, MM. Descavtes, Forain, Talmeyr, les abbés Mugnier et Fontaine, les Bénédictins, dans l’habit desquels on sait qu’il voulut être enseveli, rendent témoignage de la constance vraiment chrétienne avec laquelle il supporta le terrible mal qui lui rongeait le visage. On a vu le nerveux, le délicat, le décadent, le raffiné que tout exaspérait dans sa première vie profane, venir dans la souffrance à la douceur et à la résignation d’un martyr.
Sans m’étendre autant que sur la conversion, je raconterai, d’après le propre témoignage du patient, la dernière et si douloureuse période de sa vie.
Mme Myriam Harry a publié (13) des souvenirs on ne peut plus touchants sur l’écrivain déjà malade qui, dans une poignante visite, lui donna de si précieux conseils. Communication gracieuse m’ayant été faite d’une correspondance du maître, je suis heureux d’en offrir le bénéfice au lecteur.
Voici d’abord deux lettres écrites au retour de Ligugé :
Paris, 20, rue Monsieur, 14 9e 1901.
... Je suis à Paris, non installé encore, dans la tristesse d’un logis claustral qui me semble d’autant plus mélancolique qu’à Ligugé j’étais en plein soleil et en pleine verdure. Mais le sort en est jeté. Je ne pouvais pour de multiples raisons m’exiler en Espagne ou en Belgique avec les moines partis du cloître — et le séjour de Ligugé, franc-maçon triomphant, était odieux. D’ailleurs, la campagne sans liturgie, sans office, ne m’intéresse pas, La vérité est que j’étais à Ligugé ne sachant que faire, lorsque la prieure des Bénédictines du Saint-Sacrement de Paris m’a fait offrir par notre père prieur un logement dans son monastère même. J’y ai les offices, des moines, car il y en a toujours de passage, et je ne paie pas très cher. Voilà l’histoire. Dans la débâcle, ce fut un havre. — Je me trouve mal logé, parce que je l’étais trop bien, mais je me ferai bien vite, je l’espère, à ma coque et n’en verrai plus alors que les très sérieux avantages, au point de vue spirituel. — On ne sort pas d’ailleurs, le soir, ce qui dispense des diners en ville, c’est déjà quelque chose cela !! Ah ! la bonne règle monastique.
Lettre du 27 février 1902 :
... Vous me demandez ce que je ferai si mes Bénédictines disparaissent. Je resterai tranquille en le logis que j’occupe actuellement à leur porte, 60, rue de Babylone. Je suis si las de démenagements, que je n’ai plus le courage de bouger. J’en serai réduit à me contenter de l’église la plus proche.
Mais il y en a à Paris d’autres, charmantes, telles que Notre-Dame, Notre-Dame-des-Victoires, Saint-Séverin, j’irai y faire des escales.
Tout cela n’est pas gai, mais on a tout mérité. Il n’y a qu’à baisser le nez.
Merci des jolies photographies ; elles feront dans le missel de très parfaits signets à la place des images de piété, hideuses, que chacun, pour retrouver ses pages, y met.
Les lettres et billets suivants n’ont plus trait qu’à sa maladie :
26 janvier 1906 Vendredi.
Voilà près de quatre mois que je suis alité, dans l’impossibilité de lire et d’écrire, obligé de recourir à une main amie pour vous répondre, et, il y en a pour des mois encore. C’est vous dire que mon volume de Lourdes est remis à je ne sais quand...
23 mars 1906.
Merci, je regrette que vous ne soyez pas morte, je vous aurais au moins serré la main dans l’ombre.
Après m’avoir opéré on m’a désopéré, c’est-à-dire que l’on m’a décousu l’œil.
On espère que la guérison va marcher plus vite. Je le souhaite et le demande à vos prières.
Paris. 8 juin 1906.
Je vous envoie un tout petit mot, car je suis obligé de garder ce qui reste de mes pauvres yeux pour corriger les épreuves de mon livre de Lourdes, arrêté depuis un an. Je souffre toujours de névralgies frontales et ne puis guère bouger de la maison. Tous les traitements électriques et autres ne font rien. J’espère être guéri liturgiquement, quand il plaira à Dieu, à l’une de ses fêtes. Il enlèvera le tout comme il a enlevé le plus gros, le jour de Pâques, en me rendant subitement la vue...
Paris, 26 juin 1906.
...Je vais très doucement. Cette affreuse maladie m’a ravagé la mâchoire et je me fais arracher les dents, et comme les anesthésiques ne prennent pas sur moi, c’est atroce !
Je n’ai pas fini. Il m’a rendu la vue pour travailler, mais un point, c’est tout. Névralgies du front et du cuir chevelu, rages de dents, ça n’arrête guère. Et il faut s’estimer content — car l’important, en effet, c’est de voir clair.
C’est égal, le cher Seigneur, il m’en a donné ! — Si, comme je l’espère, vous avez un peu d’influence sur Lui, demandez-lui un peu de répit pour son pauvre serviteur qui est tout de même, en dépit de toute sa résignation, un peu las ! Tout affectueusement à vous en Lui.
Paris, 9 janv. 1907.
Hélas ! oui, je suis toujours dans le même état, avec pansements, défense de sortir, et un ballon captif (hélas !) dans la joue qui fait que je ne puis ouvrir la bouche et ne puis m’alimenter que de liquides. Et les médecins et chirurgiens déclarent que ça peut durer longtemps !
C’est un genre de croix oîi j’ai des promotions rapides et terribles — aussi l’autre (14) ne me procure-t-elle que des joies modérées, comme vous pouvez croire...
Ce qui m’intéresserait autrement, ce serait d’être assez valide pour travailler — mais je ne suis bon à rien, en souffrant. Je me fais un peu l’effet d’être retranché du nombre des vivants. Priez toujours pour moi, et bien affectueusement à vous in Xte.
P.-S. — Reçu les macarons, soyez bénie, ils sont tendres et en les trempant un peu j’arrive avec ma bouche fermée à les déguster.
La dernière lettre de Huysmans, qui devait mourir le 12 mai, est datée du 28 janvier :
Je suis peu en état d’écrire, car je continue à souffrir terriblement. Cette semaine, jeudi. Je crois, on va se décider à m’arracher cinq ou six dents. Cela fera une fin de semaine horrible, mais j’espère, après, être peut-être soulagé.
Je suis toujours réduit à l’aliment mâché, viande râpée, œufs, purées et crème. J’en ai le cœur qui lève. Priez pour moi qui suis toujours fort mal en point et bien affectueusement in Xte.
A l’occasion de la messe du bout de l’an dite pour Huysmans, et à propos du poète et romancier Retté qui, engagé lui aussi sur des routes dangereuses, venait de bifurquer vers les chemins de la foi, M. Maurice Talmeyr écrivait : « Si cette messe a ressemblé à celle des obsèques, elle aura réuni une fois de plus des figures peu habituées à se trouver du même tableau. Car je ne sais pas si, comme violence de contraste entre les physionomies, il y eut jamais obsèques pareilles. Je vois encore, rue Saint-Placide, sous la porte cochère de la maison, puis dans le cortège jusqu’à l’église, d’anciens condamnés de la Commune, avec leur débraillement révolutionnaire toujours un peu spécial, et sur les tempes ou la crinière desquels il était seulement tombé une forte neige, à côté des soutanes et des douillettes de nombreux prêtres ou religieux, que coudoyaient également des peintres ou des poètes à vestons et à cravates d’ateliers où à redingotes de cabarets artistiques... Quelle extraordinaire eau- forte un véritable artiste eût faite avec toutes ces silhouettes et ces figures venues ou échappées de tous les mondes, et sorties à la fois des cloîtres et des tavernes, des lieux de piété et des endroits de blasphème, pour enterrer un grand écrivain chrétien arrivé lui-même à Dieu après être parti du Diable ! Autour de ce mort couché dans son habit d’oblat, il y avait positivement là, pour un instant, le chapeau à la main et se recueillant ensemble, les « otages » et leurs assassins. »
Croyant et philosophe, M. Talmeyr ajoutait : « Quel qu’il paraisse ou puisse se croire, chacun peut toujours porter en soi un personnage moral qui sommeille, prêt à répondre à l’appel qui pourra venir l’éveiller. Vous apercevez quelqu’un prosterné dans une église et vous êtes tout naturellement disposé à lui attribuer, pour toute la durée de sa vie, les pensées d’une âme religieuse. Vous pourrez fort bien vous tromper, et le retrouver à dix ans de là ou même moins, d’un tout autre côté que celui de Dieu.
« Vous voyez de même un athée rester, le chapeau sur la tête, à la porte d’une église où l’on dit un service funèbre, et vous en concluerez qu’il mourra dans l’impénitence 1 Vous êtes peut-être encore dans l’erreur la plus complète, et rien ne prouve que vous ne le retrouverez pas plus tard priant et prosterné lui-même. Personne de nous, au fond, ne sait jamais ni qui il est, ni quelle voix, dont il ne se doute pas, lui parlera peut-être un jour ! »
Beati qui audiuni verbum Dei et custodiunt illud... Beati mortui qui in Domino moriuntur !
Notes
(1) Henri d’Hennezel, dont l’Introduction aux Prières et Pensées Chrétiennes de J.-K. Huysmans est l’un des plus parfaits portraits du maître.
(2) Est-il besoin de rappeler la genèse de cette Société littéraire? Edmond et Jules de Goncourt, qui détestaient l’Académie Française, eurent un jour l’idée de fonder une académie nouvelle, composée de littérateurs ayant une originalité tranchée. Cette société devait fonctionner après leur mort, et chacun de ses membres, désigné d’abord par eux, recevrait une rente annuelle. Le projet parut quelque temps abandonné, mais il fut repris et finit par aboutir. En janvier 1903 se réunit pour la première fois la nouvelle Académie.
(3 )M. Remy de Gourmont.
(4) Le courriériste parisien, M. Léonce Beaujeu, écrivait spirituellement en mars dernier : « Je ne me rappelle plus le nom du débutant qui a raconté que deuant dîner auec des romanciers considérables et célèbres, il s’était réjoui d’avance du plaisir d’entendre une conversation étincelante, et qui fut tout surpris de se trouver mêlé à des propos de boutique et à des comptes de librairie, le tout dominé par une jalousie féroce. Hélas ! la concurrence vitale est un principe qui s’impose sur le Parnasse comme au fond des mers, et les poètes lyriques eux-mêmes n’en sont pas affranchis. Il en était ainsi déjà du temps d’Hésiode qui a dit que l’aède porte enuie à l’aède et le potier au potier ».
(4) M. Suau, Études, 20 décembre 1906.
(5) La Croix, 11 avril 1911.
(6) Villiers de l’Isle-Adam, par du Pontavice de Heussey.
(7) M. Sageret.
(8) Promenades littéraires.
(9) Pascal et son temps.
(10) Remy de Gourmont.
(11) M. Henry Bordeaux.
(12) V. Giraud.
(13) Revue de Paris, mai 1908.
(14) Il venait d’être nommé officier de la Légion d’honneur.
L’ÉCRIVAIN
Tout a été dit sur le réalisme littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. Brunetière a épuisé la question dans ses « Études sur le Naturalisme. » Ainsi se nomme l’école qui, vers 1875, s’érigea en réaction contre le romantisme idéaliste.
Il suffirait, pour marquer les étapes de cette réaction, de nommer Champfleury, Flaubert, les Goncourt, Alphonse Daudet, Zola, Maupassant, qui semblaient avoir pris au pied de la lettre ou le précepte de Boileau :
Que la nature donc soit votre étude unique,
ou celui de La Fontaine :
Et maintenant il ne faut pas
Quitter la nature d’un pas.
Maîtres et disciples pratiquèrent à l’envi cette leçon, copiant servilement hommes et choses, n’en relevant que l’aspect extérieur, la figure, la couleur, l’attitude, la voix et le geste, ne révélant, en un mot, l’état d’âme de leurs personnages que par les seuls dehors.
L’opinion dénia d’abord tout attrait, tout mérite et toute valeur morale aux romans de l’école naissante : on cria au scandale. Toutefois, plusieurs des productions nouvelles possédaient une telle puissance d’observation et un soin si scrupuleux de l’exactitude, qu’insensiblement le sentiment public se modifia. L’on en vint à compter avec des œuvres qui s’imposaient, tant les novateurs apportaient de conscience dans leur métier.
Ils paraissaient précisément à l’heure où s’opérait dans la philosophie, dans les mœurs et dans les arts, un mouvement parallèle et quelque peu similaire, celui du positivisme. D’autre part, les chefs de l’école n’avaient pas répudié tout l’héritage classique, ni dépouillé, autant que l’affirmaient les purs théoriciens, toute poésie et tout romantisme. Leurs maîtresses œuvres trahissaient la recherche des belles formes du style. C’est que les écoles se suivent, sans qu’aucune renonce complètement aux legs de ses devancières. Un historien autorisé des lettres françaises (1) vient de consacrer tout un volume à établir cette vérité. Il y fait voir que le romantisme s’en était moins pris aux vrais qu’aux pseudo-classiques, moins au vieux tronc qu’à ses ramifications et excroissances.
Dans la période classique, le roman, sous aucune de ses formes, n’avait reproduit la vie réelle. Le Sage et Marivaux les premiers en ont eu le souci. Il faut joindre à eux J.-J. Rousseau, bien que moins réaliste. Suivirent les romans personnels de Chateaubriand et de Mme de Staël, de Senancour et de Benjamin Constant, puis on vit paraître le roman historique dont Notre-Dame de Paris et Cinq-Mars furent les plus célèbres. Avec le roman de mœurs de G. Sand et de Balzac, la nature et la réalité se virent serrées de plus près. Si Stendhal et Mérimée sont restés romantiques, c’est par leur réalisme même, qui constitue la plus solide partie de leurs œuvres, en ce qu’il répudie les écarts du romantisme proprement dit.
Le naturalisme se fit donc agréer peu à peu des lettrés, puis de l’opinion. On sait quelle déplorable marchandise abrita trop souvent le pavillon : Documents humains, et quel retentissant désaveu de jeunes littérateurs, pourtant eux aussi naturalistes, crurent devoir infliger au chef de l’école. La protestation, (2) bonne à relire après 25 ans, fut publiée dans le Figaro, le 18 août 1887. Elle était signée de MM. Paul Bonnetain, J.-H.Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte et Gustave Guiches.
Huysmans devrait un peu plus tard imiter ces jeunes gens et sonner comme eux, mais avec une autre cloche, sa sortie de l’école. Pour le moment, ses premiers ouvrages, d’un faire très personnel, l’ont mis en vedette. Il est du cénacle de Médan et ne jure que par Flaubert, les Goncourt et Zola.
Voici comment en 1877, dans l’Actualité, de Bruxelles, il jugeait ses modèles. Remarquez la sûreté de vision qu’il apporte dans ces croquis faits en deux traits. Il attribue à Flaubert « une énergique concision, le mot qui dit plus qu’une ligne et donne à la phrase une intensité vraiment admirable. » Des Goncourt il note « le style orfévré, s’attaquant aur sensations les plus fugitives et les plus ténues. » Zola, « moins ciseleur, moins joaillier, a une envergure, une ampleur de style, une magnificence d’images qui demeurent sans égales. » Pourquoi donc ce dernier n’a-t-il cherché ses modèles que dans « le médiocre, le misérable et le vil ? » (Charles Maurras).
Mais je m’aperçois que je n’ai rien dit des débuts de Huysmans.
Habiter Paris, être fixé dans le quartier latin ; après de bonnes études classiques, exercer une profession qui laisse des loisirs ; s’adonner aux lettres qu’on aime d’instinct ; publier de premiers essais d’un tour personnel, d’une sav)eur neuve, d’une intensité rare, s’agréger aux écrivains en renom, collaborer aux feuilles d’avant-garde et aux revues jeunes, y faire passer des articles à sensation, des morceaux piquants par eux-mêmes ou par leur titre ; persévérer dans la carrière, surmonter les obstacles, s’opiniâtrer à réussir — il n’en faut pas moins, et souvent pas plus, pour conquérir la notoriété.
Tel fut le cas de Huysmans. Sa vocation s’éveille sur cette rive gauche saturée d’art, de science et de littérature. Aucune contradiction familiale n’entrave le débutant. Il donne l’essor à ses rêves, dès sa sortie des études. « Les pensums finis, la littérature commence, » disait Flaubert : et comme Huysmans est au régiment, et qu’en temps de guerre il y a beaucoup à voir, à entendre, à endurer et, partant, beaucoup à décrire, l’apprenti de lettres s’essaie au métier en rédigeant Sac au dos. (3)
Cette vocation littéraire fut-elle raisonnée ? J’en doute. On se sent des aptitudes, on les exerce : un milieu favorable aide à leur développement, les premiers succès encouragent, et l’on devient quelqu’un ; mais il est rare qu’on entre dans la carrière avec le dessein arrêté de remplir une fonction sociale, de donner un enseignement public et de le donner suivant les règles de l’art d’écrire.
Le jeune troupier songea plus à amuser ses lecteurs qu’à les instruire, et ne fut pas de ceux qui se préparent au rôle d’écrivain par les préalables considérations que nous lisons dans les Traités de style. Son objectif ne fut point d’exercer par la plume une action puissante et ordonnée. Huysmans commença du moins par captiver son lecteur, en lui offrant une image exacte des choses, des peintures fidèles de la réalité. Ses maîtres lui avaient enseigné qu’un auteur qui veut se faire lire doit prendre les gens par toutes leurs facultés, aviver et satisfaire leur naturel désir du bien, leur bon goîit des couleurs et des émotions, éveiller leur émotivité par une action puissante et ordonnée, et pourquoi? parce que nous n’avons qu’une intuition bornée, que nous cheminons pas à pas, allant d’une idée à l’autre, les reliant par la logique, ce principal élément du style. Qui, dans ce qu’il écrit, n’a pas cette raison ordonnée, sera-t-il jamais un écrivain !
Huysmans n’avait pas oublié ces principes, mais la lecture des productions naturalistes, l’admiration pour Flaubert et Zola, son agrégation à un groupe épris des formes plus que des idées et qui devait créer « l’écriture artiste » les lui firent abandonner en partie.
On raconte que Flaubert et Bouillet, camarades d’études, passaient souvent le dimanche à lire ensemble, à se communiquer des plans, à forger des phrases, à chercher le mot juste, à développer leurs théories communes, telles que rimpersonnalité dans l’art, la recherche exclusive de la forme, l’insouci de la morale, etc. Nul n’ignore ce qu’engendrèrent ces théories et comment ces maîtres n’eurent pour disciples que des photographes, peut-on dire, et des myopes. Ils regardent, à la loupe s’il le faut, le sujet ou l’objet, puis froidement, minutieusement, les décrivent, détail après détail, à rencontre des peintres et des presbytes qui mettent et veulent qu’on voie la vie et le sentiment dans l’harmonie générale d’un portrait, d’une scène ou d’un paysage.
Nous trouvons dans les premiers écrits de Huysmans l’application de ces principes et de ces procédés. Zola les at)ait codifiés lorsqu’il avait défini le naturalisme « le retour à la nature et à l’homme, l’observation directe, l’anatomie exacte, l’acceptation et la peinture de ce qui est. w II ajoutait : « Nous voilà loin du roman tel que l’entendaient nos pères, une œuvre de pure imagination, dont le but se bornait à distraire et à charmer les lecteurs, »
C’est par de courtes études et tableautins de mœurs que Huysmans s’était fait d’abord connaître. En 1874 paraissait chez Dentu un petit in-12 à couverture verte, titre rouge : Le Drageoir à épices. La dédicace porte : Aux vieux amis j’offre ce drageoir fantasque et ces menus bibelots et fanfreluches. Ces 115 pages, d’un menu format, comprennent dix-huit chapitres. Je pourrais copier la table : je préfère vous donner le sonnet — mais oui, l’auteur a rimé, qui n’a rimé à son âge ? — sonnet où il annonce les sujets traités :
Des croquis de concerts et de bals de barrière ;
La reine Marguerite, un camaïeu pourpré ;
Des naïades d’égout au sourire éploré,
Noyant leur long ennui dans des pintes de bière :
Des cabarets brodés de pampres et de lierre :
Le poète Villon, dans un cachot, prostré ;
Ma tant douce tourmente, un hareng mordoré.
L’amour d’un paysan et d’une maraîchère.
Tels sont les principaux sujets que j’ai traités :
Un choix de bric-à-brac, vieux médaillons sculptés.
Émaux, pastels pâlis, eau-forte, estampe rousse.
Idoles aux grands yeux, aux charmes décevants.
Paysans de Brauwer, buvant, faisant carousse.
Sont là. Les prenez-vous ? A bas prix je les vends, (4)
L’homme curieux, fureteur, amis des personnages en dehors, des bibelots variés, chercheur de détails, de oie et d’exactitude, plus porté à décrire qu’à imaginer, en quête du rare, de l’anormal, voire du pervers — l’homme que fut Huysmans ne vous semble-t-il pas s’annoncer et se révéler dans cette première et originale production ?
Si du choix des sujets je passe au style, j’y trouv»e déjà l’âpreté et l’aigreur de ses futurs ouvrages, ce dont on ne lui doit faire ni un mérite ni un reproche. N’est-ce pas Quintilien qui conseille de relever les aliments ? Acor in cibis intérim jucundus — acre, Ornatus genus. Ce sentiment, émis relativement au discours, ne perd point de sa justesse à être appliqué au style. Les termes vigoureux, colorés et crus réveillent le lecteur menacé d’assoupissement et le tiennent en haleine. Assurément, et Quintilien le fait observer, il importe que les expressions amères ou violentes ne reviennent pas incessamment et sous la même forme : Satietatem ut varietas earum, ita raritas effugit.
Huysmans a pu forcer la dose : le célèbre grammairien, qui a aussi traité de l’emploi et de l’utilité de la pointe, n’a pas moins vu dans l’acidité un genre d’ornement.
Entre 1874 et 1877 parurent de Huysmans, dans le Musée des Deux-Mondes et la République des Lettres, bon nombre d’articles dont voici les titres : Licenciement de Soudrilles. — La Tulipe. — Image d’Épinal. — Le bon Compagnon. — Rococo Japonais. — Le Collier. — Effet de soir. — La Kermesse Rubens. — Maître Karel Brandt. — Ballade. — La grande place de Bruxelles. — Concours pour le prix de Rome. — Les Envois de Rome. — L’Exposition de noir et de blanc. — Similitudes. — Les Natures mortes. — Diaz. — Carnet d’un voyageur à Bruxelles. — La Hollande.
C’est en 1876 qu’il publia Marthe, (5) à Bruxelles, dans la crainte d’attirer, en France, un procès à son éditeur, tant dans ce nouvel ouvrage les peintures étaient osées.
La préface tient en une phrase extraite du dernier chapitre. Fut-ce pour attester des intentions morales ou pour conjurer des poursuites, la phrase est imprimée en très gros caractères : Les filles comme Marthe ont cela de bon qu’elles font aimer celles qui ne leur ressemblent pas; elles servent de repoussoir à l’honnêteté. C’était, du reste, la prétention de l’école, et de Zola en tête, de ne peindre le mal que pour en inspirer l’horreur. Si cette horreur est proportionnée à la virtuosité du tableau, elle sera profonde à la lecture de Marthe où s’étalent tant d’ignominies, où grouillent tant de bestialités crapuleuses. Voilà un livre vraiment à ne pas lire, à moins d’y être obligé.
J’en puis dire autant des Sœurs Vatard, (6) où « la chagrine vision des contradictions du cœur et des plus bas côtés de l’animal humain s’affirme et s’exacerbe. » (Marcel Fouquier).
Dans les Croquis parisiens, (7) cette vision s’exaspère et le mysticisme paraît.
En Ménage, (8) autre roman naturaliste où « l’observation du détail vulgaire et du machinal de la vie s’empreint parfois d’une tristesse sombre... On sent que le pessimisme de l’écrivain tourne à la crise, et qu’il ricane en frémissant. »
A Vau l’Eau (9) est considéré comme une autobiographie de Huysmans. Il s’y représente sous les traits du bureaucrate célibataire, Folantin, en attendant qu’il prête ses singulières fantaisies à des Esseintes et qu’il devienne le Durtal de la conversion.
Ce petit livre, où la cuisine des gargotes est abominée, trace une parfaite silhouette d’original qui pense et parle autrement que tout le monde, mais qui vous croque les gens à ravir, et vous esquisse des coins de Paris d’un crayon net et vigoureux. La rive gauche, la place Saint-Sulpice, (10) les quais, les bouquins, surtout les bouquins, tant il les aime, s’évoquent sous sa plume. Une chose manque à Folantin pour qu’il s’accommode de l’existence. Ici le raffiné se trahit : « S’il paraissait en librairie, dit-il, des livres réellement artistes, la vie serait, en somme, très supportable. » A ce compte, Huysmans rend la vie heureuse à ceux qui le lisent, car ses livres sont réellement artistes : ce sont des ouvrages licencieux, à audaces et à crudités, mais ce sont des livres faits de main d’ouvrier.
Nous parlons plus loin de l’Art moderne, (11)
Arrivons à l’ouvrage « d’inspiration si complexe, d’où procède la littérature décadente, qui restera comme le bréviaire de la névrose contemporaine, et qui est le point de départ de toute une évolution catholique. » (Abbé Mugnier). J’ai nommé A Rebours. (12) Voici comme le Nouveau Larousse illustré résume ce livre extravagant : L’auteur, en un style artistement fouillé, mais plein d’étrangetés voulues, a écrit l’histoire étrange d’un homme plus étrange encore. Le duc Jean des Esseintes est le dernier descendant d’une noble et antique famille dont la décadence a suivi un cours régulier. Épuisé par tous les excès, détraqué par la névrose, il meuble confortablement une petite thébaïde à Fontenay-aux-Roses, et là, fatigué de la vie telle qu’elle est, il s’organise toute une nouvelle existence à rebours. Il fait du jour la nuit, et vice versa, absorbe des réconfortants par où le commun des mortels évacue les résidus de l’alimentation, etc., etc. En peinture, en musique, en littérature, il ne prise et ne choie que les œuvres bigarres, compliquées, chantournées, et surtout inconnues du vulgaire. Bref, grâce aux comédies qu’il se joue à lui-même, sa vie n’est plus qu’une longue suite d’hallucinations. Conclusion qui s’impose : son penchant pour l’artificiel atteint les dernières limites de l’excentricité, et il tombe si gravement malade, qu’il lui faut y renoncer, sous peine de devenir fou tout à fait. — On trouve dans A "Rebours une verve spirituelle et mordante, beaucoup d’originalité, trop même, des appréciations piquantes, et beaucoup de vérités sous le masque du paradoxe.
Les livres qui avaient précédé celui-ci, tous empreints de matérialisme, avaient beau présenter le vice sous des couleurs moroses, ils n’encouraient pas moins la juste réprobation des moralistes. A Rebours fut, à bon droit, très sévèrement jugé. Toutefois, dans ce livre déconcertant, l’idée chrétienne se fait jour, l’horizon de l’auteur s’agrandit, témoin ce passage significatif que cite l’abbé Mugnier : (13) « Il (Des Esseintes) vit, en quelque sorte, du haut de son esprit, le panorama de l’Église, son influence héréditaire sur l’humanité, depuis des siècles ; il se la représenta désolée et grandiose, énonçant à l’homme l’horreur de la vie, l’inclémence de la destinée, prêchant la patience, la contrition, l’esprit de sacrifice, tâchant de panser les plaies en montrant les blessures saignantes du Christ, assurant des privilèges divins, promettant la meilleure part du paradis aux affligés, exhortant la créature humaine à souffrir, à présenter à Dieu, comme un holocauste, ses tribulations et ses offenses, ses vicissitudes et ses peines. Elle devenait véritablement éloquente, maternelle aux misérables, pitoyable aux opprimés, menaçante pour les oppresseurs et les despotes. »
Le ton s’élève, on le voit, chez le romancier naturaliste, qui bientôt abordera des sujets moins terre à terre et formulera, entre deux romans, ses idées sur l’art et les artistes contemporains.
En suivant l’ordre chronologique de ses productions, nous trouvions l’une des premières études spéciales (14) sur les aspects de Paris, études où excella son talent descriptif. On connaît la plus célèbre. (15) Vint ensuite Un Dilemme (16), où d’avares bourgeois sont mis en scène, avec un relief qui rend plus odieuse leur hypocrisie. J’y ai noté ce croquis de Maître Le Ponsart, pour qui les bonheurs de la vie n’équivalent point à l’allégresse que procure la vue de l’argent même inactif, même contemplé au repos, dans une caisse : « aussi usait-il constamment des petits artifices usités dans les provinces où l’économie a la ténacité d’une lèpre ; il se servait de bobêchons, de brûle-tout, afin de consumer ses bougies jusqu’à la dernière parcelle de leurs mèches ; faisait, ne pouvant supporter sans étourdissements le charbon de terre et le coke, de ces petits feux de veuves où deux bûches isolées rougeoient à distance, sans chaleur et sans flammes ; courait toute la ville pour acquérir un objet à meilleur compte, et il éprouvait une satisfaction toute particulière à savoir que les autres payaient plus cher, faute de connaître les bons endroits qu’il se gardait bien, du reste, de leur révéler, et il riait sous cape, très fier de lui, se jugeant très madré, alors que ses camarades se félicitaient devant lui d’aubaines qui n’en étaient point. »
Un Dilemme vit le jour la même année qu’En Rade, (17) mais il lui est postérieur de quelques mois.
Le récit d’un séjour aux champs que font, chez des grigous, un mari dilettante et une femme névrosée, dont l’affection languit et meurt : voilà En Rade, encore un livre où sites et portraits sont criants de vérité. Parmi ces pages d’un réalisme souvent choquant, surgissent des chapitres entiers d’une fantaisie délirante : tels ce rêve éperdu dans le château abandonné, et la successive apparition fantastique du Palais, de la Femme et du Roi, un de ces morceaux de bravoure à la Flaubert et à la Villiers de l’Isle-Adam. Voici dans la ferme l’envol des pigeons, le jardin, nouveau Paradou ; puis c’est une méditation sur les songes, suivie de l’ultra réaliste gésine de La Lizarde. Le lecteur prend une leçon de géographie lunaire, et on le distrait avec des types de Normands madrés, insolents et féroces, avec ce « fabuleux pochard » de facteur. Suit une dissertation sur la découverte et l’utilisation des ptomaïnes, et voici, « patibulaire et désolant, » le cauchemar d’un sabbat fou, véritable excursion dans les domaines de l’épouvante. Je ne cite pour finir que la visite à une pitoyable église et au cimetière voisin et l’interminable et si pénible agonie d’un chat.
En Rade est un de ces ouvrages « capiteux, odorants et aigus, » comme les aimait Huysmans. Va-t-il enfin cesser de côtoyer la perversion ? Non pas. Voilà qu’un journal publie un livre d’occultisme, de satanisme et de magie qui soulèvera de nouvelles protestations. Toutefois, ce roman sera l’adieu de Huysmans à la littérature profane. Laissons M. Georges Pellissier nous le présenter, (18) « Là-bas (19) s’ouvre par une conversation entre Durtal, jusqu’ici romancier naturaliste, et des Hermies, l’apôtre du nouvel évangile. Ce dernier fait une charge à fond de train contre le naturalisme ; il lui reproche « de rejeter le suprasensible, de dénier le rêve. » Après les romantiques, « qui extrayaient la littérature d’un idéalisme de ganache, » nos naturalistes se sont « confinés dans les buanderies de la chair, » n’ont « fouillé que des dessous de nombril. » Il faut autre chose. Aux plats décalques de la vie réelle, le temps est venu de substituer la divination des « après » et des « ailleurs. » Et Durtal sent s’effriter peu à peu dans son esprit une doctrine qu’il avait crue inébranlable. Ne voyant d’ailleurs, en dehors du naturalisme, que les « œuvres lanugineuses des Cherbuliez ou des Feuillet, » les « lacrymales histoires des Theuriet ou des Sand, » ou bien encore « le coriace et gaminant fatras de ces soi-disant psychologues, » qui se bornent à jeter dans les juleps de Feuillet les sels secs de Stendhal » (vous êtes-vous reconnu, ô Paul Bourget ?), il se prend à croire que des Hermies a raison, et que, si quelque chose peut régénérer les lettres, c’est ce besoin et ce goût de l’« au-delà »> qu’éprouve notre génération inquiète.
Appliquer au surnaturel les procédés du naturalisme, voilà la formule de salut. Lui-même, quittant déjà « l’adultère, l’ambition, l’amour, tous les sujets apprivoisés des romanciers modernes, » a entrepris d’écrire la vie du maréchal de Rais : admirable matière au premier essai de sa nouvelle formule que ce mystique en délire, conduit par son mysticisme même à tout ce que l’imagination peut concevoir de plus curieusement exquis dans le satanisme de la débauche et du meurtre !
Ancien disciple de M. Zola, M. Huysmans se distingua tout d’abord entre les naturalistes les plus méprisants par son zèle à dégrader l’existence, à dégoûter l’homme de lui-même en lui tenant le nez sur ses ordures. En parallèle avec le tableau des Halles dans le Ventre de Paris, mettez celui d’une devanture de restaurant (20) avec ses vinaigrettes persillées de bœuf froid, ses ratas figés aui navets, ses tôt-faits aux plaques noires, godant sur leur bourbe jaune, son lapin ouvert dans un plat, les quatre pattes en l’air, étalant le violet visqueux de son foie sur une carcasse lavée de vermillon pâle, — et vous verrez en quoi diffèrent le large, le plantureux matérialisme du maître, et le raffinement méticuleux avec lequel le disciple choisit les détails les plus répugnants comme s’il avait pris à tâche de nous soulever le cœur. M. Huysmans peignait des choses insignifiantes, qui montrent le misérable vide de ce monde, des choses abjectes, qui en inspirent le dégoiit. Il attachait l’intérêt de ses récits à quelque héros tourmenté d’un besoin physique (c’est le sujet de Sac au Dos), et la sympathie à tel autre, celui d’A Vau l’Eau, qui poursuit à travers les plus sales rues de Paris l’idéal d’une gargote où la cuisine ne soit pas trop répugnante...
Mais pourquoi s’acharner à peindre la vie dans sa nullité crasse, dans sa turpitude nauséabonde ? Déjà M. Huysmans nous avait montré des Esseintes essayant de vivre « à rebours. » Sa nouvelle œuvre porte un titre non moins significatif que celui du roman baroque et fantastique dont ce type du « déca- dentisme » maniaque était le héros. Là-bas, c’est le monde des choses occultes, des pratiques sacrilèges, des folies meurtrières et obscènes auxquelles se prend en dernier recours la recherche de ce que nos décadents appellent la sensation rare.
Un tel livre ne s’analyse pas. Sauf les affreuses amours de Durtal avec une sorte de goule et quelques scènes, vraiment puissantes, mais d’une outrance forcenée, dans la légende de Gilles de Rais, on n’y trouve guère d’un bout à l’autre que conversations et dissertations entre lesquelles viennent çà et là s’intercaler quelques épisodes de magie noire. Comme, afin de mieux comprendre le satanisme du XVe siècle, Durtal se fait initier à celui de notre temps, c’est pour lui une occasion toute naturelle de couper son histoire du maréchal par les plus doctes conférences sur « le courant démoniaque contemporain. » Et nous, qui ne sommes pas grands clercs en ces matières, nous tenons pour vrai tout ce que l’auteur veut bien nous en découvrir ; mais qu’il nous soit permis, après avoir rendu justice à son érudition, de la trouver un peu bien accablante. Trop de consultations à notre goût sur les travaux spagiriques, sur l’astrologie, sur l’incubat et le succubat, sur la « démonopathie » et tout ce qui s’y rattache. M. Huysmans verse ses notes avec une abondance inépuisable. Son nouveau roman relève du genre didactique ; c’est un manuel complet du diabolisme ancien et moderne.
Aussi bien, Là-bas fait tout naturellement la suite d’A Rebours. Gilles de Rais, tel du moins qu’on nous le présente, est le des Esseintes qui a pioché la littérature de son sujet. Rappelons-nous quelle admiration le héros d’A Rebours professait pour Baudelaire et pour Barbey d’Aurevilly. Chez le premier, il aimait son idéal de dépravation morbide, et chez le second, un sadisme mystique qui ne consiste pas seulement à aiguiser les excès de la chair par des sévices, mais dans lequel entrent encore je ne sais quelle rébellion morale, le goût raffiné du sacrilège, une érotomanie satanisante. Le nouveau roman de M. Huysmans est là tout entier avec cet éréthisme dont il nous peint les fureurs sanglantes et les turpitudes impies... »
Telle est, admirablement résumée, la dernière œuvre de dépravation, peut-on dire, qu’a écrite Huysmans. D’après M. de Gourmont qui la vit composer et la connut manuscrite, elle est romanesque dans son ensemble, et la plupart des scènes sacrilèges sont imaginaires.
Quand parut Là-bas, ajoute-t-il, la conversion de l’auteur était déjà en train, mais s’il la désirait, il l’espérait à peine, et peut-être la redoutait. Ce fut longtemps, en effet, son état d’esprit, jusqu’au jour où « priant pour la première fois, l’explosion se fit. »
Arrêtons ici la revue des ouvrages profanes. Mais avant d’aborder les productions chrétiennes, depuis En Route jusqu’aux Foules de Lourdes, exposons brièvement les procédés de composition qui donnent aux œuvres de l’écrivain tant de couleur, de précision et de force.
Dès ses débuts, nous l’avons dit, ces qualités se firent jour. Mais par quel art ou quels artifices un homme qui, en définitive, n’a écrit que sa propre histoire, déroulé qu’un unique personnage, ayant gardé toute sa vie la même manière de voir et de peindre ; comment cet homme a-t-il réussi, au cours de vingt ouvrages, à intéresser constamment le public ?
Le choix, la hardiesse et le rendu des sujets y sont évidemment pour beaucoup. Le lecteur s’attache aux écrivains originaux. Encore est-il bon de connaître de quels éléments se compose leur originalité.
Rappelons que l’écriture de Huysmans est essentiellement artiste, c’est-à-dire, au plus haut point expressive de l’objet observé. De sa plume, il a fait un pinceau ; ses procédés sont ceux du peintre, mais d’un peintre qui n’a mis sur sa palette que des couleurs vives et crues, je veux dire des mots voyants, tranchants, des vocables que lui et ceux de son école affectionnent. Ces vocables, il s’est étudié à les disposer d’une façon nouvelle et inattendue, moins dans le but de plaire que dans celui de frapper. Ainsi le voit-on souvent rejeter au bout de la phrase noms, verbes et qualificatifs, choisis non parmi les mots usuels, mais parmi ceux qu’il a faits siens : les vieux qu’il rajeunit, les désuets qu’il remet en circulation, et les nouveaux, empruntés au latin, qu’il francise, sans compter ceux qu’il invente.
Donnons quelques exemples des mots latins francisés. Pour jouissances il écrit fruitions, exorer pour prier, aurifier pour dorer, pour brûler arder ou ardre, pour nourriture nutriment, ergastule pour prison, fiance pour confiance, barathre pour abîme, déterger pour nettoyer, s’excaver pour se creuser, adjuver pour aider, lénifier pour adoucir, diluer pour délayer, ambuler pour marcher, térébrer pour percer, se délinéer pour se dessiner, enter pour greffer, etc., etc.
Les chrétiens sont des christicoles et les saints des célicoles. Parmi les néologismes de sa création, je citerai ricasser qui, je crois, signifie jacasser et rire : dire que le ciel se brouille ne lui paraît pas assez expressif, il imagine se chabouille ; chicoter est mis pour chicaner, larmer pour pleurer, anonchalie pour étendue nonchalamment. Entre les termes nobles ou seulement courants et les termes populaires, ces derniers ont sa préférence : les enfants sont les gosses ou les mômes ; enfin, les mots les plus imagés, les plus à effet, les plus incisifs, les plus forcés de ton et même les plus outrés sont les siens. Il écrira goulu au lieu de gourmand, guigner pour convoiter, larronner pour voler, gingembrer pour poivrer, et il dira soutanier pour prêtre, parlera du boucan des Ave Maria, (21) et appellera les bibliothèques des cimetières à paperasses.
Il me revient ici d’autres mots qui ont scandalisé non sans apparente raison : les mots bondieuserie, et bondieusarderie, par exemple. Huysmans n’en avait pas trouvé d’autres pour qualifier les objets du culte, ornements et orfèvreries dépourvus d’art et qu’on voit trop, partout, les mêmes. Ces mots répondant à sa pensée, il n’a pas reculé devant leur emploi, au risque de paraître irrespectueux.
J’ai noté encore, parmi les expressions moins risquées mais forcées : s’éperonner pour s’exciter, se sentir fouetté pour remué ; une corde qui crie sur un treuil le scie ; un visage sillonné de rides est dit raviné ; des lueurs ne sont point vacillantes mais louvoyantes ; où nous dirions que des frayeurs redoublent, il dit qu’elles galopent ; les désemparés sont des démâtés, les gens épris des assotés.
Loin de fuir la vulgarité, il la recherche quand il appelle un confessionnal guérite ou cabine aux aveux. Il s’ébroua devant la douleur, dit-il, d’un malade non résigné. Ces procédés font comprendre que le style de Huysmans ait tant de relief et de couleur. Prenons encore quelques exemples.
Vous ou moi pensons d’un homme ruiné qu’il n’entrevoit plus que des jours sombres : notre auteur écrit : « A l’horizon de menaçantes files de lendemains noirs, » Les couchers de soleil, les crépuscules, la « brune, » la nuit tombante ont été décrits, décriras-tu, en vers et en prose. Pour ne parler que des poètes, depuis le classique La Fontaine qui écrivait simplement :
Lorsque n’étant plus jour il n’est pas encor nuit,
jusqu’au romantique Lamartine qui chanta
Le roi brillant du jour se couchant dans sa gloire.
que d’apothéoses du soleil, que de romances à la nuit ! Un naturaliste se doit de donner du spectacle quotidien une impression vraie. Voici ce qu’a trouvé Huysmans : « Au solennel fracas du couchant en feu avait succédé le morne silence d’un firmament de cendre. »
Si j’étais dans une chaire de professeur, je ferais remarquer à mes élèves les différences spécifiques des impressions et des descriptions, et quantité de choses qu’interromprait seule la fin de la classe... Je laisse au lecteur le soin de comparer et de juger ; et pour lui permettre de le faire en meilleure connaissance de cause, je lui communique les trois pages qui vont suivre.
Qui a lu Sainte Lydwine de Schiedam sait que le franciscain Jean Brugman fut l’un de ses premiers biographes. Or, un fervent (22) de Huysmans qui possède en éditions originales, et sous des reliures de Meunier, s’il vous plaît, tous les ouvrages du maître, m’a communiqué une traduction française (1601) du livre de Brugman, ainsi qu’une Vie de la Bienheureuse par M. l’abbé Coudurier, publiée à Paris en 1862. Eh ! bien, prenons le récit d’une maladie de la sainte, suivie d’une chute sur la glace et comparons la différence des styles.
RECIT DE JEAN BRUGMAN
Lydwinne, parvenue, donc qu’elle fut à l’aage, plus ou moins de XV. ans, a esté rendue fort difforme par le moyen d’une longue maladie, et la beauté de sa face fut de telle sorte transmuée et changée, que ceux qui paravant l’avoyent grandement aymé, la venoient pour alors à contemner, faisant cela cestuy qui ayme les âmes belles es corps aussi non guère beaux. Advint un jour entre les autres, au temps d’yver, quant les courans d’eaues glacés de froidure, facilement soustenoient les pourmenans, que les compaignes de Lydwine, laquelle n’estoit que de peu relevee de sa maladie, la convioient, pour un peu esgaier son esprit, à prendre quelque petit esbatement sur les eaues engelees, selon qu’ont accoustumé les filles hollandaises. Mais elle, laquelle jamais, comme la bonne Sara, n’avoit suivi les joueurs, contemnant tous solas humains, ny volut consentir. Toutefois icelles fort importunement la pressant qu’à tout le moins elle allât avec elles voir les esbats qui se faisoient sur les glaces, à la parfin vaincu par leur grande importunité, s’y accorda, et de fait y alla avec elles, n’estant encor affermie en santé de son corps, où qu’estant arrivée elle regarda les filles courantes çà et là, tombantes en terre, dessus dessouz : et voila peu d’heure après qu’une des filles transportée d’une course soudaine et roide sans se pouvoir contenir, fortuitement vint à choquer et hurter contre elle, et tant cruellement la jetta sur les esclats de la glace, qu’une de ses costes luy fut misérablement fracassée et rompue.
RÉCIT DE L’ABBÉ COUDURIER
A seize ans, elle avait fait une maladie, peu alarmante, il est vrai, mais qui avait duré plusieurs mois. Pendant sa convalescence, quelques jeunes filles vinrent un jour la visiter, ou plutôt vinrent lui proposer un instant de récréation. On était en plein hiver ; le froid avait été rigoureux : une glace épaisse couurait partout la surface des eaux. Or, par toute la Hollande, il est un amusement fort goûté : c’est la course en patins, amusement plein de charme, plein de mouvement, aussi innocent d’ailleurs qu’il est favorable à la santé. Hommes, femmes, enfants, tout le monde se donne volontiers ce passe-temps ; les jeunes Hollandaises surtout y excellent. Réunies entre elles, on les voit, sur ces minces lames d’acier solidement fixées à leur chaussure, aller, venir, se mêler en voltigeant, décrire mille bigarres contours, tracer sur la glace, avec autant de grâce que de légèreté, les plus capricieuses figures ; puis s’élançant, courir, franchir l’espace, rapides comme l’oiseau qui fend l’air.
Les compagnes de Lydwine allaient donc sur la glace ; elles venaient, en passant, l’inviter à les suivre. Celle-ci, nous le savons, redoutait la dissipation. S’excusant sur sa mauvaise santé, et tout en remerciant, elle refusa. « Mais, s’écrièrent les jeunes filles, c’est votre santé précisément qui doit vous décider ! Vous avez besoin de mouvement, venez, partagez nos jeux ; un peu d’exercice vous fera du bien. Quand vous ne viendriez que sur le bord de la rivière, pour voir nos amusements de loin, cela seul vous réjouirait ; venez toujours ! » Lydwine eut beau renouveler ses excuses ; elles renouvelèrent si bien leurs instances, que la pieuse fille, craignant de les contrister, finit, avec l’agrément de son père, par céder à leurs désirs.
Elle se met donc à les suivre, descend avec elles sur la glace et prend des patins. Or, il y avait à peine quelques instants qu’elle se livrait à cet exercice, quand une de ses compagnes, lancée à toute vitesse, ne sachant ou ne pouvant ni se détourner ni s’arrêter à temps, vint à l’improviste se heurter contre elle. Le choc fut terrible. La pauvre convalescente pirouetta sur elle-même, puis tomba violemment contre un amas de glaçons et s’y brisa une côte.
RÉCIT DE HUYSMANS
Alors elle eut une maladie qui ne mit point ses jours en danger, mais qui la laissa dans un état de faiblesse qu’aucun des pharmaques prônés par les mires et les apothicaires de cette époque ne parvint à vaincre. Devenue étonnamment débile, elle languit ; ses joues se creusèrent et ses chairs fondirent ; elle maigrit à n’avoir plus que la peau et les os ; l’avenance même de ses traits disparut dans les saillies et les vides d’une face qui, de blanche et rose qu’elle était, verdit, puis se cendra. Ses souhaits s’exauçaient ; elle était cadavériquement laide. Ses prétendants se réjouirent d’avoir été évincés et elle ne craignait plus de se montrer.
Cependant, comme elle n’arrivait pas à recouvrer ses forces, elle gardait la chambre, quand, quelques jours avant la fête de la Purification, ses amies la visitèrent. Il gelait, à ce moment, à pierre fendre et la rivière, la Schie, qui traverse la ville, était, ainsi que les canaux, glacée ; par ces temps de froidure acérée, toute la Hollande patine. Ces jeunes filles invitèrent donc Lydwine à patiner avec elles ; mais, préférant demeurer seule, elle prétexta du mauvais état de sa santé pour ne pas les suivre. Elles insistèrent, tant et si bien, lui reprochant son manque d’exercice, l’assurant que le grand air lui ferait du bien, que, de peur de les contrarier, elle finit, avec l’assentiment de son père, par les accompagner sur l’eau devenue ferme du canal derrière lequel sa maison était située ; elle s’était relevée, après avoir chaussé ses patins, quand l’une de ses camarades, lancée à fond de train, se rua sur elle avant qu’elle eût pu se détourner et elle culbuta sur un glaçon dont les aspérités lui brisèrent l’une des fausses côtes du flanc droit.
Pour user d’un verbe familier à Huysmans, je dirai que son genre d’écriture « s’avère » dans cette narration pleine, précise et brève, où sont piquées de termes anciens à étymologie latine des phrases communes, il est vrai, mais qui donnent au récit de la vigueur et du montant. Quand on pense que l’écrivain a marqué chaque page de ses livres de cette empreinte personnelle, on ne peut qu’admirer son immense et consciencieux labeur.
Est-ce à dire qu’on doive ranger Huysmans parmi les maîtres de la langue ? Je m’en voudrais de laisser entendre que je le place en si haute compagnie et suis le premier à déclarer qu’il n’a rien des grands et purs classiques, dédaigneux qu’il fut d’ailleurs des formes solennelles de la littérature. Il lui a manqué le sens du rythme, a dit Henri Brémond, qui voit en lui avec raison une sorte de primitif, ayant « la crudité des impressions, la simplicité anguleuse des idées, le dédain des mièvreries et la recherche des effets grotesques. » J’accorde même qu’il n’a — pour ne nommer que des contemporains — ni la vivacité qu’en sa force épaisse garde Maupassant, ni la clarté souple d’Anatole France. Visuel comme Daudet et ingénieux à filtrer les observations et les renseignements, il ne fut pas au même point émotif et attendri. Comme lui, il eut les yeux habiles à attraper et à noter le détail juste, comme lui la mémoire des trouvailles, mais infiniment moins de sensibilité. Il est aussi éloigné du haut et vibrant langage de Vogué que du clairon héroïque de d’Esparbès ; mais il a de Mirbeau, moins les accès d’enthousiasme, la fougue et la violence ironique et amère.
Ces derniers mots me rappellent un passage du « Monstre » de Certains ; je vais le transcrire, mais non sans l’opposer — nouvelle étude comparative, — à une page de Coppée, toute de grâce harmonieuse et fluide. Après avoir montré l’enfant joignant ses petites mains sous les mains maternelles et faisant sa prière, Coppée ajoute : « Oui, vous êtes agréables à Dieu, et vous prenez un sublime essor vers sa gloire, prières de tous les chrétiens ! Hymnes liturgiques chantées par les prêtres, cantiques en toutes langues lancés à pleine voix par l’assemblée des fidèles, harmonieux orages des grandes orgues, qui faites tressaillir la nef des cathédrales, chœurs des pèlerins en marche vers quelque sanctuaire, qui éveillez les échos des montagnes, pieux sanglots des affligés auprès des tombeaux, plaintes douloureuses des âmes repenties, paroles enflammées de la religieuse et du moine en extase dans sa cellule, oui, vous montez jusqu’au Trône du Tout-Puissant ! Mais, avant tout, il est le Père, et dans l’immense, dans l’éternelle rumeur des voix qui le louent et le confessent, il écoute aussi tendrement, j’en suis sûr, les candides et presque inconscientes prières des petits enfants, pareilles à un confus ramage d’oiseaux, »
Laissant le doux poète à l’intérieur du temple, accompagnons le dur prosateur parmi les monstres qui s’érigent autour de Notre-Dame de Paris : « Penchés depuis cinq cents ans au-dessus de l’énorme ville qui les ignore, ils contemplent sans se lasser les incommutables assises de la bêtise humaine. Ils suivent à travers les âges les exploits du vieil homme obsédé par le souci charnel et l’appât du gain ; ils hument l’exhalaison des inusables vices, surveillent la crue des vieux péchés, vérifient l’étiage de l’éternelle ordure que choie l’hypocrite voirie de ces temps mous.
Sentinelles placées à des postes oubliés sur des seuils perdus dans l’au-delà des vents, ils exécutent une consigne inconnue dans une langue morte. Ils ricanent, grincent, grondent, sans pitié pour les affreuses détresses qui clament pourtant, sous leurs pieds, dans les douloureux lits des hôpitaux voisins. Ils incarnent les puissances nociues à l’affût des âmes ; ils démentent le miséricordieux espoir des principales images sculptées, plus bas, sur le portail, contredisent la Vierge et le saint Jean dont les statues supplient le Seigneur de rédimer enfin ce misérable peuple qui radote et délire depuis cinq siècles ! »
Abandonnant au lecteur sa liberté de jugement touchant ces deux morceaux, j’ose dire que si l’un est un délicieux chant de rossignol, l’autre est un puissant cri d’aigle. Le style, si travaillé qu’il soit, reste dur et rugueux. Que voulez-vous ? Il av>ait horreur du contenu, de la rhétorique, du pastiche, du lieu commun, même et surtout de la belle phrase académique. C’est de Tristan Corbière qu’il disait :
« II n’a rien d’impeccable, c’est-à-dire d’assommant. » J’ai noté l’impression que firent à Huysmans les poésies de Corbière : elles doivent être singulièrement bizarres et tourmentées, à en juger par ces lignes : « Le cocasse s’y mêle à une énergie désordonnée, des vers déconcertants éclatent dans des vers d’une parfaite obscurité... L’auteur parle nègre, affecte une gouaillerie, se livre à des quolibets de commis voyageur ; puis tout-à-coup, dans ce fouillis, se tortillent des concetti falots, des minauderies interlopes, et soudain jaillit un cri de douleur aiguë, comme une corde de violoncelle qui se brise. » Il semble bien que ces lignes expriment exactement l’effet qu’ont produit les vers sur le critique, elles n’en sont pas moins pénibles à lire. (23)
Le style de Huysmans a l’attrait des choses robustes : mais on n’y trouve ni la grâce ni le sourire, que d’ailleurs il n’y voulut point mettre. Pour lui, un livre est fait avant tout pour être lu. Il faut donc piquer l’attention du lecteur, la soutenir et la capter. Des mots neufs, bien choisis, des expressions fortes, des répétitions fréquentes lui paraissant propres à faire lire tout l’ouvrage, il a employé les susdits moyens sans se lasser, sinon sans lasser les gens de goût. A quelqu’un qui lui aoait fait observer les redites des Foules de Lourdes, il répondit :
Ne vous inquiétez pas des répétitions. Le volume est, à cause même du sujet, fabriqué tout le temps avec les mêmes mots. La question est que, lu à la suite, il y ait, avec cadences spéciales des phrases, un côté aigu et perforant dans les descriptions des lamentables foules.
Il a fallu tout sacrifier à cela — Grotte, malades, souffrances, etc. Ça revient tout le temps — mais c’est inévitable. Et les mots, ici, et Lourdes — et le je, zut ! La question est que si il n’est pas raté, vous le consommiez furieusèment d’une traite jusqu’au bout.
Des diverses citations qui précèdent, il appert que Huysmans est un écrivain difficile à classer, féru qu’il est d’inédit et d’inexploré, et sa méthode toute réaliste s’appliquant à rendre non des idées abstraites, mais les plus concrets et les plus vulgaires objets, avec, a-t-il dit lui-même, des mots « qui faisaient feu » et des phrases qui « picrataient. »
Si caustique et mordant qu’il soit dans ses romans, il l’est plus encore dans ses articles de critique, dont les principaux forment deux volumes : L’Art moderne et Certains. (24)
Voici la déclaration qui ouvre le premier recueil : « Contrairement à l’opinion reçue, j’estime que toute vérité est bonne à dire. » Cela promet et cela tient, vous pouvez m’en croire.
La finesse native de Huysmans, aiguisée à la finesse parisienne, le disposait à juger sainement et sûrement les peintres. Aussi lui devons-nous des pages lucides et fortes ; mais son intransigeance, sa haine des fausses esthétiques et des snobs, non moins que son goût pour les mots outrés, en ont fait le plus impitoyable des censeurs. Il semble que Barbey d’Aurevilly ait eu en vue notre auteur lorsqu’il a défini la Critique (25) : « la fantaisie exceptionnelle et hautaine d’un esprit solitaire et assez fortement trempé pour vouloir imposer à la foule ses admirations et ses mépris. »
Huysmans exerça crânement cette fantaisie et cette bravoure sur les exposants du Salon de 1879. Il s’y montra iconoclaste, (26) mais, après vingt et trente ans, la sûreté de ses jugements, sa science et sa conscience s’avèrent et lui font grand honneur. Ceux qu’il a tués sont bien tués, et ses campagnes en faveur de « certains » sont devenues, comme on l’a dit, des victoires.
En le voyant qualifier le pinceau de Raffaëlli « féroce, brutal et dur, » je pense autant au critique qu’à l’artiste. Les deux amis étaient faits pour s’entendre.
Certains débute par un chapitre savoureux sur le dilettantisme, et qui donne le ton général du livre. La belle volée de bois vert administrée aux gens du monde, chercheurs de jouissance et non de vérité, qui se croient aptes à apprécier « l’art le plus compliqué, le plus verrouillé, le plus hautain de tous ! » La volée se prolonge sur l’échine des critiques « hésitants et satisfaits, amortis et veules, et qui, pour cela même, sont réputés hommes de goût, hommes bien élevés, compréhensifs et charmants, délicats et fins. »
Entre deux « abatages » voici des louanges. D’abord, une superbe évocation du prestigieux Gustave Moreau, puis un vibrant plaidoyer pour Degas, de nettes clartés sur Chéret, une sympathie ouverte pour les portraits-fantomes de Wisthler et pour l’ironie sagace de Forain. Suivent quarante pages étonnantes sur Rops l’aquafortiste, qui dessina et grava sous tant de formes l’esprit de luxure.
Plus loin, Huysmans, rêvant d’un musée de là peinture contemporaine, que fonderait un archi-millionnaire, dresse la liste des œuvres à y admettre, mais, se reprenant vite: « Nul, dit-il, n’atténuera par une telle donation le permanent outrage que sa scandaleuse fortune nous impose, car le propre de l’argent est de parfaire le mauvais goût originel des gens qu’il gorge. La richesse va en peinture là où son groin la mène. » On n’est pas plus féroce.
Il décrit ensuite une planche curieuse de Jan Luyken, d’Amsterdam, puis en vient aux monstres des temps antiques chez les nations primitives, aux dragons, aux hydres, aux chimères qu’on ne voit plus que dans les sculptures des cathédrales et les vies de saints. C’est dans cet historique étourdissant que j’ai pris la page citée plus haut.
Le « Monstre » est suivi d’une vibrante aquarelle des ruines de la Cour des Comptes, puis voici « le Fer. » Si l’intérieur de la Galerie des Machines a trouvé grâce devant l’implacable critique, la Tour Eiffel passe un fort mauvais quart d’heure.
Laissant les considérations philosophico-artistiques, l’auteur revient aux peintres, Corot, Courbet, Millet, entendent de dures vérités ; Goya et Turner sont loués pour l’effet que font leurs toiles, vues à distance. Suit un vivant croquis des Croisés à Constantinople, par notre Eugène Delacroix. On s’attend à réloge d’un peintre, auteur de tant de chefs-d’œuvre. Lisez : Delacroix n’est qu’un « Rubens dégraissé et affiné par les névroses, débarrassé du gros côté d’art peuple et de peinture bouchère que posséda, malgré son prodigieux talent, le diplomate sanguin d’Anvers. »
Après une exécution sommaire d’Ingres, qui « sorti du portrait, n’est rien, » on lit une savante et suggestive étude sur un primitif italien, Bianchi. Le tableau contient-il tout ce qu’y a vu Huysmans : des yeux limpides à la surface et troubles au fond ? C’est à croire, mais l’œuvre, peut-être parce qu’elle est délibérément réaliste, lui paraît imprégnée du plus subtil et impérieux talent. Lisez encore : « Sans rémission, les amateurs louent le chancelant sourire de la Joconde ; mais combien plus mystérieuses, plus dominatrices, sont ces lèvres closes, augustes et navrées, douces et mauvaises, vives et mortes ; combien les yeux attendus, sûrs, du Vinci, sont vides, si on les compare à ces prunelles en eau de roche ou en eau de rivière qui, frappée par la foudre, s’épure après l’orage. »
Qui sait ainsi regarder une toile et ainsi la juger, est un maître homme.
On eut vite fait d’appeler « pompiers » les écrivains pompeux. Huysmans, qui fut l’antipode des uns et des autres, échappa longtemps à l’épithète. On pourra le déclarer tranchant, brutal et parfois injuste, dire qu’il abuse des expressions violentes, qu’il est pénible à lire, qu’il ne faut le prendre que par tranches, et l’on n’aura pas tort. Mais serait-il équitable de ne voir que ses défauts ?
Huysmans ! « un cubiste ! » disait devant moi un avocat lettré. Simple boutade, mais que n’eût point lancée le jeune maître, s’il eût connu le talent rare et l’art consommé de l’écrivain et du critique. Je me rappelle que l’expression « se pouiller l’âme » déplaisait aussi à l’avocat. Il eût préféré peut-être la phrase vulgaire : « faire son examen de conscience » et eût reproché à Barbey d’Aurevilly d’avoir appelé la Chronique, « cette pouilleuse des petits faits. » Que Huysmans ne soit pas l’homme des délicats, cela s’explique, mais des robustes comme Charles Maurras devraient bien lui épargner leur mépris.
Soyons équitables : rendons grâce aux esprits originaux et créateurs, qui tirent des mots un sens ou un son nouveau, qui les prennent dans leur acception étymologique, ce qui est souvent une façon de les rajeunir, qui, enfin de compte, sont des bienfaiteurs de la langue, puisqu’ils la rénovent et l’enrichissent.
Huysmans haïssait l’écriture banale, les propos de convention et les jugements tout faits. Il a l’horreur du lieu commun. Une chose l’indigne, il le dit et dit pourquoi. Que de gens, sans l’avouer tout haut, lui ont donné raison ! Combien aussi ont gardé rancune à ce diseur de vérités! Et qu’il lui a donc fallu de talent et d’opiniâtreté pour conquérir l’élite ! Cousin disait un jour en chaire, avec des gestes de moulin à vent, paraît-il : « Messieurs, rien de plus facile que d’être célèbre. Vous priez trois ou quatre de vos amis de vous faire une célébrité, et ils vous la font, » Cela ne pouvait être un secret que pour les naïfs. A vrai dire, le procédé ne crée que des célébrités éphémères, des noms écrits sur le sable et qu’efface le moindre vent. Ces industries, ces complaisances, ces crédulités n’en existent pas moins, au détriment de la critique et de l’opinion, critique sans loyauté, opinion qui se laisse piper par ceux qui devraient l’éclairer.
Huysmans, l’intransigeant et le démolisseur, se passa des faiseurs de célébrité. Il ne dut sa renommée qu’à son scrupuleux et tenace labeur. Ciselant les phrases comme un orfèore les bijoux, mettant au point rêvé page après page, il lui était bien permis de chercher dans les œuures d’autrui l’art qu’il mettait dans les siennes. On le voyait d’ailleurs si sincère, et il justifiait si clairement ses arrêts qu’on en vint à les lui pardonner et à ne les prendre que pour des chatteries.
Je me suis demandé plus d’une fois de quel œil Huysmans eût vu, au Pavillon de Marsan, cette Exposition d’Art chrétien qui fut une nouveauté, un succès et une révélation. Assurément il aurait aimé les eaux-fortes de son ami Forain, « planches magnifiques de style, de concision et de grandeur, où l’on retrouve tout entier celui que l’indignation a fait un satirique et que la nature a fait un immortel dessinateur. » (L. Gillet.) Nul doute aussi qu’il n’ait apprécié les charmantes œuvres de M. Maurice Denis et celles des vrais artistes chrétiens. Mais combien d’autres lui eussent déplu ! Ici, je laisse parler M. Gillet, (27) dussé-je attirer sur lui les sévérités qu’on eut pour Huysmans : « Rien ne prévaut contre l’impression de dégoût que nous donnent certains pieux bazars. L’art religieux devenu un art inférieur, quelle pitié ! C’était une des choses qui remplissaient le pauvre Huysmans d’une indignation comique et passionnée. La rue Bonaparte lui semblait l’abomination de la désolation. Il s’en figurait les boutiques à la manière des vieilles Tentations de saint Antoine, où cent démons se livrent à un fantastique sabbat, infectent l’atmosphère, souillent le bénitier. Pour sa dernière incarnation — il en aurait juré, le diable avait pris le veston, la valise et le bagou du commis-voyageur en articles de piété. »
Mettons que ces colères dépassent les bornes : mais si rares sont les intransigeants qui défendent leurs idées avec modération !
Pour en finir de la critique des peintres, relevons que James Tissot, qui avait comme Huysmans quitte le profane pour le sacré, et n’avait, lui non plus, cherché à imiter personne, se vit condamner également pour ses productions mondaines et pour sa Vie de N . S. Jésus-Christ.
Résumant ce que nous avons dit de l’écrivain, reconnaissons qu’il lui a manqué le don et l’art d’écrire en bon et beau français. Je ne vois pas de sitôt les professeurs de rhétorique le recommander à leurs élèves. Dans toute son œuvre on sent l’huile, et qu’il a trop cherché à préciser le détail, trop appuyé, mis trop d’hyperbolique violence dans les mots, trop grossi les choses, trop « éreinté » les gens. Selon une expression d’Albert Mockel, on ne sent point chez lui « ce frémissement d’illimité que donne le chef-d’œuvre, » II faut bien dire pourtant que nous lui devons des morceaui qui resteront des pages d’anthologie comme en a laissé son maître, le pessimiste et ironiste Flaubert.
Oserai-je tenter un parallèle ?
Flaubert et Huysmans, qui « ont tenu la plume comme d’autres le scalpel, » commencèrent tous deux par les études de mœurs. L’un les prend en province, l’autre à Paris. Puis ils gagnent les sphères plus hautes de l’histoire et de la psychologie, le premier par l’évocation romanesque de la Carthage religieuse et guerrière, le second par la création ultra-fantaisiste et troublante d’un des Esseintes. Mais tandis que Flaubert finit par rétrécir et rabaisser sa vision au terre à terre de Bouvard et Pécuchet, Huysmans déroule des drames de conscience et nous montre des ascensions d’âmes sur l’échelle mystérieuse dont le pied touche le sol et dont les degrés vont jusqu’au ciel.
L’un et l’autre nous laissent des types et des caractères qui dureront aussi longtemps que les créations les plus célèbres, car les portraits se soutiennent moins par le vêtement de leur temps et l’habileté de main de leurs auteurs, que par l’admirable expression de l’éternelle nature de l’homme.
Notes
(1) M. Georges Pellissier : Le réalisme du romantisme.
(2) « La Terre a paru. La déception a été profonde et douloureuse. Non seulement l’obseruation est superficielle, les trucs démodés, la narration commune et dépourvue de caractéristiques, mais la note ordurière est exacerbée encore, descendue à des saletés si basses que, par instant, on se croirait devant un recueil de scatologie : le maître est descendu au fond de l’immondice. Eh bien ! cela termine l’aventure. Nous répudions énergiquement cette imposture de ta littérature véridique, cet effort vers la gauloiserie mixte d’un cerveau en mal de succès. Nous répudions ces bonhommes de rhétorique zoliste, ces silhouettes énormes, surhumaines et biscornues, dénuées de complication, jetées brutalement en masses lourdes, dans des milieux aperçus au hasard des portières d’express. De cette dernière œuvre du grand cerveau qui lança l’Assommoir sur le monde, de cette Terre bâtarde, nous nous éloignons résolument mais non sans tristesse. Il nous poigne de repousser l’homme que nous avons trop fervemment aimé, »
(3) Sac au dos, publié d’abord à Bruxelles en 1878, et tiré à 10 exemplaires, reparut avec corrections dans les Soirées de Médan, recueil de six nouvelles destiné à affirmer les idées et les tendances de l’école. Le titre fut adopté sur la proposition d’Henry Céard.
(4) Le prix était 2 fr. 50. Une 2e édition parut, en 187S, à la Libraire Générale. La 1re édition vaut aujourd’hui 100 francs. C’est dès la 2e que le Drageoir à épices devint aux épices.
(5) Marthe, Histoire d’une fille. Bruxelles, J. Gay. in-8. Une édition in-12 en fut donnée, avec une eau-forte impressionniste de J.-L. Forain. Paris, Derveaux, 1879.
(6) Les Sœurs Vatard. Paris, Charpentier, 1879, in-12. Une édition de luxe, tirée à 250 exemplaires, a paru illustrée de 28 compositions, dont 5 hors texte en couleurs, par J.-F. Raffaëlli. Préface de Lucien Descaves. Paris, Ferroud, 1909, in-quarto.
(7) Croquis parisiens. Paris, Henri Vaton, 1880, in-8. L’édition est tirée à petit nombre sur papier de Hollande, et ornée de 8 eaux-fortes originales hors texte par Forain et Raffaëlli. Les Croquis parisiens, augmentés d’A Vau l’Eau et d’Un Dilemme, furent réédités en 1905. Paris, Stock, in-12.
(8) En Ménage. Paris, Charpentier, 1881, in-12.
(9) Bruxelles, Kistemaeckers, 1882, in-18, avec portrait de l’auteur. Eau-forte de Am. Lynen. Réédition chez Tresse et Stock. Paris, 1894.
(10) Une rue nouvelle, percée entre la rue Duguay-Trouin et le boulevard Raspail, portera le nom de J.-K. Huysmans. Le sagace investigateur des vieux quartiers de Paris eût été, dit un journal, satisfait de cette désignation. Il était, en effet, profondément attaché à la rive gauche, où il demeura toujours ; il a sa tombe non loin de là, au cimetière Montparnasse ; enfin l’on trouve encore, dans le voisinage de la rue nouvelle, quelques-unes de ces maisons religieuses que l’écrivain converti aimait tant.
(11) Paris, Charpentier, 1883, in-12.
(12) A Rebours. Paris, Charpentier, 1884, in-12. — L’ouvrage fut luxueusement réédité en 1903, avec 220 gravures sur bois en couleurs, de Lepère, in-8. Il n’en fut tiré pour les Cent Bibliophiles que 130 exemplaires. La préface qu’y mit Huysmans est du plus vif intérêt, en ce qu’elle montre son nouvel état d’âme.
(13) Pages catholiques. Paris, Stock, 1899, in-12.
(14) Autour des fortifications. Paris, 1886; in-4 : illustrations de Lepère.
(15) La Bièvre. Amsterdam, 1886, in-8. Cette étude fut reproduite dans plusieurs ouvrages successifs : Les Vieux Quartiers de Paris. — La Bièvre, avec 23 dessins et un autographe de l’auteur. Paris, Genonceaux, 1890, in-8, figures en noir et en couleurs. — La Bièvre et Saint-Séverin. Paris, Stock, 1898. — La Bièvre, les Gobelins, Saint-Séverin. Paris, Société de Propagation des livres d’art, 1901, in-8. Compositions sur bois, par Auguste Lepère.
(16) Paris, Tresse et Stock, 1887, in-16.
(17) En Rade. Paris, Stock, 1887, in-12. — L’ouvrage fut réédité en 1912, gr. in-8, Paris, Blaizot, avec des eaux-fortes en couleurs et des bois originaux de Paul Guignebault. Tirage à 250 exemplaires.
(18) Revue Encyclopédique, 1891.
(19) Là-bas. Paris, Tresse et Stock, 1891 ; in-12. Certains avait paru chez les mêmes éditeurs en 1889.
(20) Dans A vau-l’eau.
(21) Flaubert reprochait à Huysmans de donner dans le trivial et l’argot, en se servant des mots « maboule, poivrots, bibines, godinettes. »
(22) M. Rousseau-Bellesalle.
(23) Qui a dit que c’est avec les mots les plus simples et les plus modestes qu’on exprime les choses les plus profondes ?
(24) Certains. — G. Moreau — Degas — Chéret — Wisthler — Rops — Le Monstre — Le Fer, etc. Paris, Tresse et Stock, 1889, in-12.
(25) Les Ridicules du temps.
(26) Voici quelques expressions de Huysmans pour désigner les Salons de peinture : bourse des huiles, magasin d’accessoires, orgies de médiocrité, saturnales de sottise, triomphe insolent du poncif habile.
(27) Revue hebdomadaire : 9 décembre 1911.
L’APOLOGISTE
Les lecteurs des derniers ouvrages de Huysmans, du Huysmans converti, ne s’étonneront point que je le compte parmi les apologistes de la religion chrétienne. Je l’appellerais théologien, que d’aucuns pourraient estimer le terme impropre et inexact, quoique la Mystique, la Symbolique et la Liturgie, si bien étudiées et traitées par lui, soient du domaine de la théologie : mais apologiste ou apologète, comme il eût aimé à dire, il le fut et sans conteste.
L’Apologétique proprement dite s’entend des réponses victorieuses faites aux détracteurs de la religion ou des polémiques soutenues avec eux. On distingue les apologistes ecclésiastiques, papes, docteurs, pontifes ou prêtres, parmi lesquels s’év)oquent les grands noms de Tertullien, de saint Augustin, de saint Thomas, de Bossuet, de Lacordaire, et les apologistes laïques, moins nombreux et moins illustres, bien que les Pascal, les Chateaubriand et les Veuillot puissent soutenir la comparaison aoec les noms les plus célèbres de l’Église.
Pris dans un sens plus large, le nom d’apologistes est donné à des écrivains ou à des poètes qui, sans prendre position sur le terrain théologique, sortant même parfois de l’orthodoxie, ont défendu certaines mérités religieuses ou seulement la philosophie spiritualiste. C’est dans ce sens qu’on a pu dire (1) de Victor Hugo et de l’auteur des Méditations que ces aèdes merueilleux ont accompli une œuvre équivalente à celle des meilleurs apologistes. « En orchestrant des thèmes métaphysiques avec toutes les ressources de leur harmonieux génie, ils convertirent par persuasion des générations entières de sceptiques ou de matérialistes, imbus des idées de Voltaire, d’Helvétius ou du baron d’Holbach, et que les raisonnements moins éloquents des apologistes professionnels n’avaient point convaincus. »
Notre Huysmans n’a pas, comme eux, « exalté les facultés de rêve qui n’ont cessé de hanter nos contemporains, » il fit mieux. Il défendit, dans la sphère spéciale que lui traçaient ses goûts et ses aptitudes, le christianisme intégral, le pur enseignement catholique.
Croyant, avec l’Église, qu’il n’y a de nécessaire à l’homme que l’amour de Dieu et le salut ; que Dieu mort pour sa créature attend d’elle des adorations, la crainte et la prière ; donnant sa foi totale à la Doctrine telle qu’elle est, telle que l’a transmise la tradition, que l’Eglise l’expose, que ses docteurs la précisent, telle enfin que son infaillible chef la sauvegarde, il fit du Catéchisme son unique norme de vie.
Ennemi, par tempérament et par conviction acquise, des vagues théosophies, des éclectismes débilitants, des dangereuses théories modernistes et de cette thèse criminelle que toutes les religions s’équivalent ou ne sont que les visages fragmentaires d’une indiscernable oérité, il fut un des sûrs gardiens de « l’enclos sacré que deux millénaires de clarté romaine ont délimité des ténèbres. »
Il aima d’un amour actif et démonstratif Jésus-Christ, la Vierge et les Saints, décrivit leurs temples, raconta leurs miracles. Chateaubriand nous avait fait admirer les splendeurs de la religion, ses institutions, ses bienfaits et sa poésie. Huysmans conduit ses lecteurs au pied des autels et les invite à se frapper la poitrine, à son exemple, amplifiant ainsi pratiquement maints chapitres du Génie du Christianisme.
Qu’il me soit permis d’ouvrir une parenthèse.
On regrette souvent, dans le monde des lettres, que l’Église et les catholiques se refusent à agréer pour leurs défenseurs les écrivains de talent et même de génie qui ont fait leurs preuves d’orthodoxie. Voici comme un jeune écrivain, (2) lauréat de l’Académie des Goncourt, formule ses propres doléances : « Les Catholiques gardent envers les défenseurs de leur dogme, de leur morale et de leurs institutions la défiance la plus inexpliquée. Par crainte du désordre que l’art et le goût de la beauté peuvent apporter, indirectement, dans la morale courante, ils écartent de leur armée tous ceux qui leur semblent des aides compromettants. C’est un reste d’influence protestante que cette morosité. Il est pénible de penser qu’elle a barré la route de la Révélation à tant d’intelligences de bonne volonté. »
Ces lignes sont tirées d’une étude sur Ernest Hello, un grand méconnu que l’enthousiaste et généreux auteur de Visages va jusqu’à comparer à un Père de l’Église : « Si bizarre, dit-il, que puisse paraître cette affirmation, il n’en est pas moins indéniable qu’Ernest Hello fait partie de la grande famille des Pères de l’Eglise. On ne conçoit plus qu’il en existe, parce qu’on associe l’idée qu’on se fait d’eux à une foule de conditions qui n’ont pu se rencontrer que dans des temps abolis. On se les figure prélats vénérables, apologistes fougueux et combatifs, triomphant dans les conciles ou dirigeant l’époque par des lettres pleines de conseils admirables adressés aux puissants de la Terre, suscités par Dieu pour vaincre l’hérésie du moment. On se refuse à offrir ce titre à un laïc, fût-il un saint, à un homme ordinaire vivant d’une vie médiocre, sans mandat spécial, sorte de franctireur ecclésiastique.
Et cependant Hello eut toutes les qualités profondes et essentielles qui caractérisaient jadis le Père de l’Église. Il fut apologiste sans défaillance, faisant tout servir aux intérêts de sa foi, usant des moyens mis à sa disposition par la modernité : le livre, la revue et le journal. Il n’eut pas sa place dans un concile ni ne dirigea de ministres et de rois, mais il guetta l’hérésie sous les innombrables et indiscernables masques dont la déguise la complication de la culture actuelle.
Rôle délicat où l’on s’expose à la malveillance de l’Église, très scrupuleuse sur le choix des moyens dont on s’offre à la défendre, et où l’on suit, au péril d’une chute perpétuellement menaçante, une étroite route d’orthodoxie, connue et sans imprévu et bordée d’un double précipice d’erreurs.
Les apologistes ordinaires échouent à l’écueil de la banalité. Ernest Hello sut ne pas s’y briser. C’est qu’il était un voyant, un contemplateur des vérités profondes et qu’une lumière intérieure, sans vaciller, l’éclaira jusqu’à la mort...
Ce qui le différencie du commun des défenseurs de la Religion, c’est qu’au lieu d’opposer sans discussion un système intellectuel à un autre système, il tâche d’assimiler tout ce qu’il examine à l’organisme vivant de sa croyance, la renforçant ainsi d’une alimentation quotidienne empruntée à tout l’univers extérieur plutôt que de l’isoler, abstraite, prisonnière, émaciée au sommet d’une tour d’ivoire qui se perd dans une apparence de firmament... »
J’écourte avec regret l’admirative étude consacrée à Hello, étude que les amis du philosophe se plaisent à relire. Sincère et délicate, elle place dans son vrai jour l’original et sublime penseur qui se rattache à de Maistre et au premier Lamennais, et que pénétrait le sentiment de « l’ordre éternel » : grand styliste, lui aussi, et dont le verbe simple, large et clair comme sa pensée, allait souvent à de magnifiques ironies et à d’héroïques indignations.
Hello, comme Huysmans, mais avec des procédés plus naturels et moins cherchés, fut un apologiste. L’un écrivit pour les philosophes, l’autre pour les artistes. Leur décerner le titre de Pères de l’Église serait toutefois trop étendre une dénomination, réservée aux écrivains des premiers siècles qui se sont illustrés par l’orthodoxie de leur doctrine et la sainteté de leur vie. Du reste, la modestie d’Ernest Hello, sa soumission déclarée au jugement de Rome, renouvelée même dans chacun de ses ouvrages, lui eussent fait repousser le nom de Père et n’agréer que celui d’Enfant de l’Église.
Quant à l’attitude des catholiques et du clergé à l’égard de tel et tel homme de lettres d’un talent supérieur, voici ce qu’écrivait M. Marcel Collière (3) au lendemain de la mort de Huysmans : « Les catholiques n’ont pas tort de voir avec défiance les écrivains nés, les écrivains de race qui se rangent à l’ombre de la Croix: ils estiment judicieusement que ce sont des alliés compromettants, » Et M. Collière, qui avait surtout en vue les écrivains non pratiquants, donnait ses raisons. J’ignore, et ne cherche point à savoir, si elles ont plu ou non à l’auteur du pamphlet, Les Dernières Colonnes de l’Église. J’ai nommé Léon Bloy.
Pourquoi faut-il que ce chrétien du plus éloquent catholicisme, ait précisément, disait de lui Paul Féval, « cette éloquence supérieure qui ferme systématiquement toutes les portes ? »
Vieil admirateur du style de Léon Bloy, je comprends qu’Ernest Hello se soit un jour écrié : « Nous périrons tous, Bloy seul restera, » tant il y a de splendeur et de puissance dans ses « clameurs d’Isaïe ! » Mais je comprends aussi que sa « guerre de trente ans » contre un clergé prétendu médiocre et tiède, non moins que son exécration forcenée du monde catholique contemporain, lui ferment, et doivent lui fermer longtemps, les journaux religieux et les bibliothèques pieuses. Que n’a-t-il écouté le prêtre, son ami des premiers jours, lui criant : « Prenez garde à l’absolu, c’est un soleil qui pourrait vous brûler les yeux... Le Modus est le grand dogme de la raison, (4) »
Soit dit pour expliquer la prudente réserve de ceux qui, ayant charge d’âmes, se doivent de ne les nourrir, et de oeiller à ce qu’elles ne soient nourries, que de saine doctrine et de sagesse, — au risque d’être qualifiés « enténébrés » par notre impertinent Huysmans, auquel il est temps de revenir, après cette longue parenthèse.
Nous avions laissé Durtal au fond des antres sataniques, nous le retrouvons dans le clocher de Saint-Sulpice, s’orientant vers la lumière. Huysmans a renversé sa vie. En Route (5) vient de paraître. Je n’ai point oublié la profonde impression que me fit ce livre. Aujourd’hui, rien qu’en parcourant le répertoire de l’œuvre catholique de Huysmans, dressé par Raymond Vroncourt, je revois se dérouler les étapes de cette conversion qui en devait déterminer tant d’autres.
Retour à Dieu sous l’influence des arts chrétiens, débats de conscience, révoltes charnelles, perplexités, apaisement, bienfaits de la direction spirituelle et de la prière, assauts de scrupules, paix et joie retrouvées par les Sacrements : tout ce qui a précédé la rentrée au bercail réapparaît dans son singulier et inoubliable relief. Toutefois, le genre d’apostolat que l’auteur a misdans son œuvre nous estrévélé par lui dans un « envoi » d’En Route à un bénédictin et dans la réponse faite aux critiques du religieux.
J’emprunte ces deux lettres au Huysmans intime de Dom Du Bourg :
Paris, ce 25 février 1895.
Vous recevrez, en même temps que ce griffonnage, mon nouveau livre. Il défend de son mieux l’Ordre Bénédictin et surtout les Trappes.
En le lisant, n’oubliez pas ce point de vue, qu’il n’est pas écrit, en somme, pour des catholiques, mais surtout pour le monde intellectuel de Paris. Il y a, parmi ces gens-là, une sorte de courant mystique dévoyé. En Route peut canaliser cela. J’y ai donné une sorte de résumé des auteurs mystiques, de notre bonne sainte Angèle, qui aidera à les faire connaître dans ce monde.
Mais il fallait, dans un livre pour un tel public, faire la part du feu, si l’on voulait être écouté. Aussi ai-je dû jeter à l’eau bien des choses, tout le côté dévotionnette, au profit de la haute mystique. J’ai dû aussi dire la vérité sur le clergé qui ne l’aime guère. Bref, il y a à boire et à manger dans tout cela.
Mais le livre est entièrement sincère. C’est une vraie confession d’âme, un essai de célébrer la splendeur des liturgies, l’art admirable de l’Église.
Maintenant, il est une autre question. Je vais déchaîner contre moi tous les juifs et francs-maçons qui nous gouvernent, avec ce livre de catholicisme enragé.
Il n’y a qu’un moyen de me couvrir, c’est la prière. Voulez-vous apporter une pierre au rempart d’oraisons que je dois bien construire et faire construire pour me mettre à l’abri ! Si vous voulez bien demander à la sainte Vierge qu’elle me protège et m’empêche d’avoir des ennuis au ministère, vous me rendrez un bien grand service.
Paris, le 3 avril 1895.
Les observations que vous suggère la lecture d’En Route sont justes, au point de vue que vous envisagez forcément. Des pages auraient dû être supprimées dans ce cas, je le sais bien. Mais si je considère le public non catholique auquel je m’adresse, je risquais, en n’étant ni carré ni franc, de compromettre le tout. Puis quoi ? Qu’est-ce qu’un catholique ? Un homme bien portant ou guéri. Les autres, des malades. Il faut les traiter. Leur donnerez-vous à tous les mêmes remèdes ? Non, n’est-ce pas. Vous admettrez bien que les très malades, tels que je fus — et ils sont nombreux — ne seraient pas guéris avec des remèdes doux. Il faut leur faire rendre la vie, leur donner l’émétique. Eh bien ! mon livre a été un peu cela, un vomitif d’âme.
C’est un remède énergique et désagréable peut-être à prendre. Mais, s’il guérit, ne fût-ce qu’un malade — et ce fait est, — quel médecin pourra maudire ce remède ?
Et ce livre a fait des conversions que je connais ; d’autres sont prêtes ; cela étonne bien des prêtres qui le constatent, puisqu’ils en sont les témoins, mais c’est ainsi. C’étaient, à coup sûr, des gens bien malades ceux-là, et qui se sont appliqué cette médecine de cheval. N’est-ce pas la meilleure récompense que Dieu m’ait donnée de mes efforts ?
Il fait servir le très imparfait au bien. Il est admirable. Au fond, ce qui m’inquiète bien plus que tous les livres, c’est de ne pas asser l’aimer. — Je crois que je l’aime bien tout de même, mais je ne le sens pas et j’en souffre.
L’En Route de Huysmans n’égale assurément point les immortelles Confessions de saint Augustin. Il ne contient ni les hautes considérations philosophiques, ni la dialectique puissante, ni la profondeur de vjues que révèle le plus célèbre des Pères de l’Église latine. On peut reprocher à l’auteur d’avoir manqué de réserve dans ces tableaux où l’âme, cherchant curieusement ses vices, satisfait encore sa vanité, « le plus intime de tous, » disait Villemain. Mais peut-on nier la sincérité, la contrition, la pressante ardeur et le souffle d’apôtre dont certaines pages sont animées ? Ah ! que nous sommes loin, en tout cas, de l’Apologétique de Chateaubriand ! Certes, René nous « tient suspendus à l’enchantement de son style magnifique, avec sa cambrure royale et sa phrase ondulante, empanachée, drapée, orageuse comme le vent des forêts vierges, colorée comme le cou des colibris, tendre comme les rayons de la lune à travers le trèfle des chapelles ; (6) » mais il faut bien dire, si louangeur qu’on puisse être de sa forme littéraire, que sa science théologique était vague, et que son imagination n’était point de nature à la préciser. Sans aller aussi loin que Maurras qui voit en lui un « protestant honteux vêtu de la pourpre de Rome, » et sans oser dire qu’il « a contribué presque autant que Lamennais, son compatriote, à notre anarchie religieuse, » on peut avancer qu’il n’eut que la foi implicite et que sa religion ne fut guère qu’une religiosité sentimentale.
Ce merveilleux écrivain sut opportunément mettre en œuvre et en valeur les idées qui flottaient dans l’air et qu’on retrouve chez ses contemporains. Le Génie du Christianisme, répondant aux inquiétudes d’une génération troublée, contribua à une renaissance catholique : c’est un fait acquis. Les églises se rouleraient et les lecteurs de Chateaubriand y entrèrent, mais y furent^ils retenus comme, un siècle après, les y retint l’auteur d’En Route par une dogmatique et une symbolique savantes et orthodoxes, par la compréhension des prières et la pratique des sacrements ? Affirmons que l’action de Huysmans, moins vaste et moins profonde que celle de Chateaubriand, est plus saine et plus efficace. Si l’un fut « un étonnant artiste dans le genre éclatant, » l’autre, avec moins de charme et d’éclat, est un remueur d’âmes et un apôtre, j’allais dire un missionnaire et un convertisseur.
La confirmation de ce que j’avance ainsi que la conclusion à tirer d’En Route et de la sincérité de son auteur, Coppée va nous les donner : « Lisez, dit-il, ce livre si émouvant et si pathétique, et si vous doutez encore, après cette lecture, de la conversion de l’auteur, c’est que vous êtes insensible à la large et sublime charité de l’Évangile, incapable d’admirer ce pénitent sincère qui, submergé par la fange de la luxure, se sauve du naufrage par un héroïque effort, ce malheureux qui, si longtemps gorgé d’impuretés, les vomit pour toujours ; c’est que vous méconnaissez l’infinie miséricorde qui pardonne avec joie à Thaïs et à Marie l’Égyptienne, et qui, de la prostituée d’hier, fait une sainte pour le paradis. La preuve est là pourtant. Depuis le jour où cet homme s’est jeté aux pieds du Dieu qui, depuis près de deux mille ans, du haut de sa croix, offre sa divine accolade au genre humain, sa vie, qui du reste auait toujours été soumise aux lois les plus strictes de l’honneur, devient celle d’un parfait chrétien. Il a été pur et bienfaisant. Il a prié avec ardeur. Dans ses derniers livres qui lui ont demandé douze ans de travail assidu, il a exalté, à sa manière assurément, et en évitant les banales formules, la gloire de Dieu et de l’Église, »
A qui me reprocherait de n’avoir rien caché du premier Huysmans, je répondrais : « Que ceux-là craignent de découvrir les défauts des âmes saintes, qui ne savent pas combien est puissant le bras de Dieu pour faire servir ces défauts, non seulement à sa gloire, mais encore à la perfection de ses élus. Pour nous, nous savons à quoi ont servi à saint Pierre ses renoncements, à saint Paul les persécutions qu’il a fait souffrir à l’Église, à saint Augustin ses erreurs. » (Bossuet.)
Il est temps d’aborder La Cathédrale, (7) Je dois dire que je ne puis me défendre d’admirer le savoir presque encyclopédique révélé dans cet ouvrage. On sait les importants travaux si bien résumés par M. Emile Mâle dans L’Art religieux du Xllle siècle en France. Ce sont, n’en déplaise aux archéologues privés du sixième sens, de tout autres notions et notations que nous trouvons ici sous la plume du converti, devenu définitivement un prédicateur de surnaturel, un apôtre de la prière liturgique et un érudit en toutes matières religieuses. Ce laïque a étudié, outre l’histoire de la littérature de l’Église, le style et le symbolisme de ses temples. Savant comme un moine savant, il parle avec la compétence d’un professeur émérite. Me direz-vous qu’il est parfois doctrinaire et systématique ? Pensez, vous répondrai-je, à ce que la création ou la défense d’un système suppose de connaissances acquises et sans cesse renouvelées !
La Cathédrale est un véritable trésor d’architecture chrétienne, une sorte de bible magnifiquement illustrée, qui constitue un guide éloquent et le plus précieux manuel. Chaque page est un résumé de recherches innombrables. Tours, façades, porches, verrières, voûtes, statues, bas-reliefs, toute l’anatomie de ces grands corps à l’âme divine est dévoilée, expliquée et décrite avec la plume originale que l’on sait.
Mais écoutons l’auteur lui-même. Après avoir déclaré à un correspondant (8) qu’il « était fort peu satisfait » de ce livre « mi-érudition, mi-art, » il ajoute : « Voulant compléter En Route où j’avais fait la mystique et le plain-chant, j’ai voulu refaire à propos de l’admirable cathédrale de Chartres toute la symbolique du moyen âge, la poursuivjant dans toutes ses branches : architecture, pierreries, couleurs, faune, flore, odeurs, objets servant au culte. Cela m’a donné un mal infini, car les renseignements n’existent guère sur cette science perdue depuis le treizième siècle. Et le résultat est une énumération plus ou moins aride, sans tremplin possible d’art. D’autre part, la cathédrale, sujet même du livre, a relégué fatalement Durtal au dernier plan — si bien que l’intérêt est assez médiocre. Enfin ! J’espère avoir peut-être réussi à faire aimer Notre-Dame de Chartres qui est, tout le long du livre, dans sa cathédrale, et s’il en est ainsi, cela me consolera de tant de mal et de tant d’efforts dépensés autrement, en pure perte. »
Je me serais borné à ce qui précède, si je ne retrouvais l’intéressante lettre de Huysmans au dit M. Prénat, qui avait publié un compte-rendu de La Cathédrale :
Cher Monsieur,
Merci de votre article du Mémorial. Il est excellent parce qu’il démêle très bien l’énigme un peu touffue du livre et montre très clairement, très nettement ce qu’il contient, et merci aussi de votre bienveillance et de la façon dont elle s’exprime.
La presse catholique est assez amusante à propos du livre. Elle flaire timidement, comme une chatte, avec des mouvements de recul. Le jeune Veuillot me fait assavoir dans l’Univers que l’écrivain qui ne pense pas comme tout le monde est un monstre d’orgueil. Le protestant Rod me fait observer, d’autre part, que c’est manquer à la charité de ne pas aimer la musique foraine de Chartres et l’œuvre de M. Tissot !
Ce que tous ces gens ont souci de mon âme ! La Vérité, plus perfide, reproduit un article de Chartres, signalant le livre à l’Index, pour avoir dit qu’il fallait montrer les vices pour en suggérer le dégoût et en inspirer l’horreur. Les bons apôtres !
Au fond, tout cela était attendu et il n’y a qu’à en rire. Merci encore, cher Monsieur, et bien cordialement à vous.
J.-K. HUYSMANS.
M. François Veuillot n’avait fait, en réalité, que des restrictions dans un article sympathique. La lettre ci-dessus exagère donc la critique de l’Univers ; mais nombre de journaux furent plus durs pour La Cathédrale que pour En Route ; il leur déplaisait sans doute de voir que la conversion « tenait. » Quant aux feuilles et aux revues catholiques, presque toutes furent élogieuses. On sait que le Correspondant avait publié le premier chapitre du livre. La Quinzaine, les Études Religieuses, la Revue Thomiste, le Journal par la plume de Coppée rendirent justice à l’œuvre artistique, archéologique et mystique. « C’est du Chateaubriand plus profond, plus intime et plus vrai, célébrant du Christianisme non plus le luxe d’apparat, mais la vertu totale. » (Quinzaine.) « Qui aurait jamais pensé que le naturalisme se transformerait un jour et qu’en la personne d’un de ses représentants les plus obstinés, il contribuerait à sa manière à renouveler l’apologétique ? »
Cette dernière citation est de l’abbé Mugnier à qui nous devons les Pages Catholiques. Elles s’ouvrent par une exacte et judicieuse préface suivie d’extraits d’En Route, de La Cathédrale et de deux reproductions pleines d’intérêt, attestant la place importante qu’occupe déjà Huysmans dans le monde catholique et notamment chez les amis de la liturgie. Ces deux appendices, la Préface de la i5e édition d’En Route et celle du Petit Catéchisme liturgique (9) complètent fort utilement l’édifiante anthologie.
C’est à dessein que j’emploie le mot « édifiante » qui ne plaisait guère à Huysmans. Voici ce qu’il écrivait dans la lettre inédite du 2 juin 1900, dont j’ai donné le commencement dans la première partie de cette étude :
Vous me demandez qui a fait les extraits des Pages Catholiques? — Moi. — C’est un seau d’eau versé dans un vin plus ou moins fort — voilà tout. En Route n’a pas été écrit pour des catholiques, mais bien pour des gens qui étaient sur la lisière comme je le fus. — Et si le livre a fait beaucoup de conversions, c’est justement parce qu’il n’avait pas d’allure cléricale dont ces gens se seraient défiés. J’en ai gardé les pages pouvant être mises entre les mains des jeunes filles ; peut-être feront-belles du bien ainsi. — J’ai cédé à des instances réitérées — sans joie. Ce sont des morceaux choisis, de la tisane pour les rhumes d’âme.
A propos des jeunes filles, Voici un passage de lettre inédite, où Huysmans parle avec sa netteté habituelle :
Le roman pour jeunes filles, cela me fait rêver parfois. Je crois que le plus grand service qu’on leur rendrait, serait de ne pas les faire rêver. Les Feuillet ont fait plus de mal, selon moi, que les Zola. L’inconnu de l’amour tel que le présentent les romans spiritualistes, est un tremplin de rêvasseries romanesques qui les fêle. J’ai vu cela. La gaze est un excitant. Elle cache le fruit défendu que l’on cherche et ça tourne à l’obsession qui n’existerait pas si l’on montrait les choses tout uniment.
C’est là une question délicate que nous n’avons pas à traiter. Retenons aux ouvrages de notre auteur.
Il avait publié à Paris, en 1897, La Sorcellerie en Poitou. — Gilles de Rais, brochure de 21 pages in-8. Il la réédita sous le titre : La Magie en Poitou ; Ligugé, 1899, avec 5 planches en phototypie, représentant des vues du château de Tiffauges. Vers le même temps parut Esquisse biographique sur Don Bosco. Paris, école typographique de Don Bosco ; in-12 allongé.
Sans nous attarder, arrivions à Sainte Lydwine de Schiedam, (10) la troisième des grandes œuvres apologétiques de Huysmans.
Une des meilleures études qu’on ait faites de l’auteur d’En Route est celle de M. Henri d’Hennezel, servant d’introduction aux Prières et Pensées Chrétiennes de J.-K Huysmans. (11) Après avoir rappelé le dogme de la Communion des Saints, le partage entre tous les membres de la grande famille catholique, des grâces, des mérites et des souffrances, l’immolation et l’expiation volontaires des innocents pour les coupables et l’héroïque holocauste de la « substitution mystique, » il présente ainsi sainte Lydwine : « Elle assuma la charge écrasante d’expier les maux de son époque, en ce XVe siècle où les guerres se déchaînaient sans trêve, où le schisme scindait la chrétienté et ou les grandes épidémies secouaient l’Europe d’un frisson d’horreur. Pendant plus de vingt-cinq ans, elle subit des tortures sans nom, vécut d’une oie incompréhensible, avec un corps qui n’était plus qu’ulcères et pourriture, toujours insatiable de maladies et demandant au Ciel de ne pas l’épargner, alors qu’elle défaillait sous la violence du supplice.
Ah ! le beau livre ! Je l’appellerais volontiers le livre des infirmes, tant il approfondit les causes de la souffrance imposée à l’homme par les desseins impénétrables d’En-Haut, tant il apporte aux malades de réconfort, en leur faisant accepter, dans un esprit de sacrifice, les misères qui sont la rançon de nos méfaits. »
Dans le monde religieux et lettré, l’effet du livre fut considérable. Je sais un supérieur de Congrégation qui, après la lecture de sainte Lydwine, demanda à Huysmans, comme à l’écrivain qui pouvait le mieux la faire connaître, une vie de sainte Colette de Corbie.
Il est temps d’arriver à L’Oblat, (12) composé à Ligugé, ou plutôt dans la bibliothèque de cette maison Notre-Dame qu’avait fait bâtir l’écrivain près du monastère des Bénédictins. Tout a été dit dans la presse et tout est raconté par l’auteur sur cette existence d’Oblat ou Tertiaire de Saint-Benoît, existence que de bons chrétiens, écrivains d’art eux aussi, avaient songé un moment à partager. Huysmans vécut là une vie toute de prière et de travail et que vint seule interrompre l’expulsion des religieux.
On sait en quels termes indignés et violents il parle de cette expulsion, et il est difficile d’oublier les personnages du livre, caractères si curieux et si tranchés, mais le lecteur y admire surtout la description des cérémonies liturgiques, de cette liturgie qui tint une si grande place dans la vie et les ouvrages de Huysmans, en lui révélant son âme religieuse, en lui changeant ses aspirations et en lui inspirant des prédications d’apôtre.
En fait, à la bien prendre, son œuvre de converti fut une apologie du Surnaturel, de cette greffe divine que le céleste jardinier, agricola Trinitas, dit saint Augustin, ente sur le sauvageon de la nature. Cette apologie était on ne peut plus opportune, à une époque où la négation de l’ordre surnaturel envahissait les différentes classes de la société.
L’auteur de L’Église et la Société chrétienne, M. Guizot, l’avait constaté : « Toutes les attaques dont le christianisme est aujourd’hui l’objet, quelque diverses qu’elles soient dans leur nature et dans leur mesure, partent d’un même point et tendent à un même but, la négation du Surnaturel dans les destinées de l’homme et du monde, l’abolition de l’élément surnaturel dans la religion chrétienne comme dans toute religion, dans son histoire comme dans ses dogmes.
Matérialistes, panthéistes, rationalistes sceptiques, critiques érudits,les uns hautement, les autres discrètement, tous pensent et parlent sous l’empire de cette idée que le monde et l’homme, la nature morale comme la nature physique, sont uniquement gouvernés par des lois générales, permanentes et nécessaires. dont aucune volonté spéciale n’est jamais venue et ne vient jamais suspendre ou modifier le cours. »
Je veux que Huysmans n’ait pas traité ex professo du Surnaturel ; il n’en a ni exposé la notion, ni prouvé la possibilité et l’existence : mais ses livres sur le symbolisme des églises où réside personnellement l’Homme-Dieu, sur les saints qui sont les temples vivants de la Grâce, sur cet ensemble de chants et d’actes au moyen desquels l’Église exprime et manifeste sa foi, sur les miracles, sur les maléfices du démon, ses livres, dis-je, supposent, remémorent et magnifient toutes les réalités surnaturelles.
Ainsi se trouve-t-il avoir contribué au renouveau de croyance qu’on sent germer dans la jeunesse. Continuateur, à sa manière, de celui dont le nom seul évoque la liturgie et les doctrines romaines et dont les livres emplissent et résument les bibliothèques catholiques, il fut un pénétrant admirateur de la liturgie. « Ses descriptions supposent plus que les efforts d’un virtuose ; on y sent l’âme d’un connaisseur qui comprend et qui aime... Les cantilènes sacrées apaisaient son pauvre cœur aigri, nourrissaient son esprit de grave doctrine et de visions pacifiantes. » (A. Dossat.)
Huysmans parla de la liturgie comme d’une « génitrice d’art » mais il en fit aussi comprendre la portée apologétique et la vertu sanctifiante. « Seule l’Église, dit-il, en dressant les reposoirs de l’année liturgique, en forçant les saisons à suivre pas à pas la vie du Christ, nous a fourni le moyen de marcher côte à côte avec Jésus, de vivre l’au jour le jour des Evangiles. »
Je n’en finirais pas si je citais tous les témoignages publics et privés, revues, journaux et lettres, où la salutaire influence de l’écrivain est copieusement affirmée, comme aussi, et depuis longtemps, sa sincérité mise hors de doute. Lisez seulement cette fin d’article où Emile de Saint-Auban, résumant le rôle et la manière du maître, grave cette eau-forte magistrale : « Huysmans a été l’apôtre naturaliste, comme Chateaubriand fut l’apôtre romantique. Là gît son originalité... Au naturalisme il ne reproche ni son vocabulaire, ni son esthétique, mais le choix de ses modèles, l’immondice de ses idées, sa fétidité morale, sa bassesse intellectuelle, cette nauséeuse obsession, ce rampement, ce cloportisme qui le confine dans les bas-fonds charnels... C’est bien toujours l’enquête réaliste avec l’implacable analyse servie par le constat brutal, le féroce inventaire, les minutes du document ; mais le sujet se modifie, le paysage se transforme, un nouvel horizon se découvre... Et la sensibilité de Huysmans fut sincère à sa façon comme, à sa façon, fut sincère la sensibilité de Chateaubriand, comme fut sincère la rudesse de Michel-Ange qui peint, au jour du Jugement, le petit nombre des élus, comme fut sincère le sourire de l’Angelico qui peint, au même jour, le petit nombre des damnés. Chacun voit le Christ avec les yeux d’un siècle, d’une société, d’une école. Et tous disent ce qu’ils ont vu avec la probité d’un art supérieur. Leurs formules se démodent, leurs procédés meurent : leur foi continue de vivre. »
Je puis me tromper, mais je crois que Huysmans est pour quelque chose dans les manifestations liturgiques, les congrès et les journées, comme dans les récentes adhésions à la Société Les Amis des Cathédrales, qui, cette année même, tenait une de ses séances religieuses, artistiques et archéologiques, précisément dans la cathédrale décrite par Huysmans, celle de Chartres.
Et serait-il étranger au regain de faveur dont jouissent les images religieuses, dignes et saines, et les bons livres d’église ? « On achète moins de recueils de prières, mais nous vendons plus de missels, » remarquait un libraire catholique. Pour le coup, voilà Huysmans d’accord avec le clergé ! « Chrétiens, dit un prélat, (13) lisons pieusement les saints évangiles ; ensuite prions avec la prière liturgique. Ces textes sacrés ou augustes opèrent par leur propre vertu.
« Et repoussons impitoyablement les livres d’Heures à la mode. Règle générale, ils manquent de poids, d’efficacité et même d’art, sauf celui qu’y introduisent d’aventure le typographe et le relieur. »
Serait-il enfin téméraire de voir l’influence de notre auteur dans telles et telles récentes conversions d’hommes de lettres ?
Il n’est pas rare de lire dans les journaux des réflexions dans le genre de celle-ci : Depuis que des esprits supérieurement intelligents, comme Brunetière, et extrêmement indépendants, comme Huysmans, sont revenus au catholicisme, un mouvement religieux s’est dessiné chez ceux qui pensent et étudient, chez les jeunes surtout.
Il nous reste à mentionner les derniers ouvrages, dont le plus important sont Les Foules de Lourdes. Avant L’Oblat avait paru De Tout, (14) volume de mélanges instructifs et savoureux, du pur Huysmans, et qui se termine par d’incisives colères et de justes invectives. Ayant vu chasser religieux et religieuses, filles de sainte Thérèse et fils de saint Benoit, il écrivait : « Les pages de De Tout ne sont plus exactes ; mais elles pourront, je l’espère du moins, servir à rappeler ce que furent les cloîtres de ces grands ordres, avant que la canaille des Loges eût pourri ce qui restait encore de sain, dans l’âme, si débile, hélas ! de ce honteux pays, »
Deux ans après L’Oblat, en 1905, fut publié Le Quartier Notre-Dame, (15) ouvrage de plus en plus recherché par les amis de l’histoire et des aspects du vieux Paris.
La même année, l’éditeur Messein fit paraître Trois Primitifs, (16) « volume sans grand intérêt, » écrivait Huysmans : mais on aurait tort de le prendre au mot. Dans cette même lettre où il y a si peu de vanité, suivent ces lignes :
Je tourne vaguement autour d’un livre sur Lourdes où j’ai vécu longuement, l’an dernier, mais c’est si embrouillé et surtout à tous les points de vue, si obscur, que je ne sais pas encore si je me déciderai à écrire le volume.
La lettre est datée du 7 janvier 1905. Dix-huit mois après, paraissaient Les Foules de Lourdes (17) dont vingt mille exemplaires furent enlevés en quelques semaines. Le 4 novembre, Huysmans écrivait :
...La presse donne, exaspérée du côté médical et mécréant. Ils injurient mais nul ne réfute les arguments de mon chapitre de la fin ; c’est plus commode et plus simple. Quant aux catholiques, ils sont entre le zist et le zest — obligés de convenir que ce livre est une très énergique défense de la Vierge et des miracles, mais effarés par son trop de franchise...»
J’ai fait, au cours de ce livre, trop d’emprunts à la critique pour ne pas me borner sur les témoignages concordants de la presse religieuse et indépendante. Rarement un ouvrage fut salué de tant et de si justifiés éloges.
Lourdes, qui avait eu son héraut en Lasserre, son détracteur en Zola, eut son défenseur et son vengeur en Huysmans. Il vient de nous avouer, le franc-parleur, que d’abord il n’y voyait pas très clair. Un autre jour, dans une interview : « Lourdes, disait-il, c’est l’hôpital Saint-Antoine et la foire de Neuilly. » Cependant qu’il élaborait son œuvre, et en venait, à force de travail, d’observation aiguë et incessante, à force de prière aussi et de grâce, à composer un livre qui est, en définitive, un éclatant acte de foi au surnaturel, une longue et très douce prière à la Vierge. On estime avec raison délicieusement vraies et simples les pages sur Bernadette, et merveilleuse l’ascension du poème des cierges jusqu’aux plus hautes extases du symbolisme chrétien. C’est « le plus vivant des Mois de Marie, » écrivait M. Henri Brémond. Des ecclésiastiques, pèlerins de Lourdes, en font leur vade mecum, et j’en sais qui ont régalé en chemin de cet élixir leurs voisins et voisines. Les plus prévenus ne résistent point à sa piquante saveur. Je dis les plus prévenus, certains critiques ayant, on le sait trop, créé des préventions contre le livre et son auteur. Un abbé ne crut-il faire œuvre pie en défigurant une toile de maître ? C’est, heureusement, d’un autre esprit et d’une autre langue qu’un prêtre mieux inspiré (18) a parlé de Huysmans et de sa dernière œuvre :
« Béni soit le ciel d’avoir voulu consoler de Zola les amis de Massabielle en leur donnant Huysmans ! Le moyen de ne pas saluer avec une reconnaissance émue cette figure de virtuose de l’Art, que la sincérité mit sur le chemin de l’apologétique et qui, avant de « souffrir » si terriblement son œuvre de mysticité chrétienne, voulut la synthétiser d’une façon magistrale autant que courageuse dans ses Foules de Lourdes ?
« De lui aussi ce sensationnel volume devait être le dernier ; comme si, dès qu’il s’agit de la Madone, après Elle, dans le dithyrambe aussi bien que dans le blasphème, il n’y doit plus rien avoir ! Le culte de Marie consomme tout bien sur la terre, de même, hélas ! que la haine de Marie est déjà dès ce monde un sceau d’éternelle réprobation.
« Quoi qu’on ait pu dire de certains détails secondaires dont je ne prétends pas louer, certes , absolument l’a propos, mais qui peuvent sembler assez naturels au génie de l’auteur, comment nier que l’ouvrage en question aura été, à son heure, mieux qu’un beau livre, un bon livre, tel qu’il le fallait alors au boulevard, pour lequel surtout on l’avait écrit et vécu ?
« N’est-ce pas qu’après un pareil travail le littérateur eut bien raison de brûler tout ce qui lui restait d’ébauches profanes, à l’instar de ces vieux trouvères moyen-âgeux, ses frères, qui, las de liesses et de violences, pris de repentir, avant de trépasser, se mettaient, dit-on, à chanter les laudes de Madame Sainte Marie et ne voulaient plus rien savoir d’ici-bas. »
Tenons-nous-en à ce parfait témoignage.
En terminant sa belle introduction aux Prières et Pensées chrétiennes, M. Henri d’Hennezel écrit : « Huysmans ne se compare ni à Louis Veuillot qui fut un merveilleux ouvrier de lettres, mais auquel manqua, dans une certaine mesure, le sens artistique ; ni à Barbey d’Aurevilly, dont la verve tapageuse faisait trembler le panache qu’il portait à son heaume de croisé ; ni à ceux-là, ni à personne. Il est à part. Il a su écrire comme un artiste ; il a su prier comme un moine, alliant dans une harmonie quelquefois rude, mais toujours savoureuse, la langue du naturaliste impénitent qu’il était, aux effusions candides et enthousiastes du grand croyant qu’il devint. »
Avouerai-je toutefois qu’au cours de cette étude je rapprochais souvent Huysmans de Louis Veuillot ?
Ayant sous la main le recueil d’Hommages, paru en 1884, année qui suivit la mort du célèbre polémiste, et contenant les éloges des amis comme les critiques des adversaires, je trouvais, en le parcourant, plus d’un point de ressemblance entre les deux maîtres.
Dans des milieux différents, l’un dans les luttes violentes et mesquines de la presse, l’autre dans de calmes et sévères travaux poursuivis à l’ombre des cloîtres, après avoir chacun aiguisé et trempé leur plume comme on aiguise et trempe une épée, ils en ont fait sentir la pointe aux mécréants. Veuillot s’attarda moins longtemps dans l’incrédulité que Huysmans dans sa « coque impure, » mais c’est avec une égale ardeur qu’aussitôt libérés ils soutiennent leurs idées et leurs convictions. L’un marqua vite sa place au premier rang des défenseurs de la foi. Il prit part — et quelle part ! — à des campagnes retentissantés, écrivit ces Libres Penseurs et ces Odeurs de Paris que l’auteur du Drageoir à épices dut goûter mieux que personne. Celui- ci, dans une moindre sphère d’action, en vint pourtant à pouvoir penser comme parlait son grand aîné : Je suis quelqu’un du peuple chrétien.
Veuillot, de qui Monselet disait qu’il eut pour lui le pape et la grammaire, fut l’une des incarnations de la première renaissance catholique et l’un des plus parfaits prosateurs de son temps ; Huysmans ne posséda pas au même degré cette double gloire, mais lui aussi fut un bon ouvrier de l’Eglise.
Les traïvaux qui suivent En Route lui sont dictés par son goût pour l’art chrétien, son amour de l’architecture, de la liturgie et du plain-chant, par son attrait pour les exceptionnelles iconographies, pour les vies mystiques gratifiées dès ce monde de visions et d’auditions célestes : mais n’est-ce pas intentionnellement qu’il se met à instruire et à morigéner ses contemporains, laïcs et clercs ? Ne croit-il pas faire œuvre opportune et sacrée, en enseignant au troupeau bêlant des dilettantes superficiels, qu’il y a dans les cathédrales de sublimes et immortels symboles, que les cérémonies et les hymnes ont une divine signification, et que les prodiges de la vie des saints sont autre chose que de la suggestion et de la pathologie ?
Huysmans a raconté, l’on sait comme, sa conversion. Veuillot avait dit comment la miséricorde le prit et comment la bonté maternelle de Dieu triompha des résistances que l’âge et la folie apportaient à la grâce. Les deux récits ont ramené à Dieu des impies, raffermi des convictions branlantes, orienté vers la foi d’innombrables jeunes gens. Quant à leurs autres ouvrages, il est avéré qu’ils ont propagé, parmi les incrédules et les indifférents, l’intelligence et le respect des anciennes pratiques de la religion. Pour des raisons et des considérations différentes, leurs œuvres ont été l’objet de bien des contestations, mais parce que chacun d’eux fut convaincu, loyal et désintéressé, le temps a vite allégé le poids des récriminations, versé l’oubli sur les violences et guéri les blessures.
Assurément l’un tint dans le monde catholique une place autrement importante que l’autre, et la correspondance du célibataire pessimiste ne se peut en rien comparer au charme exquis des admirables lettres du père de famille, de l’ami et du publiciste. Veuillot a « immortalisé des pages écrites en une heure sur des feuilles d’un jour, (19) » sa langue était franche, alerte, ferme, vivante et radieuse ; celle de Huysmans, touffue et dense, faite d’érudition entassée, sans tours heureux et sans finesse : mais une commune passion rapproche ces robustes esprits, celle du constant effort pour arriver l’un à bien dire, l’autre à bien décrire. (20) Dans l’armée des lettres ils furent des connétables.
M. Eugène Veuillot, relatant les derniers jours de son frère : « Jamais chrétien, dit-il, se sentant frappé, ne dit d’un esprit plus convaincu, d’un cœur plus soumis : Que la volonté de Dieu soit faite et soit bénie ! On a vu que la fin cruelle de Huysmans n’a été ni moins courageuse ni moins saintement résignée,
« Veuillot, écrit M. Lecigne, pratiqua sa religion effrontément, trouvant à la liturgie et à toutes les fêtes de l’Église une joie débordante. » Cette dernière touche ne convient-elle point au portrait de Huysmans ?
Non, l’auteur d’En Route ne périra pas, car son ouvre forte et hautement chrétienne est burinée de main d’ouvrier. Les aspérités et les impertinences pourront en éloigner un temps les timorés et les sensitifs ; qui aime les bon-bons et les vins sucrés écartera ce verjus : mais — pour parler sans figures — les ouvrages du maître seront finalement prisés à leur valeur, comme ils le furent de l’élite intellectuelle et des deux grands corps religieux et littéraires, les Bénédictins et la Compagnie de Jésus.
N’ayant ni accompli le même labeur, ni acquis les mêmes titres, Huysmans n’eût pas osé dire comme Veuillot : « Si l’œuvre que j’ai faite est bonne, il suffira que je n’y sois plus, on le verra bien, » On l’a vu pour le verveux athlète, on le voit pour le styliste prestigieux, ardemment dévoués l’un et l’autre à la cause du Vrai, du Bien et du Beau, à ce triple idéal qui est, en fin de compte, l’éternel souci de l’Église.
Ces pages, écrites sans parti pris de condamner ou d’absoudre, donneront-elles de l’homme, de l’écrivain et de l’apologiste l’idée que je m’en suis formée ?
Huysmans, ayant déconcerté croyants et incroyants, et, je l’ai dit, irrité les archéologues, amoncela sur son nom de violentes antipathies. C’est qu’on n’est pas soi-même impunément. Les uns, le répéterai-je ? vexés de sa conversion, n’en parlent encore aujourd’hui que comme d’une attitude ou d’un cas pathologique ; les autres, toujours scandalisés qu’il n’ait pas changé de style en changeant de vie, et subodorant dans sa prose un relent des vieux vices, lui tiennent rigueur, comme s’il n’avait pas, quinze ans durant, arboré de la plus vaillante main le drapeau de la Foi... Mais n’est-ce point le sort des libres diseurs de vérités, de ces « virtuoses de la croyance, » comme les nommait un publiciste distingué ? (21)
Il entendait par là « le petit groupe de croyants qui, tout en se targuant d’une orthodoxie rigoureuse sur les principes, voient surtout dans la religion catholique la source de toute poésie, de toute élégance, de toute noble audace, chacun selon ses aptitudes d’esprit, ou les besoins d’expansion de son tempérament. Ils vivent ordinairement à l’écart, également tenus en méfiance par les croyants graves qui leur trouvent trop de fantaisie et par les incrédules qui redoutent les surprises du merveilleux. Ils n’en sont pas moins très utiles, car, si on les suit rarement, du moins on les regarde ou on les écoute, et c’est quelque chose aujourd’hui que de se faire écouter ou seulement regarder, rien qu’en s’affirmant catholique, par la foule distraite, encore plus lasse que sceptique. Cette foule devine en eux, avant tout, des ennemis de l’ennui en matière religieuse, et c’est beaucoup que de rappeler à un peuple tout d’esprit, comme les Français, que le catholicisme est la plus brillante des religions. »
M. Racot en venait aussi à remarquer que l’Eglise, dans son jugement solide, se défie des dilettantes de la foi, et il relevait que Barbey d’Aurevilly n’avait guère rencontré pour l’intéresser à ses œuvres catholiques indépendantes que Mgr Berthaud, évêque de Tulle, qui voyait dans l’auteur de L’Ensorcelée un « théologien naturel ».
Huysmans a traité des sujets religieux de la plus grande importance. Il a abordé et fouillé, avec quelle conscience minutieuse ! les idées et les sciences les plus nobles, la théologie et l’art chrétien, les plus sublimes et les plus salutaires des connaissances. Il fut donc plus et mieux qu’un dilettante. Nous l’avons vu, comme l’a bien dit M. Lionnet, (22) sortir de la tour d’ivoire où l’on pouvait craindre qu’il se confinât. Parce qu’il n’a aimé ni les rengaines, ni les admirations convenues, qu’on ne dise donc plus qu’il a « galuaudé les choses saintes. » N’est-ce pas son amour de la religion, lui faisant désirer que tout ce qui se rapportait au culte fût pur et beau, qui l’a rendu plus sensible que d’autres, moins culti\3és et moins difficiles, aux errements de la routine et aux abus du mercantilisme ? Qu’on ne blâme point une honnête franchise et qu’on apprécie, comme ils le méritent, « les patients trav>aux de bénédictin du savant père J.-K. Huysmans. » (Rachilde.)
On a parlé de « cette image définitive qui se forme peu à peu autour des disparus et dont les traits adoucis rappellent les effigies à demi effacées sur lesquelles se penche la curiosité des numismates. »
L’image définitive de Huysmans ne serait-elle pas dans ce jugement anonyme, noté au cours de mes lectures, et par lequel je termine :
Écrivain célèbre dont les livres, par leur grand talent et leur admirable sincérité, bouleversent, pour les ramener à Dieu, les incrédules qui le cherchent avec droiture ?
Notes
(1) J. Roger Charbonnel : La philosophie de Lamartine.
(2) Francis de Miomandre : Visages.
(3) Mercure de France, 1er juin 1907.
(4) Les Débuts de Léon Bloy, par René Martineau.
(5) En Route. Paris, Tresse et Stock, 1895, in-12.
(6) Flaubert.
(7) La Cathédrale. Paris, Stock, 1898, in-12. — La Cathédrale. Soixante-quatre eaux-fortes originales de Ch. Jouas. Paris, A. Blaizot, 1909.
(8) M. Auguste Prénat. Lettre du 28 mai 1897.
(9) Par Henri Dutilliet.
(10) Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, Stock, 1901. in-8 carré. Édition première, imprimée à Hambourg, en rouge et noir, avec les caractères gothiques dessinés par le graveur impérial Georges Schiller, et fondus spécialement pour l’ouvrage. — L’édition in-12 parut en même temps.
(11) Lyon, H. Lardanchet, 1910.
(12) L’Oblat. Paris, Stock, 1903, in-18.
(13) Mgr Guignot.
(14) De Tout. Paris, Stock, 1902.
(15) Le Quartier Notre-Dame. Illustrations et gravures de Ch. Jouas, petit in-8 ; Paris, Librairie de la Collection des Dix.
(16) Trois Primitifs. Paris, Messein, 1905 ; in-8 carré. En 1908, la librairie Pion réédita cet ouvrage en le faisant précéder de trois études d’églises : La Symbolique de Notre-Dame, Saint-Germain l’Auxerrois, Saint-Merry.
(17) Les Foules de Lourdes. Paris, Stock, 1906 ; in-12.
(18) M. le chanoine Rousseil : Les Splendeurs de Lourdes.
(19) J, d’Anglejan : Revue critique des idées et des livres.
(20) Sait-on que dans les dix premiers membres de sa future Académie, Edmond de Goncourt avait inscrit Louis Veuillot ?
(21) Adolphe Racot : Portraits d’aujourdhui ; 1887.
(22) L’Évolution des idées chez quelques-uns de nos contemporains : Ier série. Paris, Perrin.