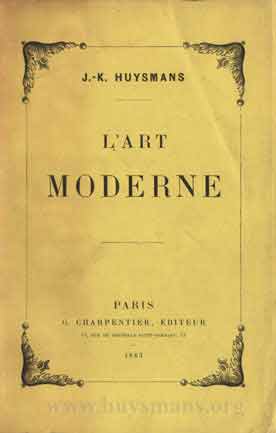L’EXPOSITION DES INDEPENDANTS EN 1881
M. Degas s’est montré singulièrement chiche. Il s’est contenté d’exposer une vue de coulisses, un monsieur serrant de près une femme lui étreignant presque les jambes entre ses cuisses, derrière un portant illuminé par le rouge brasier de la salle qu’on entrevoit et quelques dessins et esquisses représentant des chanteuses en scène tendant des pattes qui remuent comme celles des magots abrutis de Saxe et bénissant les têtes des musiciens au-dessus desquelles émerge, au premier plan, comme un cinq énorme, le manche d’un violoncelle, ou bien se déhanchant et beuglant dans ces ineptes convulsions qui ont procuré une quasi célébrité à cette poupée épileptique, la Bécat.
Ajoutez encore deux ébauches : des physionomies de criminels, des mufles animaux, avec des fronts bas, des maxillaires en saillie, des mentons courts, des yeux écillés et fuyants et une très étonnante femme nue, au bout d’une chambre, et vous aurez la liste des oeuvres dessinées ou peintes, apportées par cet artiste.
Dans ses plus insouciants croquis, comme dans ses oeuvres achevées, la personnalité de M. Degas sourd ; ce dessin bref et nerveux, saisissant comme celui des Japonais, le vol d’un mouvement, la prise d’une attitude, n’appartient qu’à lui ; mais la curiosité de son exposition n’est pas, cette année, dans son oeuvre dessinée ou peinte, qui n’ajoute rien à celle qu’il exhiba en 1880 et dont j’ai rendu compte ; elle est toute entière dans une statue de cire intitulée Petite Danseuse de quatorze ans devant laquelle le public, très ahuri et comme gêné, se sauve.
La terrible réalité de cette statuette lui produit un évident malaise ; toutes ses idées sur la sculpture, sur ces froides blancheurs inanimées, sur ces mémorables poncifs recopiés depuis des siècles, se bouleversent. Le fait est que, du premier coup, M. Degas a culbuté les traditions de la sculpture comme il a depuis longtemps secoué les conventions de la peinture.
Tout en reprenant la méthode des vieux maîtres espagnols, M. Degas l’a immédiatement faite toute particulière, toute moderne, par l’originalité de son talent.
De même que certaines madones maquillées et vêtues de robes, de même que ce Christ de la cathédrale de Burgos dont les cheveux sont de vrais cheveux, les épines de vraies épines, la draperie une véritable étoffe, la danseuse de M. Degas a de vraies jupes, de vrais rubans, un vrai corsage, de vrais cheveux.
La tête peinte, un peu renversée, le menton en l’air, entr’ouvrant la bouche dans la face maladive et bise, tirée et vieille avant l’âge, les mains ramenées derrière le dos et jointes, la gorge plate moulée par un blanc corsage dont l’étoffe est pétrie de cire, les jambes en place pour la lutte, d’admirables jambes rompues aux exercices, nerveuses et tordues, surmontées comme d’un pavillon par la mousseline des jupes, le cou raide, cerclé d’un ruban porreau, les cheveux retombant sur l’épaule et arborant, dans le chignon orné d’un ruban pareil à celui du cou, de réels crins, telle est cette danseuse qui s’anime sous le regard et semble prête à quitter son socle.
Tout à la fois raffinée et barbare avec son industrieux costume, et ses chairs colorées qui palpitent, sillonnées par le travail des muscles, cette statuette est la seule tentative vraiment moderne que je connaisse, dans la sculpture.
Je laisse, bien entendu, de côté les essais déjà osés des paysannes tendant à boire ou apprenant à lire à des enfants, des paysannes renaissance ou grec, attifées par un Draner quelconque ; je néglige également, cette abominable sculpture de l’Italie contemporaine, ces dessus de pendules en stéarine, ces femmes mièvres, érigées d’après des dessins de gravure de modes, et je rappelle simplement une tentative de M. Chatrousse. Ce fut en 1877, je crois, que cet artiste essaya de plier le marbre aux exigences du modernisme ; l’effort rata ; cette froide matière propre au nu symbolique, aux rigides tubulures des vieux peplums, congela les pimpantes coquetteries de la parisienne. Bien que M. Chatrousse ne fût pas un esprit subalterne, le sens du moderne et le talent nécessaire lui manquaient, cela est sûr, mais il s’était aussi trompé en faisant choix de cette matière monochrome et glacée, incapable de rendre les élégances des vêtements de nos jours, les mollesses du corps raffermies par les buscs, le gingembre des traits avivés par un rien de fard, le ton mutin que prennent des physionomies de Parisiennes avec des cheveux à la chien pleuvant sous ces petites toques qu’allume tout d’un côté une aile de lophophore.
Reprenant, après M. Henry Cros qui s’en sert pour transporter dans la sculpture les figurines peintes dans les vieux missels(1) et, après M. Ringel dont l’oeuvre n’est d’aucune époque, le procédé de la cire peinte, M. Degas a découvert l’une des seules formules qui puissent convenir à la sculpture de nos jours.
Je ne vois pas, en effet, quelle voie suivra cet art s’il ne rejette résolument l’étude de l’antique et l’emploi du marbre, de la pierre ou du bronze. Une chance de sortir des sentiers battus lui a été jadis offerte par M. Cordier, avec ses oeuvres polychromes. Cette invite a été repoussée. Depuis des milliers d’ans, les sculpteurs ont négligé le bois qui s’adapterait merveilleusement, selon moi, à un art vivant et réel; les sculptures peintes du moyen âge, les retables de la cathédrale d’Amiens et du musée de Hall, par exemple, le prouvent, et les statues qui se dressent à Sainte-Gudule et dans la plupart des églises belges, des figures grandeur nature de Verbruggen d’Anvers et des autres vieux sculpteurs des Flandres, sont plus affirmatives encore, s’il est possible.
Il y a, dans ces oeuvres si réalistes, si humaines, un jeu de traits, une vie de corps qui n’ont jamais été retrouvés par la sculpture. Puis, voyez comme le bois est malléable et souple, docile et presque onctueux sous la volonté de ces maîtres ; voyez comme est, et légère et précise, l’étoffe des costumes taillée en plein chêne, comme elle s’attache à la personne qui la porte, comme elle suit ses attitudes, comme elle aide à exprimer ses fonctions et son caractère.
Eh bien, transférez ce procédé, cette matière, à Paris, maintenant mettez-les entre les mains d’un artiste qui sente le moderne comme M. Degas, et la Parisienne dont la très spéciale beauté est faite d’un mélange pondéré de naturel et d’artifice, de la fonte en un seul tout des charmes de son corps et des grâces de sa toilette, la Parisienne avortée de M. Chatrousse viendra à terme.
Mais aujourd’hui le bois n’est plus sculpté que par les ornemanistes et les marchands de meubles; c’est un art auquel il faut souhaiter que l’on revienne de préférence même à celui de la cire si expressive et si obéissante, mais si indurable et si fragile, un art qui devra combiner les éléments de la peinture et de la sculpture; car, en dépit de ses tons vivants et chauds, le bois à l’état de nature demeurerait trop incomplet et trop restreint, puisque les traits d’une physionomie s’atténuent ou se fortifient, selon la couleur des parures qui les assistent, puisque ce je sais quoi qui fait le caractère d’une figure de femme, est, en grande partie, donné par le ton de la toilette dont elle est vêtue. Forcément, cette conclusion se pose : ou bien l’inéluctable nécessité d’employer certaines matières de préférence à d’autres et le despotique besoin d’allier deux arts, reconnu dès l’antiquité puisque les Grecs mêmes avaient adopté la sculpture peinte, seront compris et reconnus par les artistes actuels qui pourront alors aborder les scènes de la vie moderne, ou bien, usée et flétrie, la sculpture ira, s’ankylosant, d’année en année, davantage et finira par tomber, à jamais paralysée et radoteuse.
Pour en revenir à la danseuse de M. Degas, je doute fort qu’elle obtienne le plus léger succès; pas plus que sa peinture dont l’exquisité est inintelligible pour le public, sa sculpture si originale, si téméraire, ne sera même pas soupçonnée; je crois savoir, du reste, que, par excès de modestie ou d’orgueil, M. Degas professe un hautain mépris pour le succès; eh bien, j’ai grand peur qu’il n’ait, une fois de plus, à propos de son oeuvre, l’occasion de ne pas s’insurger contre le goût des foules.
J’écrivais, l’an dernier, que la plupart des toiles de Mlle Cassatt rappelaient les pastels de M. Degas, et que l’une d’elles découlait des maîtres anglais modernes.
De ces deux influences est sortie une artiste qui ne doit plus rien à personne maintenant, une artiste toute prime-sautière, toute personnelle.
Son exposition se compose de portraits d’enfants, d’intérieurs, de jardins, et c’est un miracle comme dans ces sujets chéris des peintres anglais, Mlle Cassatt a su échapper au sentimentalisme sur lequel la plupart d’entre eux ont buté, dans toutes leurs oeuvres écrites ou peintes.
Ah ! les bébés, mon Dieu ! Que leurs portraits m’ont mainte fois horripilé ! — Toute une séquelle de barbouilleurs anglais et français les ont peints dans de si stupides et si prétentieuses poses ! — On en arrivait à tolérer l’Henri IV chevauché par des gosses, tant les modernes enchérissaient encore sur la sottise des peintres morts. Pour la première fois, j’ai, grâce à Mlle Cassatt, vu des effigies de ravissants mioches, des scènes tranquilles et bourgeoises peintes avec une sorte de tendresse délicate, toute charmante. Au reste, il faut bien le répéter, seule, la femme est apte à peindre l’enfance. Il y a là un sentiment particulier qu’un homme ne saurait rendre ; à moins qu’ils ne soient singulièrement sensitifs et nerveux, ses doigts sont trop gros pour ne pas laisser de maladroites et brutales empreintes ; seule la femme peut poser l’enfant, l’habiller, mettre les épingles sans se piquer ; malheureusement elle tourne alors à l’afféterie ou à la larme, comme Mlle Elisa Koch en France et Mme Ward en Angleterre ; mais Mlle Cassatt n’est, Dieu merci, ni l’une ni l’autre de ces peinturleuses, et la salle où sont pendues ses toiles contient une mère lisant, entourée de galopins et une autre mère embrassant sur les joues son bébé, qui sont d’irréprochables perles au doux orient ; c’est la vie de famille peinte avec distinction, avec amour ; l’on songe involontairement à ces discrets intérieurs de Dickens, à ces Esther Summerson, à ces Florence Dombey, à ces Agnès Copperfield, à ces petites Dorrit, à ces Ruth Pinch, qui bercent si volontiers des enfants sur leurs genoux, pendant que, dans la chambre apaisée, la bouilloire de cuivre bourdonne, et que la lumière rabattue sur la table anime la théière et les tasses et coupe, en deux, l’assiette plus éloignée où des tartines beurrées s’étagent. Il y a dans cette série des oeuvres de Mlle Cassatt une affective compréhension de la vie placide, une pénétrante sensation d’intimité, telles qu’il faut remonter, pour en trouver d’égales, au tableau d’Everett Millais, les Trois Soeurs, exposé en 1878, dans la section Anglaise.
Deux autres tableaux, — l’un appelé le Jardin où, au premier plan, une femme lit tandis qu’en biais, derrière elle, de verts massifs piqués d’étoiles rouges par des géraniums et bordés de pourpre sombre par des orties de Chine, montent jusqu’à la maison, dont le bas ferme la toile; — et l’autre intitulé le Thé, où une dame, vêtue de rose, sourit, dans un fauteuil, tenant de ses mains gantées, une petite tasse, — ajoutent encore à cette note tendre et recueillie une fine odeur d’élégances parisiennes.
Et c’est là une marque inhérente spéciale à son talent, Mlle Cassatt qui est Américaine, je crois, nous peint des Françaises ; mais dans ses habitations si parisiennes, elle met le bienveillant sourire du at home ; elle dégage, à Paris, ce qu’aucun de nos peintres ne saurait exprimer, la joyeuse quiétude, la bonhomie tranquille d’un intérieur.
Nous voici arrivés devant les Pissarro. C’est aussi une révélation que l’exposition de cet artiste.
Après avoir longuement tâtonné, jetant par hasard une toile comme son Paysage d’été de l’année dernière, M. Pissarro s’est subitement délivré de ses méprises, de ses entraves et il a apporté deux paysages qui sont l’oeuvre d’un grand peintre : le premier, le Soleil couchant sur la plaine du chou, un paysage où un ciel floconneux fuit à l’infini, battu par des cimes d’arbres, où coule une rivière près de laquelle fument des fabriques et montent des chemins à travers bois, c’est le paysage d’un puissant coloriste qui a enfin étreint et réduit les terribles difficultés du grand jour et du plein air. C’est la nouvelle formule cherchée depuis si longtemps et réalisée en plein ; la vraie campagne est enfin sortie de ces assemblages de couleurs chimiques et c’est, dans cette nature baignée d’air, un grand calme, une sereine plénitude descendant avec le soleil, une enveloppante paix s’élevant de ce site robuste dont les tons éclatants se muent sous un vaste firmament, aux nuages sans menaces. Le second, la Sente du chou, en mars, est d’une allure éloquente et joyeuse, avec ses plans de légumes, ses arbres fruitiers aux branches tordues, son village éventé, au fond, par des peupliers. Le soleil pleut sur les maisonnettes qui enlèvent le rouge de leurs toits dans le vert fouillis des arbres ; il y a là une terre grasse que le printemps travaille, une solide terre où poussent furieusement les plantes; c’est un alléluia de nature qui ressuscite, et dont la sève bout ; une exubérance de campagne, éparpillant ses tons violents, sonnant d’éclatantes fanfares de verts clairs soutenues par le vert bleu des choux, et tout cela frissonne dans une poudre de soleil, dans une vibration d’air, uniques jusqu’à ce jour, dans la peinture; puis quelle curiosité dans le procédé, quelle exécution neuve, différente de celle de tous les paysagistes connus, quelle originalité sortie des efforts combinés des premiers lutteurs de l’impressionnisme, de Piette, de Claude Monet, de Sisley, de Paul Cézanne enfin, ce courageux artiste qui aura été l’un des promoteurs de cette formule ! De près, la Sente du chou est une maçonnerie, un tapotage rugueux bizarre, un salmis de tons de toutes sortes couvrant la toile de lilas, de jaune de Naples, de garance et de vert ; à distance, c’est de l’air qui circule, c’est du ciel qui s’illimite, c’est de la nature qui pantelle, de l’eau qui se volatilise, du soleil qui irradie, de la terre qui fermente et fume !
L’exposition de M. Pissarro est considérable cette année. Çà et là, quelques toiles témoignent encore de l’art du merveilleux coloriste qu’est ce peintre. D’autres hésitent ; l’éclosion n’est pas venue pour elles; d’autres encore balbutient complètement, entre autres un pastel du boulevard Rochechouart où l’oeil de l’artiste n’a plus saisi les dégradations et les nuances, et s’est borné à mettre brutalement en pratique la théorie que la lumière est jaune et l’ombre violette, ce qui fait que tout le boulevard est absolument noyé dans ces deux teintes ; enfin des gouaches représentant des paysans complètent cette série, mais elles sont moins personnelles; la figure humaine, dans l’oeuvre de M. Pissarro, prend le geste et l’allure des Millet ; quelques-unes aussi telles que la Moisson, rappellent comme exécution les panneaux gouachés de Ludovic Piette.
En somme, M. Pissarro peut être classé maintenant au nombre des remarquables et audacieux peintres que nous possédions. S’il peut conserver cet oeil si perceptif, si agile, si fin, nous aurons certainement en lui le plus original des paysagistes de notre époque.
M. Guillaumin est, lui aussi, un coloriste et, qui plus est, un coloriste féroce ; au premier abord, ses toiles sont un margouillis de tons bataillants et de contours frustes, un amas de zébrures de vermillon et de bleu de Prusse ; écartez-vous et clignez de l’oeil, le tout se remet en place, les plans s’assurent, les tons hurlants s’apaisent, les couleurs hostiles se concilient et l’on reste étonné de la délicatesse imprévue que prennent certaines parties de ces toiles. Son Quai de la Râpée est surtout surprenant, à ce point de vue.
Le jour où l’oeil exaspéré de ce peintre se sera assagi, nous serons en face d’un paysagiste, d’un paysagiste fortunyste, si l’on peut dire ; c’est-à-dire d’un voyant de la couleur dont l’impression ne montera pas dans la cervelle, mais se localisera dans la rétine. Il n’y aura ni mélancolie, ni gaieté, ni sérénité, ni tourmente de nature, dans ses paysages, mais seulement l’impression de la tache vive des corps dans la pleine lumière, dans le plein jour.
J’ai tout lieu de croire que cet aplomb visuel qui manque à M. Guillaumin lui arrivera, car ses oeuvres, qui n’étaient jusqu’alors que d’incompréhensibles bariolis de tons aigres de tons aigres, commencent déjà à se débrouiller. Il ne s’en faut peut-être plus de beaucoup maintenant que, lui aussi, ne parvienne à la réalisation de ses efforts.
L’an dernier, M. Gauguin a exposé, pour la première fois ; c’était une série de paysages, une dilution des oeuvres encore incertaines de Pissarro; cette année M. Gauguin se présente avec une toile bien à lui, une toile qui révèle un incontestable tempérament de peintre moderne.
Elle porte ce titre : Étude de nu; c’est, au premier plan, une femme, vue de profil, assise sur un divan, en train de raccommoder sa chemise ; derrière elle, le parquet fuit, tendu d’un tapis violacé jusqu’au dernier plan qu’arrête le pan entrevu d’un rideau d’algérienne.
Je ne crains pas d’affirmer que parmi les peintres contemporains qui ont travaillé le nu, aucun n’a encore donné une note aussi véhémente, dans le réel; et je n’excepte pas de ces peintres Courbet, dont la Femme au perroquet est aussi peu vraie, comme ordonnance et comme chair, que la Femme couchée de Lefebvre ou la Vénus à la crème de Cabanel. Le Courbet est durement peint avec un couteau du temps de Louis-Philippe, tandis que les charnures des autres plus modernes vacillent comme des plats entamés de tôt-faits ; c’est, au demeurant, la seule différence qui existe entre ces peintures, Courbet n’aurait pas placé, au pied du lit, une moderne crinoline, que sa femme aurait fort bien pu prendre la titre de naïade ou de nymphe; c’est par une simple supercherie de détail que cette femme a été considérée comme une femme moderne.
Ici, rien de semblable; c’est une fille de nos jours, et une fille qui ne pose pas pour la galerie, qui n’est ni lascive ni minaudière, qui s’occupe tout bonnement à repriser ses nippes.
Puis la chair est criante; ce n’est plus cette peau plane, lisse, sans points de millet, sans granules, sans pores, cette peau uniformément trempée dans une cuve de rose et repassée au fer tiède par tous les peintres; c’est un épiderme que rougit le sang et sous lequel les nerfs tressaillent ; quelle vérité, enfin, dans toutes ces parties du corps, dans ce ventre un peu gros tombant sur les cuisses, dans ces rides courant au-dessous de la gorge qui balle, cerclée de bistre, dans ces attaches des genoux un peu anguleux, dans cette saillie du poignet plié sur la chemise !
Je suis heureux d’acclamer un peintre qui ait éprouvé, ainsi que moi, l’impérieux dégoût des mannequins, aux seins mesurés et roses, aux ventres courts et durs, des mannequins pesés par un soi-disant bon goût, dessinés suivant des recettes apprises dans la copie des plâtres.
Ah ! La femme nue ! — Qui l’a peinte superbe et réelle, sans arrangements prémédités, sans falsifications et de traits et de chairs ? Qui a fait voir, dans une femme déshabillée, la nationalité et l’époque auxquelles elle appartient, la condition qu’elle occupe, l’âge, l’état intact ou défloré de son corps ? Qui l’a jetée sur une toile, si vivante, si vraie, que nous rêvons à l’existence qu’elle mène, que nous pouvons presque chercher sur ses flancs le coup de fouet des couches, rebâtir ses douleurs et ses joies, nous incarner pour quelques minutes en elle ?
En dépit de ses titres mythologiques et des bizarres parures dont il revêt ses modèles, Rembrandt, seul, a jusqu’à ce jour peint le nu. — Et c’est ici l’inverse de Courbet; il faut enlever les pompeux affutiaux qui traînent dans ses toiles pour restituer aux figures le moderne cachet qu’elles eurent, au temps du peintre. — Ce sont des Hollandaises et pas d’autres femmes que ces Vénus de Rembrandt, ces filles auxquelles on cure les pieds et dont on ratisse la tête avec le buis d’un peigne, ces bedonnantes commères aux gros os saillant sous l’élastique de leur peau grenue, dans un rayon d’or !
À défaut de l’homme de génie qu’était cet admirable peintre, il serait bien à désirer que des artistes de talent comme M. Gauguin fissent pour leur époque ce que le Van Rhin a fait pour la sienne ; qu’ils enlevassent, dans ces moments où le nu est possible, au lit, à l’atelier, à l’amphithéâtre et au bain, des Françaises dont le corps ne soit pas construit de bric et de broc, dont le bras ne soit pas posé par un modèle, la tête ou le ventre par un autre, avec en sus de tous ces raccords, le dol d’un procédé propre aux anciens maîtres.
Mais hélas ! ces souhaits demeureront pendant longtemps inexaucés, car l’on persiste à emprisonner des gens dans des salles, à leur débiter les mêmes sornettes sur l’art, à leur faire copier l’antique, et on ne leur dit pas que la beauté n’est point uniforme et invariable, qu’elle change, suivant la climature, suivant le siècle, que la Vénus de Milo, pour en choisir une, n’est ni plus intéressante, ni plus belle maintenant que ces anciennes statues du Nouveau Monde, bigarrées de tatouages et coiffées de plumes ; que les unes et les autres sont simplement les manifestations diverses d’un même idéal de beauté poursuivi par des races qui diffèrent; qu’actuellement il ne s’agit plus d’atteindre le beau selon le rite vénitien ou grec, hollandais ou flamand, mais à s’efforcer de le dégager de la vie contemporaine, du monde qui nous entoure. — Et il existe, et il est là, dans la rue où ces malheureux qui ont pioché dans les salles du Louvre ne voient pas, en sortant, les filles qui passent, étalant le charme délicieux des jeunesses alanguies et comme divinisées par l’air débilitant des villes ; le nu est là sous ces étroites armures qui collent les bras et les cuisses, moulent le bassin, et avancent la gorge, un nu autre que celui des vieux siècles, un nu fatigué, délicat, affiné, vibrant, un nu civilisé dont la grâce travaillée désespère !
Ah ! Ils me font rire les Winckelmann et les Saint-Victor qui pleurent d’admiration devant le nu des Grecs et osent bien déclarer que la beauté s’est pour toujours réfugiée dans ce tas de marbres !
Je le répète donc, M. Gauguin a, le premier, depuis des années, tenté de représenter la femme de nos jours et, malgré la lourdeur de cette ombre qui descend du visage sur la gorge de son modèle, il a pleinement réussi et il a créé une intrépide et authentique toile.
En sus de cette oeuvre, il a exposé aussi une statuette en bois gothiquement moderne, un médaillon de plâtre peint, une Tête de chanteuse qui rappelle un tantinet le type de femme adopté par Rops ; une amusante chaise pleine de fleurs, avec un coin ensoleillé de jardin, puis plusieurs vues de ce quartier intimiste par excellence, Vaugirard, une vue de jardin, et une vue de l’église dont le sombre intérieur fait songer à une chapelle usinière, à une spleenétique église de ville industrielle égarée dans ce coin joyeux et casanier d’une province ; mais bien que ces tableaux aient des qualités, je ne m’y arrêterai pas, car la personnalité de M. Gauguin, si tranchée dans son étude de nu, s’est difficilement échappée encore, dans le paysage, des embrasses de M. Pissarro, son maître.
Revenons maintenant dans la salle où s’étagent les Raffaëlli. J’ai déjà dit quel accent ce peintre avait su donner aux sites de nos banlieues ; la série qu’il exhibe, cette fois, enforce la note de ce magnifique tableau de Gennevilliers dont j’ai parlé, l’année dernière ; une toile, intitulée Vue de Seine, est plus poignante encore s’il est possible, une toile où l’eau coule, glauque, entre deux rives de neige, sous un ciel imperméable et blême que brouillent des fumées fuligineuses. Nous sommes loin de cette eau en taffetas vert-pomme et de ces traînées de blanche ouate que les neigistes officiels disposent si gentiment. La Seine est terrible dans le panneau de M. Raffaëlli ; elle roule, lente et sourde, et il semble que jamais plus elle ne s’éclaircira et bleuira entre ses rives, tant demeure aiguë l’impression d’angoisse que laisse ce paysage de désolation, éclairé par les rayons crépusculaires d’un soleil mort, enfoui sous une couche de pesants nuages.
À distinguer encore une grue à vapeur qui s’enlève, mélancolique, sur le ciel; une locomotive en panne près d’une station; un cheval sur une hauteur, la rosse typique que les amateurs des banlieues ont toujours vue, en l’air, sur un tertre, coupant l’horizon de sa carcasse ; enfin une Vue de Clichy, par un temps de neige.
L’exécution est comme toujours incisive et sobre, d’un dessin serré, s’attachant à faire saillir la silhouette des corps, donnant l’impression ressentie presque sans le secours de la couleur.
Un curieux rapprochement peut s’opérer entre M. Pissarro et Raffaëlli, qui, avec des tempéraments et des procédés complètement inverses, sont parvenus à peindre des paysages qui sont, les uns et les autres, des chefs-d’oeuvre. L’un, coloriste surtout, se servant d’une formule inusitée, abstruse, arrivant à rendre la vibration de l’atmosphère, la danse des poussières lumineuses dans un rayon, abordant franchement le grand jour, vous faisant douter de la vérité de tous les paysages qui semblent convenus en face de ces pulsations, de ces haleines même de la nature enfin surprises ; l’autre, dessinateur surtout, conservant l’ancien système, le faisant sien, à force de personnalité; se confinant dans la mélancolie des jours couverts et des temps pâles : ce sont les deux antipodes de la peinture réunis, dans la même salle, vis-à-vis, et jamais paysages n’ont figuré dans un salon, plus disparates et plus beaux que cette Sente du chou et cette Vue de Seine !
Je m’arrêterai maintenant devant l’une des faces que j’avais un peu volontairement laissées jusqu’ici dans l’ombre du talent de M. Raffaëlli, je veux parler des figures qui animent ses paysages. Jusqu’alors une tendance à cette humanitairerie qui me gâte les paysans de Millet, passait dans la physionomie, dans l’attitude des loqueteux peints par M. Raffaëlli ; cette inutile emphase a maintenant disparu, son bonhomme qui vient de peindre une porte est, à ce propos, décisif ; il ne songe ni à la terre, ni au ciel, ne maudit aucune destinée, n’implore aucun secours ; il lui reste du vert dans son pot et il se demande tout bonnement s’il pourrait l’utiliser, en donnant un coup de pinceau sur un volet, sur un échalas, sur un banc, sur n’importe quel ustensile de sa maisonnette dont la couleur serait déteinte.
C’est une figure, excellente de bonhomie, qui n’outrepasse plus les droits de la peinture, en y mêlant des éléments philosophiques ou littéraires ; puis l’exécution s’est pacifiée sans rien perdre de sa rigueur ; les contours sont moins cruellement cernés comme d’un fil de fer ou moins violemment gravés comme à l’eau-forte.
Depuis les frères Le Nain, ces grands artistes, qui devraient tenir une si haute place dans l’art en France, personne ne s’était véritablement fait le peintre des misérables hères des villes ; personne n’avait osé les installer dans les sites où ils vivent et qui sont forcément appropriés à leurs dénûments et à leurs besoins. M. Raffaëlli a repris et complété l’oeuvre des Le Nain ; il a également tenté une incursion dans un monde non moins douloureux que celui du peuple, dans le lamentable pays des déclassés; et il nous les montre, attablés devant des verres d’absinthe, dans un cabaret sous une tonnelle où se tordent, en grimpant, de maigres sarments privés de feuilles, avec leur fangeux attirail de vêtements en loques et de bottes en miettes, avec leur chapeau noir dont le poil a roussi et dont le carton gondole, avec leurs barbes incultes, leurs yeux creusés, leurs prunelles agrandies et comme aqueuses, la tête dans les poings ou roulant des cigarettes. Dans ce tableau, un mouvement de poignet décharné appuyant sur la pincée de tabac posée dans le papier en dit long sur les habitudes journalières, sur les douleurs sans cesse renaissantes d’une inflexible vie.
Je ne crains pas de m’avancer en déclarant que, parmi l’immense tourbe des exposants de notre époque, M. Raffaëlli est un des rares qui restera ; il occupera une place à part dans l’art du siècle, celle d’une sorte de Millet parisien, celle d’un artiste qu’auront imprégné certaines mélancolies d’humanité et de nature demeurées rebelles, jusqu’à ce jour, à tous les peintres.
Avec M. Forain, nous entrons dans une série de déclassés, autre que celle abordée par M. Raffaëlli. Ici, ce ne sont plus les têtes hâves ravagées par les déboires, les biles renversées dans le teint par les persistantes attaques de la déveine; ce sont les masques, usés, mais comme sublimés, par les triomphes du vice, les élégances vengeresses des famines subies, les dèches voilées sous la gaieté des falbalas et sous l’éclat des fards; la fille apparaît, le visage crépi; l’oeil fascinant, dans son réseau de poudre bleue étendue par l’estompe.
M. Forain a exposé, cette année, deux aquarelles : l’une, un couloir de théâtre, peuplé d’habits noirs, au milieu desquels s’avance dans une robe grenat une grande femme, et les hommes s’écartent ou la dévisagent tandis que le monsieur sur le bras duquel elle pose sa main gantée, incline vers elle le niais sourire habituel aux gens qui font des grâces. L’autre nous montre une actrice assise, dans sa loge, devant une table de toilette. Pas encore maquillée, et rajeunie, elle apparaît, toute blanche, sur le fond étouffé des murs, dans la lueur filtrée par l’un de ces vastes abat-jour, maintenant à la mode et dont la forme rappelle les robes à tuyaux portées par nos grand’mères. Un monsieur, debout, la main appuyée sur le dossier d’un fauteuil, l’examine, pendant qu’elle se regarde dans une glace, dépeignée, la tête un peu tirée en arrière par la coiffeuse dont la gorge prodigieuse bombe.
Ce qui ébaubit et déconcerte, c’est cette furieuse touffeur de femme tiède et d’essences débouchées qui jaillit de ces aquarelles si alertes et si libres; tout cela bouge et fume, l’on entend les propos qui s’échangent, le craquement étouffé des bottes sur les tapis, l’on reconnaît ces gens pour les avoir vus, partout où la gomme s’assemble, et ils sont saisis avec une telle justesse de posture qu’on imagine pas qu’ils puissent se tenir autrement au moment où l’artiste nous les présente.
Ce dont je doute, par exemple, c’est que ces aquarelles soient appréciées par la plupart des visiteurs, car elles possèdent un art spécieux et cherché qui exige pour être admiré, comme bien des oeuvres littéraires du reste, une certaine initiation, un certain sens.
Puis jamais, au grand jamais, le public n’acceptera M. Forain comme un peintre, par ce seul motif qu’il se sert de l’aquarelle, de la gouache et du pastel et qu’il ne s’adonne que rarement à l’huile. Or, parmi les indéracinables préjugés du monde, seule, la peinture à l’huile, enseignée au mépris de toute autre par l’école des beaux-arts, est un art supérieur. Latour, Chardin, La Rosalba, renaîtraient et enverraient au prochain salon des pastels, qu’on s’empresserait de les reléguer, si toutefois le jury consentait à les admettre, dans un couloir quelconque ou dans un introuvable dépotoir, comme étant les petits jouets de l’art.
Incorrigible stupidité des foules ! Il y a des peintres qui ont du talent et d’autres qui n’en ont pas — tout est là. — Un pastel de M. Forain est une oeuvre d’art et une huile de M. Tofani, l’immortel auteur de Enfin seuls ! n’en est pas une; et, en prenant deux peintres de même taille, celui qui peindra au jus de lin ne fera, ni de l’art plus grand, ni de l’art moins grand que celui qui peindra à l’eau; ce sont des procédés d’exécution différents dont chacun a sa raison d’être et qui ne valent chacun que par le talent de l’artiste qui les emploie.
Il faudrait d’ailleurs être singulièrement obtus pour considérer les pastels de Chardin comme étant d’une envergure inférieure à celle de ses huiles ; et si nous entrons dans le moderne, est-ce que les portraits au crayon de couleur, jadis exposés par M. Renoir, n’étaient pas mille fois plus captivants, plus individuels, plus pénétrés que tous les portraits aux corps gras des halls officiels ?
La vérité est qu’aujourd’hui chacune de ces façons de peindre correspond plus directement à l’une des diverses faces de l’existence contemporaine. L’aquarelle a une spontanéité, une fraîcheur, un piment d’éclat, inaccessibles à l’huile qui serait impuissante à rendre les tons de la lumière, l’épicé des chairs, la captieuse corruption de cette loge de M. Forain, et le pastel a une fleur, un velouté, comme une liberté de délicatesse et une grâce mourante que ni l’aquarelle, ni l’huile ne pourraient atteindre. Il s’agit donc simplement pour un peintre de choisir, entre ces différents procédés, celui qui paraîtra le mieux s’adapter au sujet qu’il veut traiter.
Et c’est même là une preuve d’intelligence, une supériorité artiste, en plus, des indépendants si variés dans leurs méthodes, sur les peintres officiels qui, pour brosser une nature morte, un portrait, un paysage, une scène d’histoire, recourent indifféremment au même mécanisme, à la même substance.
Il faut avoir fréquenté les expositions successives des indépendants pour bien apprécier toute l’innovation que ces artistes ont apportée, au point de vue matériel, dans l’ordonnance de leurs oeuvres. Outre qu’ils usent, presque tous, de l’aquarelle, du pastel et de la gouache, ils ont corrigé le miroitant de l’huile enduite de vernis, en adoptant, pour la plupart, le système anglais qui consiste à laisser la peinture mate et à la recouvrir d’un verre. Ils évitent ainsi les luisants de parquet sur lesquels l’oeil glisse et ils se bornent simplement à enlever au tableau son aspect laineux et terne.
Puis quelle variété dans les encadrements qui revêtent tous les tons variés de l’or, toutes les nuances connues, qui se bordent de lisérés peints avec la couleur complémentaire des cadres ! La série des Pissarro est, cette année surtout, surprenante. C’est un bariolage de véronèse et de vert d’eau, de maïs et de chair de pêche, d’amadou et de lie de vin, et il faut voir avec quel tact le coloriste a assorti toutes ses teintes pour mieux faire s’écouler ses ciels et saillir ses premiers plans. C’est le raffinement le plus acéré; et, encore que le cadre ne puisse rien ajouter au talent d’une oeuvre, il en est cependant un complément nécessaire, un adjuvant qui le fait valoir. C’est la même chose qu’une beauté de femme qui exige certains atours, qu’un vin précieux qui demande à être dégusté dans un joli verre et non dans un bol en terre de pipe, c’est la même chose aussi que certains livres délicats et ciselés qui choqueraient les sensitifs, s’ils étaient imprimés sur papier à chandelle, par des têtes de clous. Il existe, en somme, une accordance à établir entre le contenant et le contenu, entre le tableau et le cadre, et tous les indépendants l’ont si bien compris qu’en sus de M. Pissarro, tous ont, depuis longtemps, rejeté l’éternel cadre doré, à chicorées et à choux, et adopté les encadrements les plus divers, les cadres tout blancs, ou blancs et ourlés d’un surjet d’or, les cadres où l’or est appliqué à même sur les veines du bois, les granulés, comme tapissés d’un papier d’émeri d’or, les cadres couleur des planchettes des boîtes à cigares, comme celui du portrait de Duranty, exposé l’année dernière, ou bien encore la baguette de cuivre jaune ou de poirier noirci, limitant un passe-partout de carton brut, sur lequel, pour rompre la monotonie du ton trop sourd, M. Raffaëlli a jeté, à la manière japonaise, anglifiée par Kate Greenaway, un insecte, une branche, un passe-partout gris souris qui aide à donner toute sa valeur au gris pâle de ses ciels.
Mais laissons ces détails matériels dont l’importance n’est évidemment perceptible que pour vingt personnes et reprenons notre course au travers des salles.
À vrai dire, nous les avons singulièrement écrémées. M. Caillebotte n’a malheureusement pas exposé cette année et M. Zandomeneghi a envoyé deux toiles et un dessin où je ne retrouve aucune des qualités de son tableau de Mère et fille de l’an dernier. Sa Vue de la place d’Anvers n’est qu’ordinaire et son buste de femme assise, le dos contre un arbre, se distingue à peine de peintures de M. Béraud et de M. Goeneutte. Reste enfin Mme Morizot, qui envoie des ébauches égales aux esquisses de l’année passée; de jolies taches qui s’animent et exhalent de féminines élégances, lorsque les yeux plissent et les sortent du cadre.
Ainsi que M. Manet, son maître, Mme Morizot possède, sans nul doute, un oeil qui cligne naturellement, par une disposition spéciale des paupières, ce qui lui permet de saisir les finesses les plus ténues des taches que font les corps sur l’air ambiant ; mais, comme toujours, elle se borne à des improvisations trop sommaires et trop constamment répétées, sans la moindre variante. En dépit de ces objections, Mme Morizot est une nerveuse coloriste, un des seuls peintres qui aient su comprendre les adorables délices des toilettes mondaines.
Je passe sous silence, maintenant, deux petites salles où s’étagent, en quelques rangées comiques, les croûtes des Cals, Rouart, Vidal et d’autres peinturleurs des plus officiels, dont les huiles seraient bien dignes d’être épurées par M. Toulmouche.
Notre visite est terminée; elle me semble suggestive en réflexions. D’abord, un grand fait domine, l’éclosion de l’art impressionniste arrivé à maturité avec M. Pissarro. Ainsi que je l’ai maintes fois écrit, jusqu’à ce jour la rétine des peintres de l’impression s’exacerbait. Elle saisissait bien tous les passages de ton de la lumière, mais elle ne pouvait les exprimer et les papilles nerveuses étaient arrivées à un tel état d’irritabilité qu’il ne nous restait que peu d’espoir.
En somme, l’art purement impressionniste tournait à l’aphasie lorsque, par miracle, tout à coup il s’est mis à parler, sans incohérences.
Puis, deux peintres, qui hésitaient à marcher seuls, ont délaissé leurs bourrelets et leurs lisières et se sont avancés bien d’aplomb sur leurs jambes : Mlle Cassatt et M. Gauguin ; de son côté, le talent de M. Raffaëlli bat son plein et voilà que M. Degas se complaît à toucher à la sculpture et ouvre du coup, une échappée nouvelle.
Le salon des indépendants comptera donc entre tous, cette fois ; il est la révélation désormais commencée d’un art nouveau, puis il me semble apporter un irréfutable argument à la question toujours irrésolue des rapports à établir entre l’état et l’art. La situation des peintres que le gouvernement encourage est maintenant celle-ci :
Lassé par leurs perpétuelles criailleries, par leurs continuelles récriminations, l’état, après son échec de l’an dernier, a fini par dire à ces industriels : « Voici une grange plafonnée de vitres, je vous la loue un franc par an ; je renonce à vous organiser puisqu’il est convenu que je ne commets que des injustices et des maladresses, et je consens néanmoins à distribuer, suivant l’avis des gens que vous aurez désignés, des rations et des médailles : maintenant agissez comme bon vous semblera. Vous réclamez, à cor et à cris, des réformes ? Opérez-les ; vous m’accusez de suivre aveuglément les opinions intéressées de Bonnat, de Cabanel, de Laurens, de tous les notables commerçants de l’huile ; eh bien, excluez tous ces califes de votre jury et votez pour d’autres, plus intelligents, et plus éclectiques; en un mot préparez vous-mêmes vos expositions, soyez vos maîtres. »
Alors, pareils à des bestiaux réduits par l’apprivoisement, les peintres ont refusé de secouer leur bât, de courir en liberté, et ils sont rentrés dare-dare dans leurs écuries, déclarant que tout était pour le mieux dans le meilleur des haras du monde, qu’ils voulaient en fin de compte conserver leurs Loyal, leurs Fernando, leurs Franconi, tous leurs anciens maîtres.
En conséquence, Bonnat, Cabanel, Laurens, tous les grands éleveurs, ont été réélus membres du jury, de par le vote de ces gens qui demandaient depuis si longtemps leur mise dans un rancart ; rien n’est donc changé, ce seront les mêmes hommes qui accepteront ou repousseront les toiles, qui feront couronner tel ou tel exercice de leurs élèves.
Tel est le résultat auquel de libérales intentions ont abouti. À dire vrai, l’état a fait fausse route ; il a voulu ménager et la chèvre et le chou, continuer, malgré ses apparences de désintéressement, à patronner et à récompenser encore les peintres, au lieu de les assimiler aux autres négociants, et de les laisser se débrouiller tout seuls, ouvrir s’ils le veulent des boutiques et distribuer des prospectus.
Il n’y a pas plus de raison, en effet, de protéger et de médailler les peintres qu’il n’y a de raison d’aider et de décorer les littérateurs et les musiciens. Ceux qui auront une personnalité finiront par percer peut-être et, du reste, leur sort restera le même, que l’on anéantisse ou que l’on conserve les médailles et les commandes, puisqu’ils sont assurés de n’en jamais avoir ; quant aux autres, ils se feront employés de commerce s’ils ont de l’instruction, camelots ou boueux s’ils ne savent ni compter ni lire. D’ailleurs, je ne suis pas inquiet sur leur sort, ils continueront à barbouiller de la peinture, car moins on a de talent et plus on a de chance de gagner sa vie dans l’art !
En somme, les bienfaits de l’état vont aux intrigants et aux médiocres ; le prix de Rome n’a jamais donné de talent au peintre qui l’a obtenu, puisque ce prix est réservé au manque d’individualité et au respect des conserves. Le mot de Courier est toujours juste : « Ce que l’état encourage languit, ce qu’il protège meurt. »
Mettez en parallèle maintenant la situation de ces peintres avec celle des indépendants ; ceux-là sont, à peu d’exception près, les seuls qui aient du talent en France, et ce sont justement eux qui repoussent le contröle et l’aide de l’état ; au point de vue matériel, leurs expositions sont suivies et marchent ; au point de vue artistique, ils s’avançent dans la voie qu’ils ont choisie, pouvant se permettre toutes les tentatives, toutes les audaces sans crainte d’être repoussés par le mauvais vouloir ou la peur d’une douane; ils peuvent en appeler au jugement du public, obtenir au moins qu’on les interroge, qu’on ne les condamne pas sans les voir ; et c’est grâce à ce système d’expositions particulières que l’art impressionniste, constamment rejeté des salons officiels, a pu se développer et enfin s’affirmer et s’épanouir.
Devant ce résultat dû à l’initiative privée, l’état peut, s’il veut bien y réfléchir, reconnaître l’inanité des approbations qu’il a jusqu’ici prodiguées aux élèves de ses classes. Il a en vain tenté toutes les réformes, essayé de tous les atermoiements possibles. Il ne lui reste plus maintenant qu’un seul parti à prendre : supprimer carrément les cirques officiels, les médailles et les commandes, l’école de la rue Bonaparte et la direction de M. Turquet.
L’exemple des indépendants démontre victorieusement l’inutilité d’un budget et le néant d’une direction appliqués aux arts.
Notes
1. L.'art de modeler la cire coloriée date de loin ; si nous en croyons Vasari, Andréa de Ceri était déjà célèbre, au XVe siècle, pour son habileté à sculpter cette matière.